 Tautavel est un petit village des Corbières à une trentaine de kilomètres de Perpignan. Une rivière, le Verdouble, sort de la falaise de marbre et a creusé la plaine où poussent des champs de vignes à muscat et des vergers d’abricots. L’eau du ciel a, durant les millénaires, creusé d’en haut le calcaire, s’infiltrant avec obstination dans les fissures. La chimie a fait le reste, l’acide carbonique de la pluie dissolvant le carbonate de chaux pour ouvrir des cavités internes. Et puis un jour, par écroulement, une grotte bée vers l’extérieur. C’est ce qui est arrivé à Tautavel.
Tautavel est un petit village des Corbières à une trentaine de kilomètres de Perpignan. Une rivière, le Verdouble, sort de la falaise de marbre et a creusé la plaine où poussent des champs de vignes à muscat et des vergers d’abricots. L’eau du ciel a, durant les millénaires, creusé d’en haut le calcaire, s’infiltrant avec obstination dans les fissures. La chimie a fait le reste, l’acide carbonique de la pluie dissolvant le carbonate de chaux pour ouvrir des cavités internes. Et puis un jour, par écroulement, une grotte bée vers l’extérieur. C’est ce qui est arrivé à Tautavel.

 La grotte en question est appelée ici la « Caune de l’Arago ». Elle s’élève d’une centaine de mètres au-dessus des gorges des Gouleyrous où s’étrangle l’eau rapide et froide du Verdouble.
La grotte en question est appelée ici la « Caune de l’Arago ». Elle s’élève d’une centaine de mètres au-dessus des gorges des Gouleyrous où s’étrangle l’eau rapide et froide du Verdouble.
C’est à l’intérieur, dans la brèche, que les archéologues sous la direction du professeur Henry de Lumley ont découvert, le 22 juillet 1971, le crâne écrasé d’un homme d’une vingtaine d’années. Non, la police n’a pas été prévenue car le sol archéologique le datait d’il y a environ 450 000 ans : les coupables avaient depuis longtemps disparu. Et oui, je suis venu à la préhistoire comme Henry de Lumley en lisant La guerre du feu de Rosny aîné, vers dix ans.
 Ce premier Français sans le savoir n’était pas très grand, 1 m 65, mais debout, un front plat et fuyant, des pommettes saillantes, un grand bourrelet au-dessus des yeux qu’on appelle en mots savants « torus sus orbitaire » – rien de cela n’est bon signe : l’Homme de Tautavel n’est vraiment « pas comme nous ».
Ce premier Français sans le savoir n’était pas très grand, 1 m 65, mais debout, un front plat et fuyant, des pommettes saillantes, un grand bourrelet au-dessus des yeux qu’on appelle en mots savants « torus sus orbitaire » – rien de cela n’est bon signe : l’Homme de Tautavel n’est vraiment « pas comme nous ».
 Surtout que l’on n’a retrouvé nulle trace de feu alentour, mais de grossiers cailloux taillés (appelés « bifaces ») et quelques éclats de silex. Ce barbare était chasseur et bouffait ses proies toute crues. De fait, petit cerveau et robustes épaules, il s’appelait Erectus et pas encore Néandertal. On soupçonne même que ce jeune homme fut mangé…
Surtout que l’on n’a retrouvé nulle trace de feu alentour, mais de grossiers cailloux taillés (appelés « bifaces ») et quelques éclats de silex. Ce barbare était chasseur et bouffait ses proies toute crues. De fait, petit cerveau et robustes épaules, il s’appelait Erectus et pas encore Néandertal. On soupçonne même que ce jeune homme fut mangé…
 La grotte lui servait de camp provisoire, avec vue dégagée sur la plaine, où il pouvait tranquillement dépecer cerfs, rhinocéros, éléphants, chevaux et mouflons d’époque. Voyait-il au loin la steppe à graminées ou des forêts de chênes verts ? Nous étions en pleine glaciation de Mindel car – n’en déplaise aux écolos mystiques – le climat n’a eu de cesse de changer tout seul depuis que la planète existe.
La grotte lui servait de camp provisoire, avec vue dégagée sur la plaine, où il pouvait tranquillement dépecer cerfs, rhinocéros, éléphants, chevaux et mouflons d’époque. Voyait-il au loin la steppe à graminées ou des forêts de chênes verts ? Nous étions en pleine glaciation de Mindel car – n’en déplaise aux écolos mystiques – le climat n’a eu de cesse de changer tout seul depuis que la planète existe.
 Je n’étais pas présent à la découverte de 1971, je suis venu fouiller la grotte à l’été 1977. C’était dans le cadre d’un stage pratique obligatoire que suivent les étudiants en archéologie, tout comme les stages en entreprise des écoles de commerce. Nous étions jeunes, de 14 à 30 ans ; certains étaient venus en couple avec leurs petits enfants. David, 7 ans, Géraldine, 5 ans, jouaient avec les enfants Lumley : Édouard, 10 ans, Isabelle, 7 ans et William, 5 ans. Lionel, l’aîné, aidait déjà quelques heures les fouilleurs, du haut de ses 12 ans. J’étais venu avec des amis et nous campions sur le pré au bas de la grotte.
Je n’étais pas présent à la découverte de 1971, je suis venu fouiller la grotte à l’été 1977. C’était dans le cadre d’un stage pratique obligatoire que suivent les étudiants en archéologie, tout comme les stages en entreprise des écoles de commerce. Nous étions jeunes, de 14 à 30 ans ; certains étaient venus en couple avec leurs petits enfants. David, 7 ans, Géraldine, 5 ans, jouaient avec les enfants Lumley : Édouard, 10 ans, Isabelle, 7 ans et William, 5 ans. Lionel, l’aîné, aidait déjà quelques heures les fouilleurs, du haut de ses 12 ans. J’étais venu avec des amis et nous campions sur le pré au bas de la grotte.
 Aux heures chaudes après la fouille, nous nous baignions dans les eaux froides de la rivière tandis que les équipes de cuisine, par roulement, préparaient le dîner pour une trentaine. Le vin de l’année, produit dans le pays, était étonnamment fruité et nous donnait de la gaieté. Le soir nous voyait aller au village pour prendre un dernier muscat local (Rivesaltes n’est pas loin), tout en dérobant quelques abricots trop mûrs au passage. Ou bien un grand feu collectif nous attirait autour de sa lumière pour brochettes et patates sous la cendre, « à la préhistorique ». Cela pour la grande joie des enfants. Nous étions jeunes, nous goûtions la vie par tous nos sens. Il y avait de l’ambiance – celle toute d’époque, à 9 ans de 1968 – feu de camp, torses nus et guitare… Ce qui avait lieu ensuite ne concernait pas les enfants.
Aux heures chaudes après la fouille, nous nous baignions dans les eaux froides de la rivière tandis que les équipes de cuisine, par roulement, préparaient le dîner pour une trentaine. Le vin de l’année, produit dans le pays, était étonnamment fruité et nous donnait de la gaieté. Le soir nous voyait aller au village pour prendre un dernier muscat local (Rivesaltes n’est pas loin), tout en dérobant quelques abricots trop mûrs au passage. Ou bien un grand feu collectif nous attirait autour de sa lumière pour brochettes et patates sous la cendre, « à la préhistorique ». Cela pour la grande joie des enfants. Nous étions jeunes, nous goûtions la vie par tous nos sens. Il y avait de l’ambiance – celle toute d’époque, à 9 ans de 1968 – feu de camp, torses nus et guitare… Ce qui avait lieu ensuite ne concernait pas les enfants.
 La fouille était un travail agréable, car à l’ombre constante de la grotte. Monter la centaine de mètres vers son entrée nous mettait en nage, mais un quart d’heure plus tard, nous étions régulés. J’avais pour mission de fouiller un carré dans le fond de la grotte, sur les hauteurs, tout en surveillant deux novices des carrés d’à côté. J’étais en effet déjà un « spécialiste » de fouilles, ayant pratiqué 4 ou 5 chantiers différents, y compris en Bulgarie et en Suisse.
La fouille était un travail agréable, car à l’ombre constante de la grotte. Monter la centaine de mètres vers son entrée nous mettait en nage, mais un quart d’heure plus tard, nous étions régulés. J’avais pour mission de fouiller un carré dans le fond de la grotte, sur les hauteurs, tout en surveillant deux novices des carrés d’à côté. J’étais en effet déjà un « spécialiste » de fouilles, ayant pratiqué 4 ou 5 chantiers différents, y compris en Bulgarie et en Suisse.
 Dans la terre, nous creusons habituellement à la truelle ; mais dans la brèche qui compose un sol de grotte, qui est du calcaire solidifié, nous sommes obligés d’y aller au burin et au marteau. Dégager les objets archéologiques (cailloux taillés, éclats de silex, os fossilisés, dents) n’est pas une sinécure. Il faut être attentif, détourer les objets, ne pas aller trop vite. Il faut dessiner, numéroter et fixer en altitude tout objet avant de le bouger. Recoller les morceaux ou le consolider au polycarbonate s’il s’effrite trop, comme l’os fossile.
Dans la terre, nous creusons habituellement à la truelle ; mais dans la brèche qui compose un sol de grotte, qui est du calcaire solidifié, nous sommes obligés d’y aller au burin et au marteau. Dégager les objets archéologiques (cailloux taillés, éclats de silex, os fossilisés, dents) n’est pas une sinécure. Il faut être attentif, détourer les objets, ne pas aller trop vite. Il faut dessiner, numéroter et fixer en altitude tout objet avant de le bouger. Recoller les morceaux ou le consolider au polycarbonate s’il s’effrite trop, comme l’os fossile.
 Mais quelle émotion de découvrir, brusquement, une dent humaine ! Ce fut mon cas à plusieurs reprises avec, à chaque fois, le même souffle coupé. 450 000 ans plus tôt, des êtres humains avaient vécu là, y étaient morts, et le temps écoulé, les phénomènes naturels, n’ont pu éradiquer cette trace ultime…
Mais quelle émotion de découvrir, brusquement, une dent humaine ! Ce fut mon cas à plusieurs reprises avec, à chaque fois, le même souffle coupé. 450 000 ans plus tôt, des êtres humains avaient vécu là, y étaient morts, et le temps écoulé, les phénomènes naturels, n’ont pu éradiquer cette trace ultime…
Clignant des yeux au sortir de la semi-obscurité, retrouvant le monde d’aujourd’hui, nous regardions alors les petits avec d’autres yeux : comme des chaînons d’une lignée, comme des transmetteurs d’humanité, même si ces enfants n’étaient pas les nôtres.
 Il y avait la fouille, il y avait la position et le dessin des objets, leur description dans le carnet de carré (d’un mètre sur un mètre), mais ce qui se passait sur le terrain n’était qu’une partie du travail. La suite consistait à tamiser les déblais, à nettoyer les objets, à les numéroter à l’encre de Chine vernie, avant de travailler – par roulement – à la reconstitution des plans généraux et des coupes de la grotte. Cette activité se passait au musée, à peine bâti à l’époque. Le mélange de vie quotidienne et de labeur scientifique, de mains dans la terre et de crayons sur le papier, d’observations neutres et d’imagination – rend le travail d’archéologue d’une richesse inouïe. Nous n’étions point payés, seulement nourris, mais quel bonheur !
Il y avait la fouille, il y avait la position et le dessin des objets, leur description dans le carnet de carré (d’un mètre sur un mètre), mais ce qui se passait sur le terrain n’était qu’une partie du travail. La suite consistait à tamiser les déblais, à nettoyer les objets, à les numéroter à l’encre de Chine vernie, avant de travailler – par roulement – à la reconstitution des plans généraux et des coupes de la grotte. Cette activité se passait au musée, à peine bâti à l’époque. Le mélange de vie quotidienne et de labeur scientifique, de mains dans la terre et de crayons sur le papier, d’observations neutres et d’imagination – rend le travail d’archéologue d’une richesse inouïe. Nous n’étions point payés, seulement nourris, mais quel bonheur !
 Je garde de cette époque, du pays de Tautavel, de ce travail de fouilles, de l’ambiance d’été du chantier, un souvenir ému. Certes, nous étions jeunes, mais régnait dans tout le pays, malgré la première crise du pétrole quatre ans auparavant, un optimisme général qui a bien disparu ! Comme un air d’insouciance que les millénaires sous nos pieds justifiaient de tout leur poids. « Vivez ici et maintenant », disaient ces dents humaines et ce crâne écrasé, « vivez pleinement votre vie d’homme » – car votre temps n’a qu’un temps. Nous l’avons croqué à belles dents – et c’est heureux.
Je garde de cette époque, du pays de Tautavel, de ce travail de fouilles, de l’ambiance d’été du chantier, un souvenir ému. Certes, nous étions jeunes, mais régnait dans tout le pays, malgré la première crise du pétrole quatre ans auparavant, un optimisme général qui a bien disparu ! Comme un air d’insouciance que les millénaires sous nos pieds justifiaient de tout leur poids. « Vivez ici et maintenant », disaient ces dents humaines et ce crâne écrasé, « vivez pleinement votre vie d’homme » – car votre temps n’a qu’un temps. Nous l’avons croqué à belles dents – et c’est heureux.
Patrick Grainville, agrégé de lettres et professeur de français au lycée de Sartrouville, lauréat du prix Goncourt 1976 pour « Les flamboyants », n’est plus guère lu aujourd’hui, tant sa sensualité, son érotisme et sa fougue sont peu en phase avec notre époque frileuse, craintive et austère. Il évoque pourtant la grotte de Tautavel dans un roman échevelé, érotique et luxueux que traversent motards, terroristes, amoureux et jeune camerounaise, sous le regard profond de la caverne…









































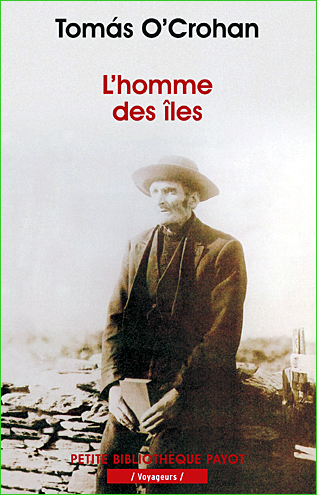











































































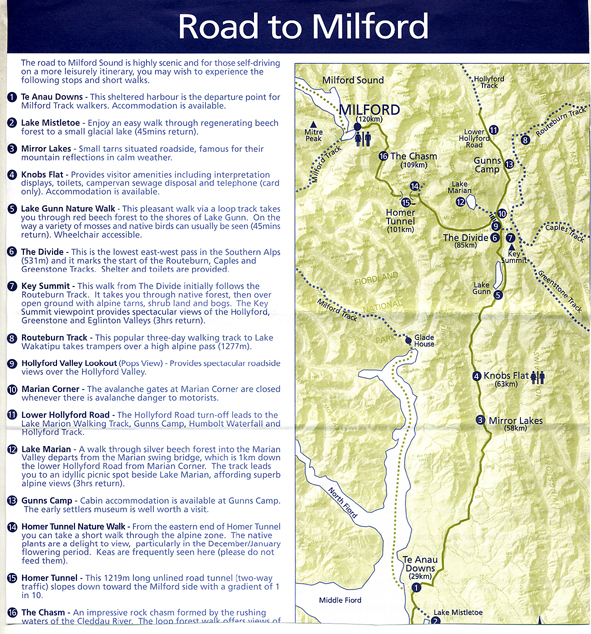






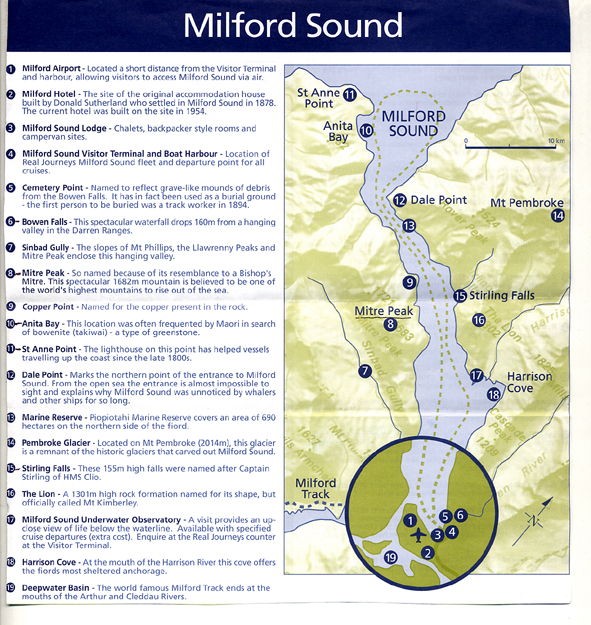
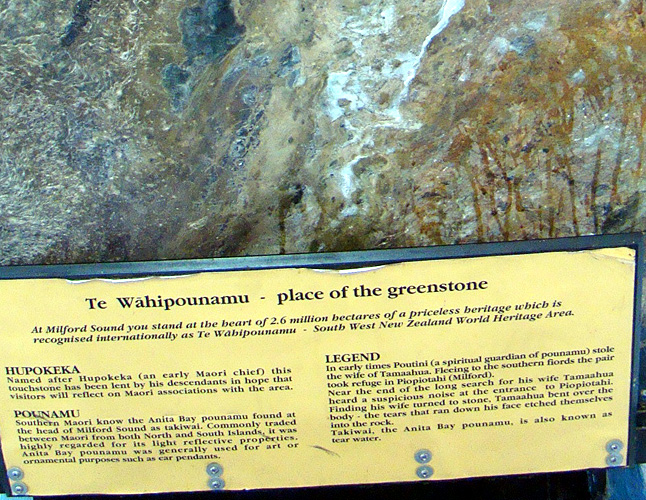







Commentaires récents