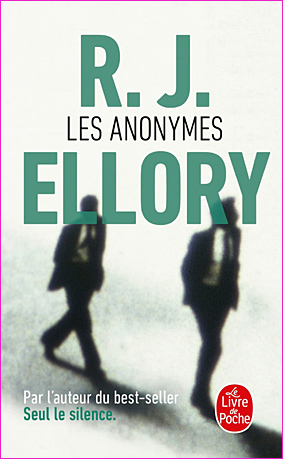
Un roman policier écrit par un Anglais et qui se passe aux Etats-Unis. Il dénonce l’impérialisme américain alimenté par la CIA, elle-même manipulée par quelques rares Maîtres du monde ou qui se croient tels. D’où le financement du contre-terrorisme « communiste » par l’argent de la drogue… facilité par l’Agence pour éviter de passer par le Congrès ! Ce fut vrai sous Reagan, peut-être moins aujourd’hui, encore que : l’argent tout-puissant corrompt puissamment.
Cela est le message de l’ouvrage, roman policier lent qui découvre peu à peu les rouages du Système. Nous sommes à Washington, le siège de la puissance, près du triangle des agences fédérales de force, CIA, FBI, Cour suprême. Une femme est assassinée par étranglement avant (ou après) avoir été sauvagement battue. Son nom de Catherine Sheridan est un faux, elle n’existe pas, son numéro de Sécurité sociale (avec lequel on peut – ou pouvait – obtenir n’importe quel papier d’identité) fait référence à une femme décédée il y a longtemps. Dans le pays « le plus avancé du monde » pour la technique, l’Administration est un brin retardée : on paperasse à gogo mais les fichiers ne sont pas reliés et mal remplis.
Les flics chargés de l’enquête piétinent ; ils aboutissent à chaque piste à des impasses. Car ce n’est pas la première femme à avoir été éliminée de la sorte. Aucun indice, aucune arme, aucune trace. Sauf que l’inspecteur Miller, toujours obsédé, stressé et fatigué, va se voir mettre le nez sur une piste qu’il aura beaucoup de mal à suivre. Il est pourtant réputé « le meilleur » de la brigade selon son capitaine et « des moyens » lui sont attribués car les politiciens s’inquiètent de l’opinion que la presse agite à propos d’un tueur en série. Il signe ses crimes avec un ruban attaché au cou de ses victimes, portant une étiquette de la morgue.
Miller n’est pas intelligent, materné par une Juive dont on ne voit pas trop ce qu’elle vient faire ici. Il est trop perpétuellement fatigué pour avoir des intuitions. C’est ce qui fait la faiblesse du livre. A l’inverse, son criminel qui n’en est peut-être pas un, quoique, apparaît un maître suprême dans l’art de l’analyse comme de la dissimulation. Il a été entraîné pour cela et mène dorénavant la carrière d’un brillant universitaire. Est-il le tueur ? Miller le croit mais le prof sème des cailloux comme le petit Poucet afin de forcer l’inspecteur à aller dans la bonne direction. Celui-ci ne veut pas voir, c’est trop évident ; il ne veut pas comprendre, c’est trop gros ; il ne veut pas admettre, ce serait scandaleux. Et pourtant « cela » est.
Ces meurtres ne sont pas au hasard. Il ne s’agit pas d’un psychopathe qui massacre en série mais d’une action planifiée par un organisme d’État, ou par des dissidents de cet organisme qui ont fondé un Etat dans l’État, ou par des manipulateurs de dissidents qui agissent au nom de leur propre morale d’État. Jusqu’au bout.
En bref c’est embrouillé, lent à démarrer, paranoïaque. Mais l’on s’y attache si l’on s’accroche. Fondé sur des faits vrais des années 1980, l’intrigue poursuit la tendance au prétexte que le nerf de la guerre a supplanté la guerre même. La fin mélo ne dépare pas.
Roger Jon Ellory, Les anonymes (A Simple Act of Violence), 2008, Livre de poche 2012, 731 pages, €8,90
En savoir plus sur argoul
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Commentaires récents