
L’auteur été un cancre, il en a fait un livre. Tout petit déjà, il a passé un an sur la lettre A. Les majuscules lui faisaient peur. Ses instituteurs lui disaient qu’il était nul et c’était pire au collège. Les appréciations des bulletins scolaires étaient toujours les mêmes, dépréciative. Mais le petit Daniel devenu grand a réussi à passer quand même le bac, en deux années, puis a enchaîné la licence et la maîtrise de lettres modernes. Sans passer le CAPES ni l’agrégation, il est devenu professeur de collège privé. C’est ce qui lui donne le droit et l’expérience d’écrire sur les élèves et l’enseignement.
Il mêle les souvenirs autobiographiques et les réflexions sur la façon d’enseigner. L’école dysfonctionne ; les professeurs « ne sont pas préparés pour ça ». Il s’interroge sur le « ça ». C’est un élément indéfini dans lequel le professeur met tout ce qui ne va pas, tout ce qu’il devrait faire, tout ce qu’il ne sait pas faire. Le « ça » est l’abîme qui sépare le savoir de l’ignorance. Mais cet abîme, le professeur ne le connaît pas. Il semble être né en ayant déjà tout appris, sans s’apercevoir que l’élève est justement celui qui ne sait riens et doit tout apprendre.
Oh, évidemment, il y a la société, les problèmes économiques, la crise, le chômage, l’immigration, les banlieues, les réseaux sociaux, l’attrait du téléphone mobile, la drogue, les fringues, et l’incivilité qui va, au cinéma comme dans le rap, et que la « bonne » société se complaît à reproduire, par snobisme. Mais les adolescents restent des adolescents, que ce soit au début de l’école publique à la fin du XIXe siècle, ou dans l’école publique massifiée du début du XXIe siècle. Ils sont aux prises avec la difficulté d’être de l’adolescence, le bouleversement des hormones et du corps, le regard des autres, l’identité, leur place dans la société et le jugement adulte. Le cancre, celui qui refuse l’école, la morale et le système, se replie au fond dans sa coquille parce qu’on ne le regarde pas tel qu’il est. Reconnaître l’individu est la première tâche du pédagogue. Nul professeur ne pourra enseigner un quelconque savoir s’il ne parle pas à un élève en particulier plutôt qu’au plafond dans sa classe.
Pour cela, il faut habiter son enseignement, attirer l’attention, faire jouer les élèves. Non pas en chahut post–68, mais pour leur faire assimiler par eux-mêmes, et en interaction de groupe, ce qui est la matière enseignée. Ainsi l’orthographe, que le professeur Pennac fait apprendre en donnant à corriger les copies des secondes aux petits de quatrième. Ou la grammaire, qu’il dissèque à partir d’une phrase spontanée d’un élève, évidemment mal formulée et générale, pour lui donner tout son sens particulier et correct. Les enfants sont curieux de nature, et il suffit de peu de choses pour qu’ils s’intéressent à ce qu’on leur propose. La première chose est de leur porter attention, la seconde est de reconnaître ce qu’ils réussissent, la troisième est de les encourager à faire par eux-mêmes.
Le professeur Daniel Pennacchioni, de père général et polytechnicien d’origine corse, est le dernier de quatre frères, dont deux ingénieurs et un officier. Il a été aimé durant son enfance, mais cela ne suffit pas. Seuls quelques rares professeurs ont réussi à l’intéresser à leur matière, en lettres, en histoire, en mathématiques, en philosophie. Mais c’est l’amour que lui ont porté deux filles qui l’ont, selon lui, fait mûrir et enfin assimiler le savoir. Il a dès lors « travaillé » pour passer ses diplômes. Il a enseigné 25 ans avant de laisser l’enseignement pour continuer d’écrire ses livres. Mais Il continue à intervenir dans les collèges et lycées pour transmettre sa passion des lettres.
Il donne quelques méthodes, comme faire apprendre un texte chaque semaine à ses élèves, portant sur une morale ou un sentiment, leur faisant analyser le pourquoi et l’enchaînement des idées plutôt que du simple apprentissage par cœur. On retient le mieux ce que l’on reconstitue en esprit. L’un de ses collègues de banlieue, en proie à des « racailles » illettrées et immatures, leur a fait, à chacun en particulier à 15 ans, tourner un film où ils interrogeaient un autre de leurs camarades. En passant puis repassant ces films devant tout le groupe, il leur a fait comprendre combien l’interviewé comme l’intervieweur jouait chacun un rôle, se la pétait, frimait, en bref n’étaient pas eux-mêmes. Dès lors, il leur a fait recommencer l’interview, et les adolescents se sont enfin révélés tels qu’ils étaient, sans les oripeaux des fringues de marque, des intonations provocatrices, des gestes imités de la rue. C’est page 237 et vaut son pesant d’émotion.
Au fond, plutôt que de se lamenter constamment sur les moyens ou de le nombre d’élèves, ou la formation jamais suffisante, ce qui compte est : « la seule chose sur laquelle nous pouvons personnellement agir et qui, elle, date de la nuit des temps pédagogiques : la solitude et la honte de l’élève qui ne comprend pas, perdu dans un monde où tous les autres comprennent » p.39. Plutôt que stigmatiser, respect !
Le cancre n’est pas de prédestination, ni la nullité un destin, mais dépend des rencontres et de l’attention. Chacun réclame sa part d’amour en ce monde et, parfois, certains professeurs peuvent le donner, repêcher un l’élève nul pour en faire un être pensant.
Un bien beau livre, malgré quelques délayage.
Prix Renaudot 2007
Daniel Pennac, Chagrin d’école, 2007, Folio 2009, 305 pages, €9,40
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)


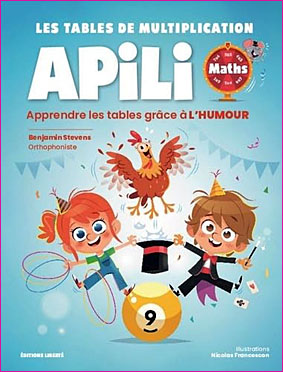
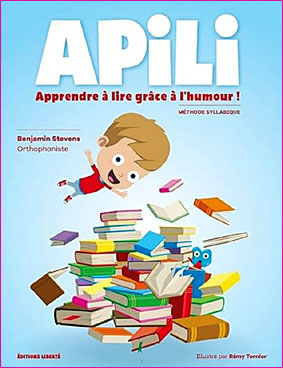

















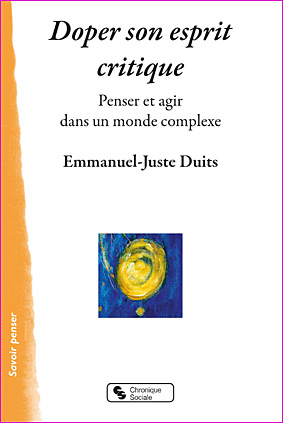














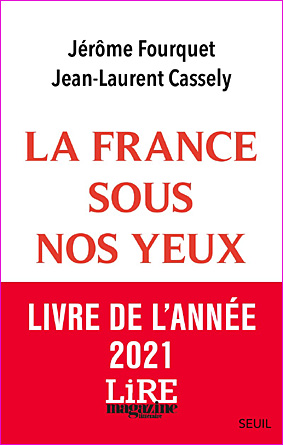







 .
. 




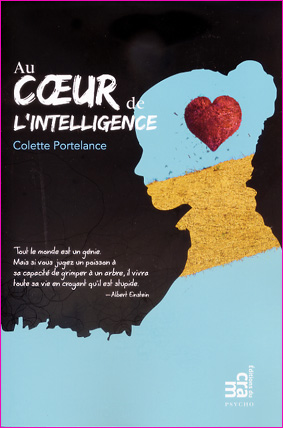
Commentaires récents