
Voici la suite de la série culte des films de termineurs, ces machines implacables et obtuses destinées à éliminer dans le passé tous les humains qui pourraient vouloir les éradiquer dans le futur. Vous suivez ? John Connor a 23 ans (Nick Stahl). Depuis la mort de sa mère d’une leucémie, il vit au jour le jour, de petits boulots, sans cesse en mouvement et sans compte bancaire, carte de crédit, téléphone mobile, ni adresse fixe – pour ne pas se faire repérer.
Il circule en moto pour aller plus vite, mais un daim le plante en bordure d’une forêt. Il rejoint lourdement en camion stop Los Angeles et son ancien quartier où il sait trouver des médicaments dans une clinique… vétérinaire. Un peu niais, l’ex-ado « élevé » par un terminator gentil. Car il va s’enfiler une poignée de pilules à stériliser les chiens.
Pendant ce temps, deux boules de métal surgissent du néant. L’une dans une vitrine de mode pour femme – et ce terminator évolué TX est une femme (féminisme oblige), un canon aux normes américaines, c’est-à-dire outrées (Kristanna Loken). L’autre terminator, plus néandertalien, le T850, est un homme, le nègre noir lui-même, Schwarzenegger en majesté musculeuse.


Ce troisième film ne joue pas dans la psychologie comme les deux premiers, mais dans les grands effets. Il reproduit sans vergogne les scènes cultes des films précédents : le terminator tout nu qui s’empare de vêtements de sa carrure, d’un véhicule qui lui correspond et d’une arme à sa taille (un riche tailleur cuir, une voiture de sport et un pistolet pour la femelle, un jean, tee-shirt noir et veste de cuir, pick-up V8 et fusil à pompe pour le mâle).


Et c’est parti ! La TX a pour mission de tuer une douzaine de futurs lieutenants de Connor, encore dans leur prime jeunesse. Ce qu’elle fait sans état d’âme puisqu’elle est une robote. Mais elle va vite dévier vers le plus croustillant, Connor lui-même, objectif numéro 1, qu’elle découvre par hasard dans le chenil de la clinique vétérinaire où la patronne qu’elle vise – qui n’est autre que Katherine une ex-petite amie du garçon (Claire Danes), l’a enfermé après lui avoir retiré son pistolet à billes, appelée à 4 h du matin pour un chata qui tousse. Un peu niais, l’ex-ado « élevé » par une mère maniaque des armes.
Heureusement, le terminator protector survient et empêche la maléfique de sévir. Il apprendra au jeune Connor, toujours largué, que c’est sa future femme, ex-petite amie de ses 13 ans, qui l’a reprogrammé pour le protéger dans le passé, après qu’il l’ait tué dans le futur (vous suivez ?).
L’intérêt filmique n’est pas là, mais dans les grands boums permanents, typiques de l’action vue par Hollywood, les poursuites spectaculaires en voiture, en moto, en camion, en engin de chantier, en corbillard, les fusillades interminables suivies d’explosions multiples – en bref du grand barouf populaire comme les Yankees adorent (ils croient que ça résout tout). Un camion grue va raser tous les poteaux d’une rue, un corbillard arrosé de balles qui ne touchent aucun passager à l’intérieur va raser son toit sous un camion pour déloger la TX qui attaquait le toit à la scie circulaire…


Une fois ce guignol assuré, place à l’histoire car il faut bien expliquer où l’on en est. Le général géniteur de la future femme de John est Robert Brewster (David Andrews), le père de Katherine Brewster, le maître de Skynet, un programme informatique de lancement de fusées de défense à têtes nucléaires. Skynet n’est pas encore relié au réseau, lequel plante à cause d’un « virus » impossible à éradiquer. Le chef d’état-major américain ordonne au général de relier Skynet à l’ensemble des réseaux civils et militaires pour assurer la Défense du pays, certain que Skynet balaiera le virus. Brewster hésite car il sait que Skynet contrôlera tout, sans plus aucune décision humaine. Mais ses supérieurs insistent, confiants, lui disant que lui Brewster contrôlera toujours Skynet…
Sauf que Skynet s’avérera « être » le virus, produit par les machines pour prendre le pouvoir sur l’humain. C’est donc de son geste fatal – la touche oui (Y) plutôt que la touche non (N) – que découleront les trois milliards de morts instantanés pulvérisés par les bombes H, et la vie souterraine en résistance durant des décennies contre les machines toute-puissantes qui s’auto-répliquent et apprennent en IA à devenir plus intelligentes.


Connor et son amie, aidés du terminator mâle, vont parvenir à la division Armes autonomes de la section des recherches cybernétiques de l’US Air Force (où ils entrent semble-t-il comme dans un moulin) et préviennent le général père qui, malheureusement, a déjà appuyé sur le bouton. Skynet prend aussitôt le pouvoir, la robote blonde à gros nichons sous cuir rouge le zigouille de quatre balles qui ne le tuent pas tout de suite, le temps de dire à sa fille où sont les codes et où ils doivent aller. Les robots militaires, stockés dans le centre de Défense, reprogrammé par la femelle machine du futur entrent en action et descendent tout le monde – sauf nos héros.


Lesquels vont parvenir en petit avion de tourisme à la base souterraine antinucléaire de Crystal Peak dans le Montana, où il vont pouvoir pénétrer in extremis en lisant le dossier de codes dans l’urgence, tandis que la robote les menace et que le terminator les protège encore un peu. Mais cette base n’est qu’une base de survie, elle n’est pas le centre de commandement qui permettrait de faire sauter les ordinateurs de Skynet… Car ce réseau Skynet s’est divisé en des milliers de terminaux informatiques dans le monde entier via le net, et ne peut ni être débranché, ni endommagé – il est toujours ailleurs. Ce pourquoi les Russes paranoïaques ont décidé de débrancher le réseau internet russe de celui du monde, voulant contrôler leurs propres missiles. Car le croyez-vous ? Skynet existe… et ce n’est pas une infox. Même Le Monde l’avoue (mais réserve la révélation à ses abonnés).
Il est 18h18 et c’est comme prévu le Jugement dernier (référence biblique obligée chez les Yankees). Voilà notre jeune couple improbable réuni, prêt à assurer la résistance de l’humanité et à faire des petits pour la perpétrer.
Bien inférieur aux premiers films, mais pas tourné par Cameron, ce tome 3 se laisse voir pour ses fusillades et poursuites, mais pas pour sa psychologie niveau zéro. La termineuse n’est qu’une poupée gonflable sans aucun intérêt, John Connor qu’un jeune imbécile et le terminator revenu de l’avenir qu’un pâle reflet du précédent modèle.
DVD Terminator 3 – le soulèvement des machines, Jonathan Mostow, 2003,avecArnold Schwarzenegger, Nick Stahl, Claire Danes, Kristanna Loken, David Andrews, Sony Pictures 2005, 1h45, €9,99, Blu-ray €16,73 (attention aux éditions Blu-ray, pas toujours doublées en français !)
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)
Terminator 1 et 2 déjà chroniqués sur ce blog









































































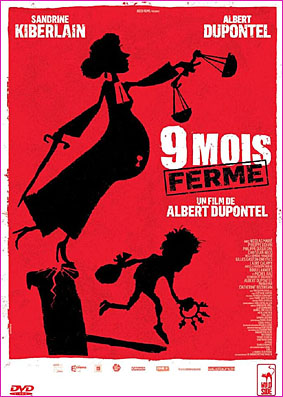




















































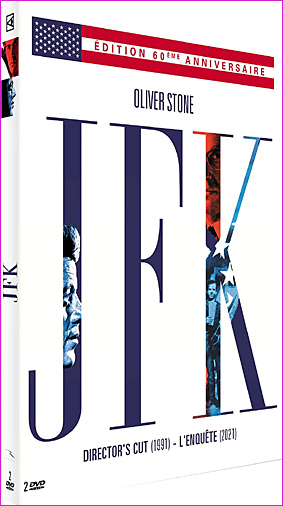































































































Commentaires récents