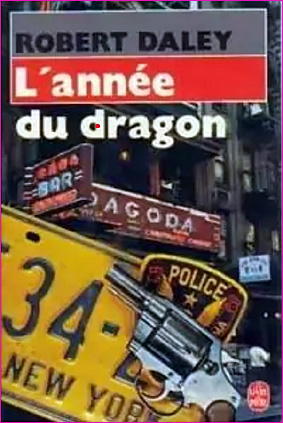
L’année du dragon, nous y sommes, c’est cette année ; la cinquième année d’un cycle qui revient tous les douze ans. L’auteur situe son roman policier en 1980, dans une New York confrontée à l’effervescence des communautés chinoises qui se développent. Un courant continu de très jeunes arrive clandestinement depuis Hong Kong, important les habitudes frustres de brutalité et de solidarité de clan. Les vieilles Triades (qui sont des mafias) avaient investi le jeu et sont poussées, par cette immigration avide, à se mettre à la drogue.
Chinatown connaît ses fusillades pour faire perdre la face et imposer le nouveau pouvoir. La police reste inerte, bien contente de laisser aux Triades le soin de réguler la communauté. Ne croyez pas que c’est de l’histoire ancienne ! Ce qui se passe dans nos cités françaises est exactement du même type : les mafias maghrébines trafiquantes font leur police et le pouvoir politique local est bien content de voir l’ordre assuré, en fermant les yeux volontairement sur les trafics. La route nationale du RN qui paraît si dégagée sur ces questions changera-t-il les choses ? Trop d’intérêts en jeu, je n’y crois pas une seconde.
A New York, un capitaine de police ne l’entend pas de cette oreille. Il est entré dans les forces de l’ordre pour le faire régner, et a pour croyance (sans doute naïve) que tous les Américains, quelle que soit leur origine, doivent bénéficier du même traitement par la loi. Pas question donc de tolérer l’embrigadement de gamins de 15 ans dans les clans de tueurs, recrutés dès la sortie de l’école où ils sont bizutés pour n’être pas de « vrais » Américains parlant l’anglais comme les autres. Pas question non plus de tolérer les règlements de compte entre bandes ou contre les commerçants.
C’est une fusillade perpétrée dans un grand restaurant chinois, par deux jeunes de 17 et 18 ans venus de Hong Kong, celui du « maire » de Chinatown Mr Ting, dans lequel dîne le capitaine Powers avec la journaliste de télévision Cone, qui va ancrer sa détermination. Il se fait nommer commissaire provisoire du district et met sous surveillance le nouveau parrain et « maire » Koy, qui prend un maximum de précautions. En effet, Koy a été policier à Hong Kong, ville alors très corrompue, et est parti avec plusieurs millions de dollars s’installer aux États-Unis où il a eu la patience d’attendre la durée nécessaire pour devenir citoyen sans faire parler de lui. Il s’y est marié une nouvelle fois, a eu deux enfants en plus du fils laissé à Hong Kong avec sa mère Orchid, de laquelle il n’est pas divorcé. Désormais, il veut lancer ses affaires en grand et, pour cela, importer de l’héroïne directement depuis le Triangle d’or thaïlandais où les « seigneurs de la guerre », anciens du Kuomintang refoulés par Mao, s’adonnent à la production d’opium base sur leur territoire.
Koy est sans scrupule moral, il ne voit que ses intérêts et use du « deal », comme le bouffon dangereux Trump, pour régler toutes ses affaires. Sauf que la « face », si importante pour un Chinois, risque de lui être retirée par le petit capitaine armé de sa seule détermination. Powers enquête, obstiné, se rend à Hong Kong où il manque de perdre la vie, pour acquérir des informations supplémentaires, met en jeu sa carrière face à des supérieurs sceptiques et jaloux. Contrairement aux grévistes vantards, lui « ne lâche rien ».
L’auteur, qui écrit très bien, a été commissaire délégué de la ville de New York en 1971 et 1972, et sait de quoi il parle. Il est aussi très sensible à la psychologie des gamins de 15 ans, tout comme à celle des bureaucrates de la police. Il entrelace ses actions d’une romance entre la journaliste Cone de 42 ans, qui passe chaque jour plus d’une heure à se refaire la façade et s’empresse de séduire tous ceux qui peuvent lui apporter un quelconque scoop, et le capitaine Powers de 46 ans, toujours amoureux de sa femme après 25 ans de mariage et de ses deux fils à l’université, mais qui se laisse enflammer pour la belle femelle médiatique.
L’intrigue est plutôt bien menée, dans une langue littéraire fort agréable et rare dans le roman policier américain. Le roman est puissant et rempli de passion : l’attirance sexuelle, mais aussi la ferveur de la quête, le culte de la vérité, la vénération de la morale.
En 1985, Michael Cimino en tirera un film plus caricatural sous le même titre, L’année du dragon, chroniqué sur ce blog.
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)
Robert Daley, L’année du dragon (Year of the Dragon), 1981, Livre de poche 1984, 543 pages, occasion €4,48



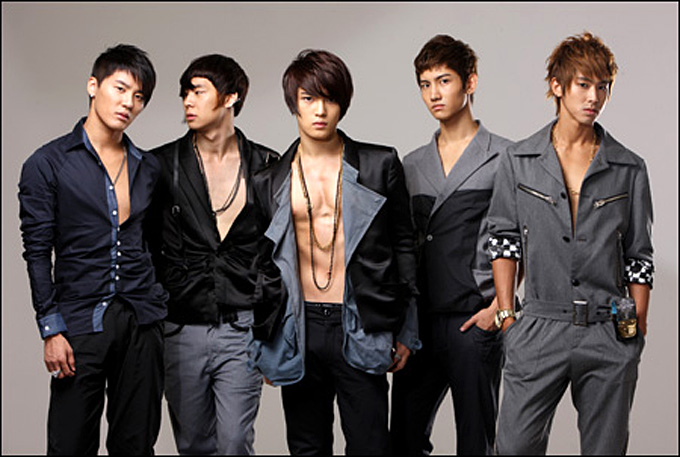


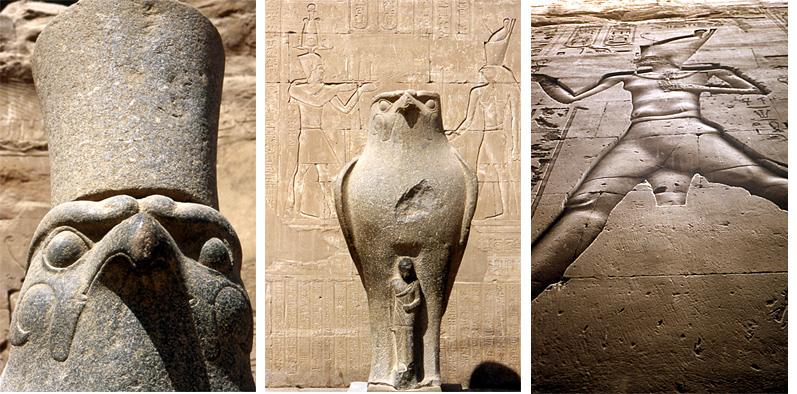

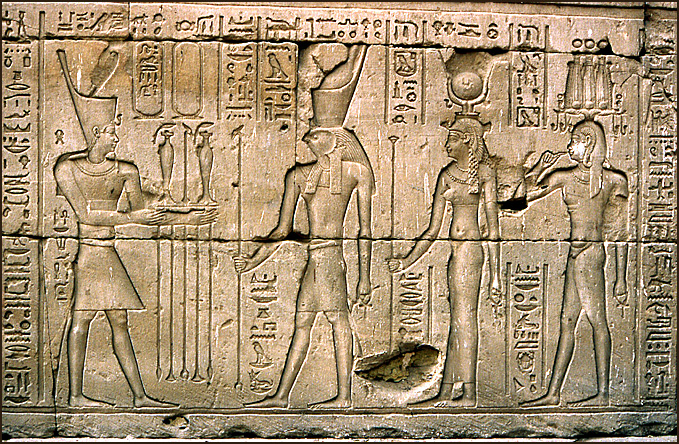


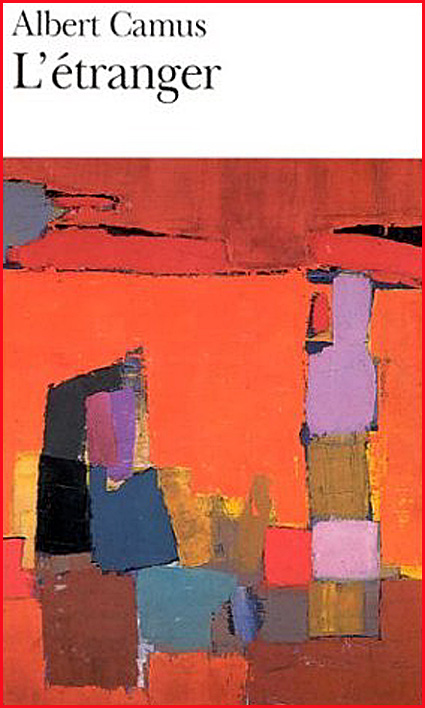


Commentaires récents