
La mode au début du XXe siècle était à la Pensée, la haute pensée néo-platonicienne, surtout lorsque l’on avait été élevé à lire le philosophe dans sa langue grecque originale. Rien d’étonnant à ce que les officiers, durant la Première guerre mondiale, aient tenu à conserver leurs habitudes de lecture et cherchent l’élévation de leur esprit. Ce « grand » roman d’amour part de la chair pour aboutir à la conscience émerveillée, par-delà la matière et le terrestre. Tout comme Platon prônait la voie philosophique en partant de la beauté immédiate des jeunes corps nus pour parvenir à la Beauté idéale, dans l’Absolu des Idées.
Trois personnages principaux dans cette aventure : Lewis Alison, officier marinier anglais fait prisonnier et assigné à résidence dans un château de Hollande, pays neutre ; Rupert von Narwitz, comte prussien grand blessé à la guerre ; et sa femme Julie, anglaise d’origine et ex-élève d’Alison en sa prime jeunesse. Le décor est froid, convenable, banal – hollandais. Un plat pays pour une platitude de pensée qui permet toutes les audaces des sens, des passions et de l’esprit.
Le roman expose en sept parties les étapes du cheminement de l’âme vers l’au-delà de l’amour, qui réunit le mari, la femme, l’amant, dans un nœud de relations qui les éprouve et les rend plus forts. Tout d’abord le fort, où Alison entreprend d’étudier le XVIIe siècle anglais pour en tirer un livre de réflexions. Ensuite le château de Hollande où il retrouve Julie, placée là par son mari pour la protéger de la guerre (et des Allemands puisqu’elle est d’origine anglaise). C’est ensuite la fuite, la tour, le lien, la fin – puis le commencement – car tout boucle.
Alison étudie, Julie tombe en amour, ils couchent ensemble, le mari gravement blessé revient, amputé du bras droit et le dos ravagé, les poumons atteints. Il mourra comme son pays au moment de l’Armistice inévitable en 1918 et de la fuite du Kaiser tandis que la révolution rouge gronde dans toutes les villes d’Allemagne.
Il y a coïncidence entre les grands événements de l’Histoire et ceux de la passion du trio dans la petite histoire. Le raisonnable anglais l’emporte sur l’idéalisme allemand, Julie étant le fusible par lequel passe les énergies, et qui est prêt de sauter. Mais chacun reste à une hauteur morale qui passera au-dessus de la tête de la plupart de nos contemporains, tout en accomplissant les gestes du plaisir que tous nos contemporains comprennent à loisir. Rien de bas, le drame est tout intérieur en chacun des trois.
Julie s’est mariée très jeune, pour quitter sa mère qu’elle exècre ; elle n’a jamais été amoureuse de Rupert, qui lui l’était d’elle, et le reste jusqu’au bout. Lewis avait de l’affection pour la fillette spontanée à qui il a donné des leçons en Angleterre lorsqu’elle avait 12 ans ; il la retrouve en femme et a le droit de l’aimer en adulte, ce qu’il ne manque pas de faire, mais sans s’empresser. Car Julie et lui se rencontrent et se nouent de façon naturelle, comme si cela avait été écrit de tout temps.
Alison cherche à se libérer de tout asservissement, mais les affaires le tiennent en Angleterre, la guerre le retient en Hollande, et l’amour qu’il éprouve le lie à Julie. « Il aspirait à se créer un sanctuaire que les tourments de l’existence journalière, les vents brûlants du désir, la crainte et l’ambition seraient impuissants à troubler » p.101.
Julie résiste à ce qui cherche à la contraindre : « Aucun scrupule de conscience, nulle crainte, nul désir d’observer la loi du mariage, ne lui avait dicté sa lettre, mais simplement la résistance intuitive à une invasion de son être » p.225. Ainsi récuse-t-elle dans un premier mouvement Lewis avant de succomber sous plus fort qu’elle.
Narwitz est triplement vaincu par le sort, en tant qu’Allemand prussien qui perd tous ses biens dans la guerre et ses traditions dans la révolution, la moitié de son corps par blessures multiples, et sa femme qui ne l’aime pas tout en le respectant. « Je songe à une aristocratie de l’humanité qui aurait la volonté et le courage de diriger, de fonder une tradition, et de la préserver » p.341, dit-il. « Nous nous forgeons des idoles : notre pays, notre foi, notre art ou notre bien-aimée, ce qui vous plaira, et nous déversons sur les genoux de l’idole toutes nos possessions spirituelles. Nous baptisons cela humilité ou amour. Tourguenieff dirait : sacrifice de soi. Nous refusons de nous agenouiller, si ce n’est devant des dieux créés par notre savoir, ou issus de nos rêves. Le vrai saint, le véritable philosophe, conclut Narwitz, sur un ton qui n’avait rien d’affirmatif, mais au contraire était plein d’un désir inassouvi, est celui qui peut s’agenouiller ans image devant lui, simplement parce qu’il se sait au second plan, et que agenouillement lui est moralement nécessaire » p.368. Ce qu’il accomplira en vivant sa Passion christique jusqu’au bout de la souffrance et du renoncement.
Les amants ne couchent plus ensemble dès qu’il revient et Alison trouve en Narwitz un maître spirituel. Ils sont amis. Chacun, au contact de l’autre, se trouve transformé. Ils voient en leurs différences comme au travers, une beauté absolue qui les appelle, un amour sublimé qui les transcende. « Rupert a pris sur moi le plus profond ascendant, dit Julie, et sur Lewis aussi. Ce que nous sommes à présent, nous le sommes par lui, et ce que nous deviendrons sera également son œuvre » p.388.
C’est comme un éveil bouddhiste, un émerveillement. « Ce que nous avons appelé jusqu’ici omniscience, il est préférable de l’envisager comme une infinie puissance d’émerveillement. Le savoir est une qualité statique, une pierre dans un torrent, mais l’émerveillement est ce torrent même » p.425.
Un amour qui rend supérieur, partant des sens pour élever l’âme de chacun des protagonistes, et Rupert qui, sur son lit de mort joint les mains de Julie et de Lewis pour qu’ils vivent meilleurs après lui.
Prix Hawthornden 1932
Charles Langbridge Morgan, Fontaine (Fountain), 1932, Livre de poche 1962, 499 pages, occasion €5,90
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)
Les romans de Charles Morgan déjà chroniqués sur ce blog









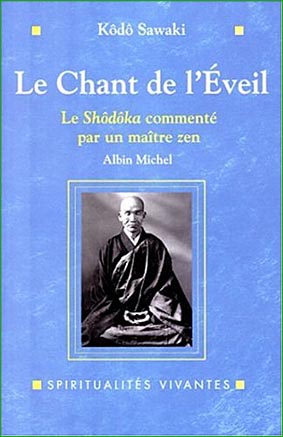










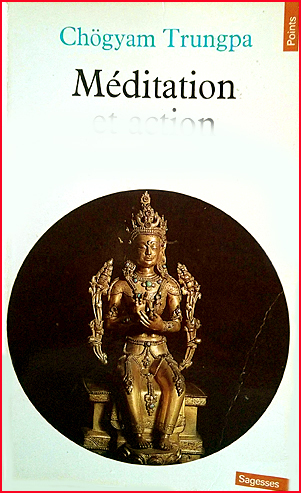












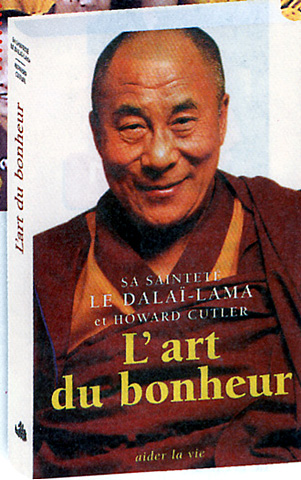
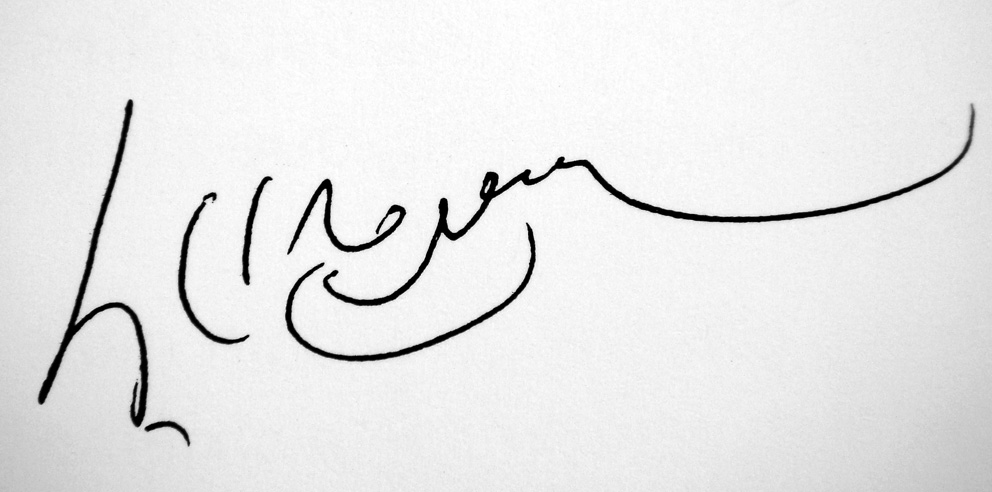

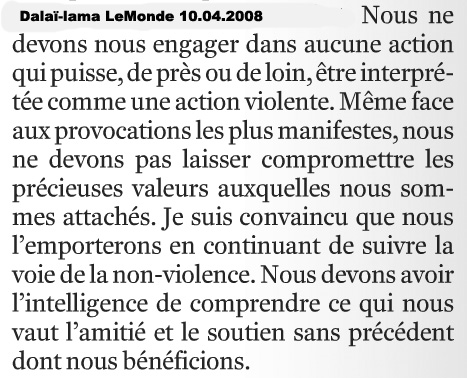

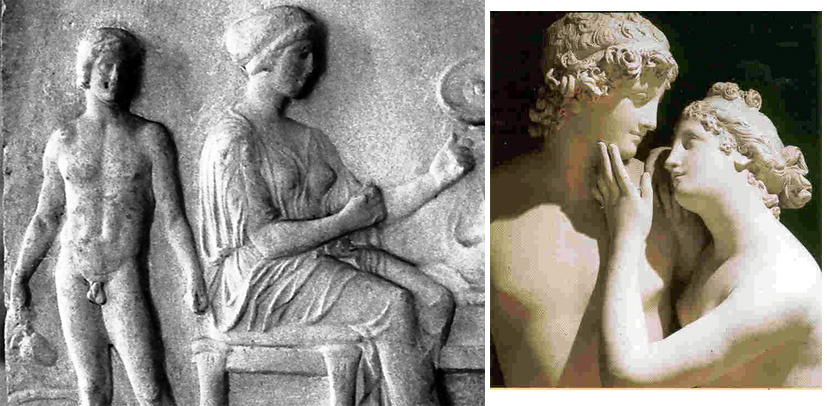

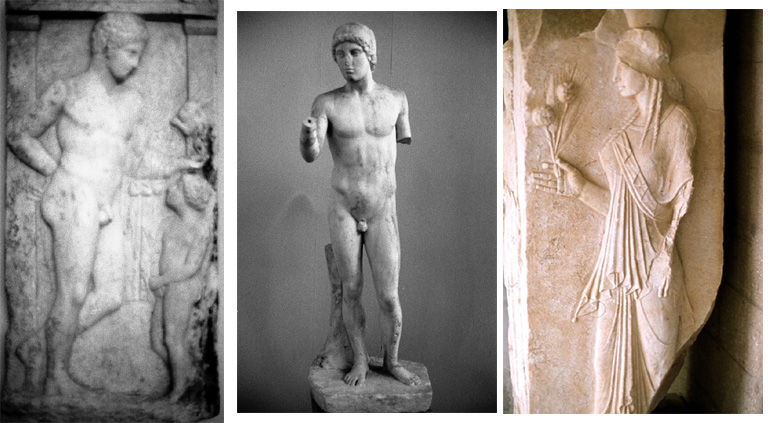






Commentaires récents