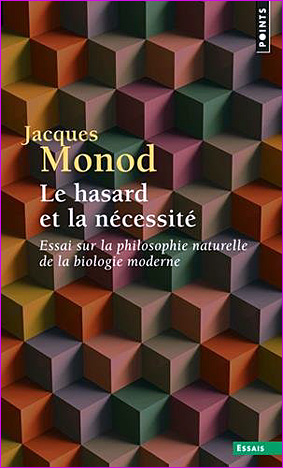
C’est l’un des mérites éminents de Jacques Monod, dans ce vieux livre paru il y a cinquante ans et que j’ai lu à sa sortie, Le hasard et la nécessité, d’avoir défini avec clarté et précision pour les années 1970 la nature de l’évolution du monde vivant. S’appuyant sur les connaissances scientifiques établies, le professeur a pu affirmer que la naissance et l’évolution de la biosphère sont dues au hasard et obéissent aux lois mathématiques des probabilités. La biosphère est création, mais une création absolue à chaque instant, suivant les lois du hasard et de la nécessité, pas celle d’un Projet.
Il y a nécessité dans le dogme de l’invariance génétique. Le patrimoine génétique conditionne l’individu physiologiquement. L’intelligence, qui ne peut exister sans support biologique, se trouve elle aussi conditionnée par le code génétique. Mais pas absolument, comme se déroule un programme d’ordinateur : le code détermine un faisceau de potentialités qui seront plus ou moins révélés, puis développées par le milieu de vie. Nécessité aussi dans la sélection naturelle des plus aptes à répondre avec efficacité et souplesse aux exigences d’un milieu changeant : génétiquement (ceux qui résistent à la grippe par exemple) et culturellement (elle permet une meilleure hygiène de vie et des conditions sociales plus favorables). Ainsi des « pestes » médiévales, qui faisaient mourir la moitié de la population, tandis que l’autre moitié parvenait à s’en sortir.
Il y a hasard dans les actions téléonomiques qui ont pour but la survie et la reproduction. Hasard dans la fécondation : un spermatozoïde sur plusieurs millions parviendra seul à féconder l’ovule. Hasard dans les mutations génétiques dues à des perturbations du mécanisme d’invariance, perturbations dues elles-mêmes au hasard des combinaisons.
Contingence fondamentale et développement programmé alternent. Une structure vivante apparaît par hasard, qui se développe suivant des règles nécessaires, jusqu’à une nouvelle étape où le hasard intervient. Imaginons un train lancé à grande allure et orienté par des aiguillages, dans l’entrecroisement des voies innombrables. L’aiguilleur est une roue de loterie, le train est l’être vivant et la locomotive la nécessité.
De ce fait découle une constatation : la biosphère évolue vers une complexification et vers une individualisation de plus en plus grande. L’être vivant mute et sélectionne ses avatars vers plus de puissance et de souplesse, de moins en moins spécialisé, de plus en plus ouvert, néoténique, capable d’apprendre. L’homme, être le plus complexe de la planète, possède des potentialités originales, notamment la conscience du néocortex. Sans elle, il ne serait qu’un corps faible et nu, guère capable de survie face aux prédateurs. Mais parce qu’il est doté d’intelligence et d’un sens de la collectivité, il survit fort bien et domine le monde animal. Il est capable de mémoriser et de transmettre ses expériences, ajoutant à ses gènes une banque de données extérieures, accessibles par l’apprentissage.
Une conséquence : l’homme est désormais apte à agir sur le cours de l’évolution.
Il peut le faire de façon positive. Par la manipulation du code génétique afin d’éviter les tares et déficiences héréditaires, voire par un eugénisme contrôlé et éthique à grande échelle, pour éviter que se reproduisent les gènes conduisant au mongolisme par exemple. Mais surtout par la mise en réseau du savoir, l’éducation à la recherche, la formation du caractère pour explorer et découvrir. Les gènes ne sont pas tout, la révélation de leurs potentialités aussi, qui passe par un milieu favorable, nourriture, apaisement, stimuli, apprentissages, émulation sociale, culture.
Il peut se faire de façon négative. Par le métissage généralisé qui appauvrira le patrimoine global de l’humanité. Par l’interdiction de tout métissage qui augmentera le taux de consanguins et éliminera peu à peu les gènes inutiles à un milieu étroit. Toute modification du milieu ferait alors mourir une grande part des inadaptés. Par l’institutionnalisation des comportements, car ils sont des ‘pressions de sélection’. Les caractères acquis ne se transmettent pas par l’hérédité, les comportements se transmettent par l’éducation. Ils favorisent l’évolution des mentalités vers ce qui est considéré comme meilleur ou mieux adapté au milieu, à l’époque, à la société. Ainsi l’éducation au climat, au respect homme-femme, à la protection des enfants.
Chaque individu est unique en son genre, résultat effectif et éphémère des milliards de milliards de combinaisons génétiques humainement possibles. A lui seul, l’individu représente un faisceau unique de potentialités possibles : il est l’une des chances de survie de son espèce et l’une des chances de la vie en général. C’est pour cette raison que chaque individu est, au fond irremplaçable, et en quelque sorte « sacré ». Il est une expérience qui ne sera jamais plus, une combinaison dont la probabilité de réapparition est pratiquement nulle.
C’est parmi cette diversité que s’élaborent les êtres futurs, produits de l’évolution (biologique et culturelle) : parmi une multitude de combinaisons perpétuellement renouvelées et en mutations constantes. Combien d’expériences avortées sur celles qui ont réussi ? La nature est prodigue, sa richesse est infinie, mais elle a besoin de cette richesse pour que l’évolution poursuive son dynamisme. Une restriction dans la diversité et c’est une part du capital qui disparaît irrémédiablement. Cela vaut pour les hommes comme pour les bêtes et pour les plantes, ce pourquoi l’écologie est nécessaire à la survie humaine. Il n’y a pas de bon ou de mauvais gène, il n’y a que de bonnes et de mauvaises combinaisons, disent les généticiens. Danger de l’eugénisme et du génocide…
L’homme peut manipuler le code génétique, il peut à son gré décider de restreindre la diversité des gènes ou encourager les mutations au hasard. Mais l’homme peut jouer à l’apprenti sorcier : créer des monstres ou des êtres trop spécialisés. Son sort se trouve aujourd’hui entre ses mains. Accroître sa puissance, c’est chercher à réaliser au mieux le potentiel génétique de chacun, augmenter ou préserver la richesse génétique des générations suivantes. L’avenir dira, au vu des conséquences, s’il a bien ou mal usé de sa liberté.
Plus que jamais la démocratie est nécessaire. Puisque chaque individu n’existe qu’à un seul exemplaire, chance unique de l’évolution, autant qu’il ait son mot à dire sur le présent et l’avenir de l’espèce. Il doit pouvoir défendre et transmettre le patrimoine génétique comme le patrimoine culturel original dont il est le résultat en même temps que le dépositaire transitoire. Il doit décider librement des pressions de sélection au pouvoir de sa conscience et de sa volonté.
Jacques Monod, Croix de guerre et Médaille de la Résistance en 1945, a obtenu le prix Nobel de médecine 1965 pour ses travaux sur la biologie moléculaire. Il a notamment mis au jour le rôle fondamental de l’ADN, code génétique transcrit par l’ARN messager pour produire les protéines. Mais jamais le messager n’altère le code : la transcriptase inverse de certains rétrovirus n’est pas la traduction inverse de l’ARN en ADN mais une enzyme qui permet de faire comme si. Ce livre, bien que datant d’il y a un demi-siècle, devrait faire réfléchir les ignorants qui préfèrent « croire » au Complot des « vaccins » qu’à la réalité qui permet sans toucher l’ADN d’augmenter les défenses immunitaires NATURELLES de l’organisme. Jacques Monod est décédé en 1976.
Jacques Monod, Le hasard et la nécessité : : essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne, 1970, Points Seuil 1973, 244 pages, €6.10 e-book Kindle €8.49

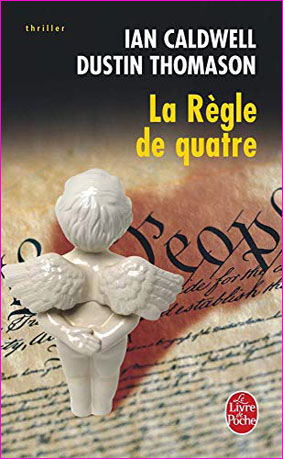
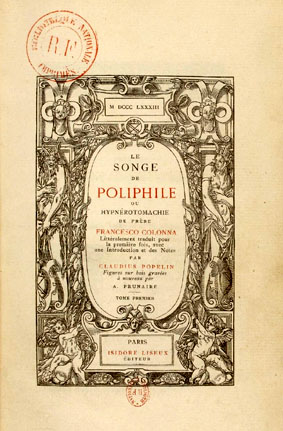


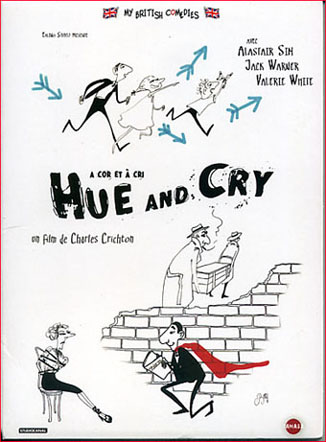






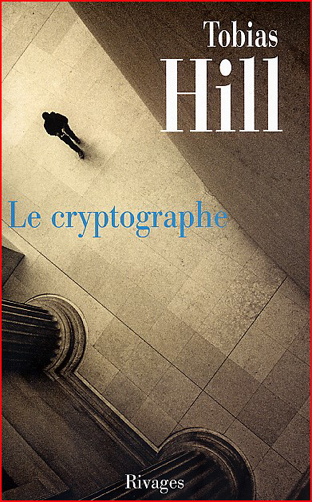


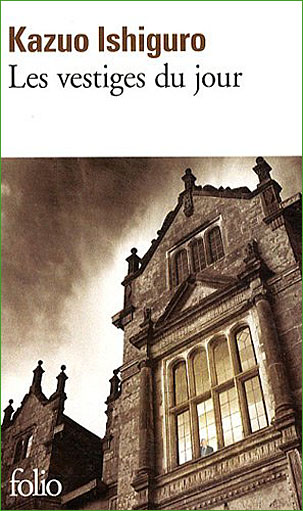





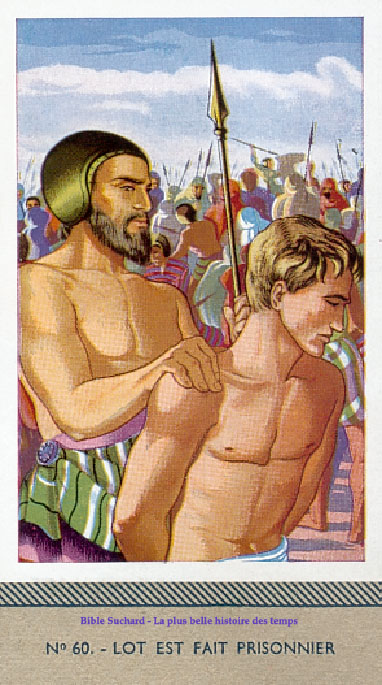







Commentaires récents