Ainsi parlait Zarathoustra est un poème prophétique à vocation philosophique. Mieux qu’un essai aride ou qu’un recueil d’aphorismes ou d’imprécations, il met en ordre la sagesse au marteau. Dans ses Discours, en première partie, Zarathoustra – avatar de Zoroastre, le prophète de la lumière essentielle – disserte sur la vertu. Elle fait bien dormir, constate-t-il en allant écouter un « sage » qui profère de bons conseils de développement personnel.
Ce soi-disant sage « était comblé d’honneurs et de récompenses » car il faisait bien dormir, apaisait l’âme et donnait bonne conscience. « Tous les jeunes gens, disait-on, se pressaient autour de la chaire où il enseignait » – car il était à la mode et la mode attire la jeunesse, avide de modèles.

Que disait le fameux sage ? « Honneur et respect au sommeil. C’est le principe de toutes choses. » En gros dormez, bonnes gens, le pouvoir s’occupe de vous, vous n’avez rien à faire, rien à penser, uniquement à jouir. « Ceux qui dorment mal et qui veillent la nuit » sont à éviter comme la peste. Ils analysent, ils surveillent, ils critiquent. Ils vous tourmentent de libertés et de principes, ils ne sont jamais contents et voient le pouvoir dans sa nudité et ses excès. « Ce n’est pas une petite chose que de savoir dormir », souligne avec une lourde ironie allemande Nietzsche. « Il faut commencer à veiller tout le jour », et c’est fatiguant : se surmonter, se réconcilier, découvrir dix vérités, rire. « Peu de gens savent cela, mais il faut savoir toutes les vertus pour bien dormir. »
C’est la bonne conscience qui apaise, l’esprit tranquille de qui a répondu aux commandements, la soumission de l’obéissant. « Paix avec Dieu et ton prochain, ainsi le veut le bon sommeil. (…) Honneur et obéissance à l’autorité, même à l’autorité cagneuse ! Ainsi le veut le bon sommeil » Et tant pis « si le pouvoir aime à marcher sur des jambes torses » – après tout, « est-ce ma faute ? » – Oui, ça l’est. Un peuple n’a que les dirigeants qu’il mérite. Or il ne faut pas réclamer trop mais se contenter de ce qu’on a, prône le professeur de vertu. « Je ne veux ni beaucoup d’honneurs, ni de grands trésors : cela échauffe la bile. Mais on dort mal sans une petite renommée et un petit trésor. »
Nietzsche vilipende le petit-bourgeois allemand dans toute sa splendeur hédoniste de vache à l’étable, qui regarde passer les trains en ruminant tranquillement. Rien ne vaut une bonne digestion ! « Je prends grand plaisir aussi aux pauvres d’esprit : ils favorisent le sommeil. Ils sont bienheureux surtout quand on leur donne toujours raison. » Ici, la cible est le christianisme et les « pauvres d’esprit » de l’Évangile, ceux qui croient naïvement, avec la foi du charbonnier. Ils ne doutent jamais, ils dorment à merveille. Surtout quand on est toujours d’accord avec eux – cette scie des réseaux sociaux qui aiment à faire dormir en bande – alors que le débat est l’essence même d’une démocratie vivante !
Le sommeil est « le voleur (…) qui me vole mes pensées » car, comme un baume, il apaise et rend somnolent, prêt à tout accepter sans réfléchir. Par fatigue de vivre. « Un tel sommeil est contagieux », dit Zarathoustra. Car la vertu (ou la morale, qui est la vertu socialement recommandée) endort ; elle évite de penser par soi-même et d’examiner ce qui est bon ou mauvais à l’instant précis. La vertu édicte des règles simples, que la morale rend universelles et que la religion impose par peur de l’au-delà. Et qui en profite ? – Le pouvoir : ceux qui manipulent les règles et les vertus, dont la morale est relative à leurs intérêts, dont la religion sert à terroriser (Poutine, Khomeiny, Xi Jin Ping et ainsi de suite).
« A présent je comprends ce que jadis on cherchait avant tout, lorsqu’on cherchait des maîtres de la vertu. C’est un bon sommeil que l’on cherchait et des vertus couronnées de pavots ! ». Une plante qui endort et enivre, évitant d’être soi et d’agir… « Bienheureux ces somnolents : car ils s’assoupiront bientôt », prophétise l’auteur.Et Hitler le magnétique saura endormir les vertus petite-bourgeoises allemandes pour y substituer les siennes propres, rendre tout le monde aryen d’accord, réconcilié en race supérieure à toutes, avec dix vérités alternatives par jour. Et les pauvres d’esprit, ainsi enfumés, croiront avec la foi du charbonnier qu’ils sont les meilleurs et les élus, et ils feront la guerre comme un seul homme, et ils suivront les chefs en chantant la victoire, ces invincibles… qui furent vaincus.
Combien d’autres pouvoirs aujourd’hui incitent-ils à dormir sur ses deux oreilles en toute bonne conscience ? Paix avec Trump ou Poutine, Erdogan ou Xi – ainsi le veut le bon sommeil.
(J’utilise la traduction du livre de poche 1947 de Maurice Betz qui est fluide et agréable ; elle est aujourd’hui introuvable. La polémique sur les « traductions » sont une façon de toujours contester la parole écrite. Or Nietzsche n’est pas Hegel, il écrit clair, « au marteau » ; les nuances de traduction importent moins que d’autres à son message).
Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, 1884, traduction Geneviève Bianquis, Garnier Flammarion 2006, 480 pages, €4,80 e-book €4,49
Nietzsche déjà chroniqué sur ce blog


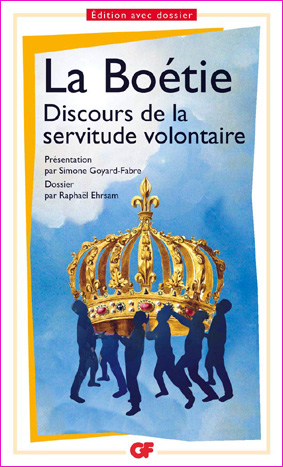











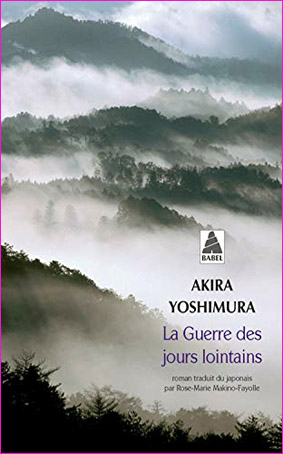









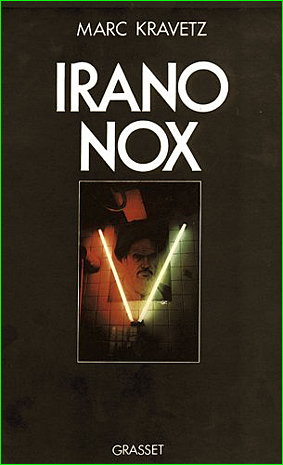

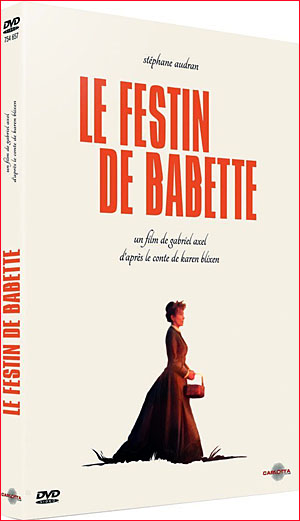









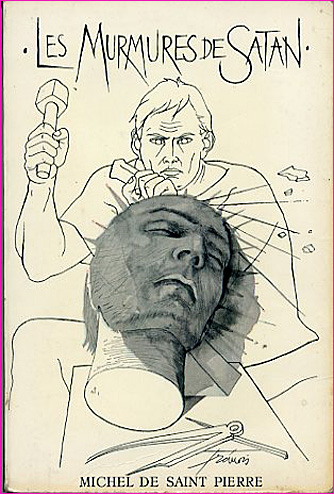



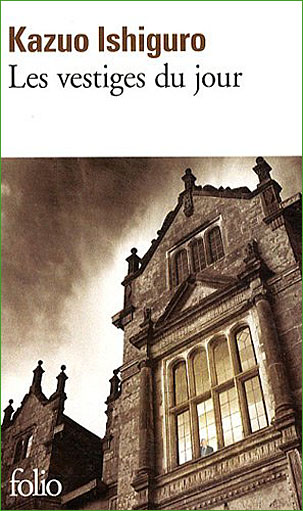
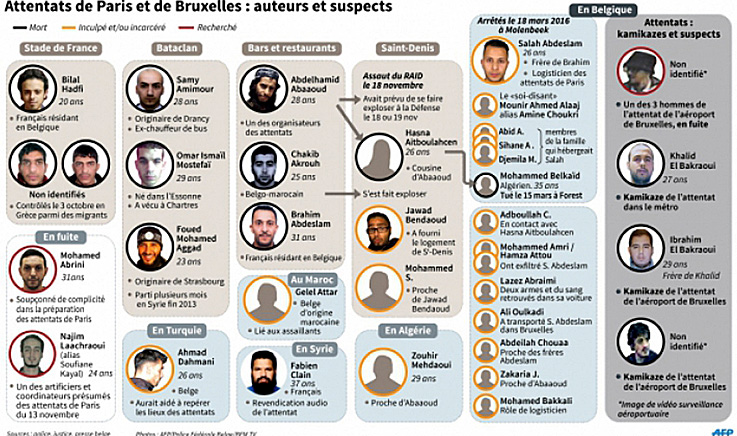



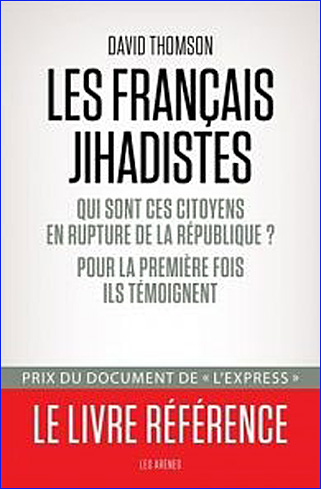





















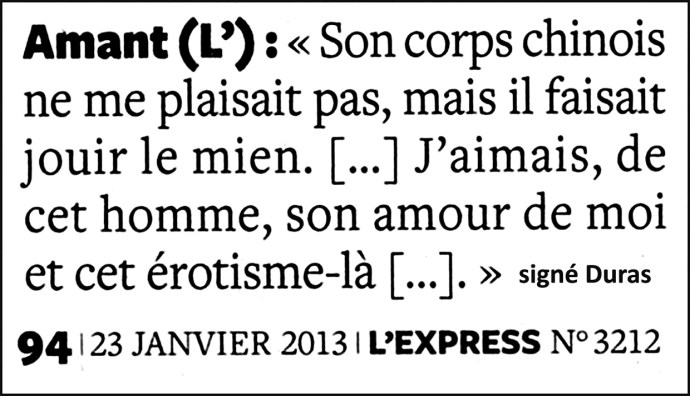
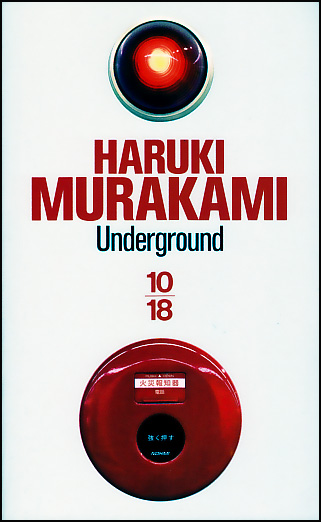

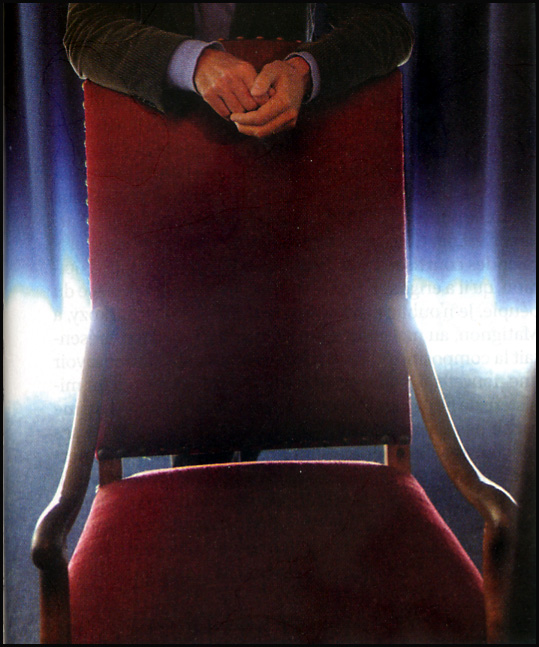

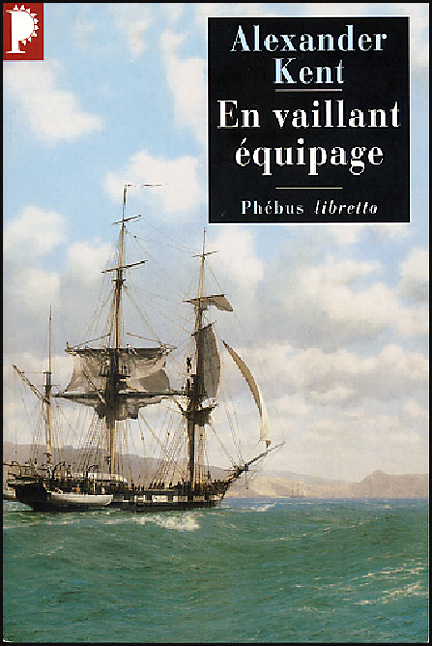




Commentaires récents