
Parce qu’il est décédé en 1996 et qu’il décrit les années 50 et 60, Hervé Bazin est bien oublié aujourd’hui. Il aborde pourtant les questions cruciales de la famille et des relations humaines, ici la paternité. Il a eu sept enfants, garçons et filles, dont cinq avant la parution du roman, écrit à 48 ans. Il sait donc ce que c’est d’être père.
Daniel Astin est docteur ès lettres mais n’a pas passé l’agrégation ; il obtient cependant un poste de professeur de français au collège de Villemomble. Marié avec Gisèle, l’amour de sa vie, il ont eu deux enfants, des jumeaux, Michel et Louise. Puis est venue la mobilisation de 1939, la guerre éclair et la défaite ; Daniel est prisonnier en Allemagne jusqu’en 1945. Lorsqu’il revient, sa femme est morte dans un bombardement et sa belle-mère Mamette rescapée, handicapée des jambes ; les enfants, comme leur tante Laure, sont indemnes. Mais la famille compte un garçon de plus, Bruno, né en 1940, probablement pas de lui.
C’est donc un père veuf qui doit faire avec le destin et élever les trois enfants de 8 et 5 ans jusqu’à leur majorité. Il est aidé par Laure, leur tante qui s’est attachée à eux et qui habite juste en face avec Mamette, eux côté pair, elle côté mair comme disent les gamins. A 20 ans, elle n’a pas de vie personnelle ; elle fait la navette entre les deux maisons pour cuisiner, laver, doucher et raccommoder la nichée et le mari qui travaille. Pour les enfants, elle est leur mère d’adoption ; pour Daniel, une tante dévouée et une bonne. Car Daniel Astin n’éprouve pas pour elle d’amour, juste de l’attachement ; il aime une Marie, condisciple de faculté et prof de lettres comme lui, qu’il retrouve après-guerre dans son collège (on disait lycée à l’époque). Ils se voient souvent, finissent par coucher ensemble, elle vierge encore à 40 ans. Mais les enfants ne l’apprécient pas, pas question de se marier – quand on est père, on se doit aux enfants d’abord. Et quand il se seront envolés du nid, ce qui arrive assez vite, il sera trop tard. Daniel se mariera avec Laure – naturellement.
Le problème de Daniel Astin est le petit dernier, Bruno. Il pressent qu’il n’est pas de lui et en aura confirmation aux 17 ans du garçon, au vu de sa carte de donneur de sang – les groupes sont héréditairement incompatibles. Gisèle avait en effet travaillé comme secrétaire d’un homme politique juste avant-guerre et elle découchait souvent. A 11 ans, Bruno est insupportable, rebelle, il a de mauvaises notes en sixième. Un zéro en français fait déborder le vase : comment peut-on avoir zéro en français ? Daniel est en colère et le gamin, qui faisait sa gymnastique du matin, prend peur. « Le petit fuit devant moi, pieds nus et torse nu » – telle est la première phrase du livre. Cette vulnérabilité et cette vitalité mêlée émeuvent plus le père que les regards curieux et juges des voisins et voisines qui clabaudent. Les fuites de Bruno devant son père sont de plus en plus fréquentes. « Veux-tu donc faire croire à tout le monde que je te brutalise, que je n’aime pas mes enfants ? (…) – Tu m’aimes, bien sûr, mais tu m’aimes moins » p.17
C’est la révélation de l’inconscient pour le père. Bruno n’est pas de lui et il le délaisse, sans vraiment le vouloir ; il fait son devoir, mais sans plus. Les jumeaux aînés sont plus brillants, à 13 ans Michel est bon élève, sportif et bûcheur, sûr de lui et sans problèmes – il réussira Polytechnique ; Louise vit sa puberté comme une chatte, affective et dénudée – elle ratera trois fois son bac et deviendra mannequin à succès. Bruno se sent comme le vilain petit canard. Dès lors, cette scène primitive va changer Daniel. Cet enfant qu’il n’a pas fait, pas voulu, il va devoir l’adopter, l’apprivoiser. Cela prendra plusieurs années mais un véritable attachement naîtra entre eux, plus qu’avec les autres. Bruno sera « le » fils, celui qui a le plus besoin et dont on prend un meilleur soin. Mamette et Laure approuvent, elle trouvent que Daniel Astin est un « homme bien ». Il sait faire avec ce que le destin lui donne.
Le meilleur sont les vacances, passées en bord de Loire à l’Emeronce, propriété qu’Hervé Bazin occupe lors de l’écriture du roman. Les enfants y sont au naturel, sans les contraintes de l’école, des transports, des copains et des vêtements. « Nymphe un peu dégoûtée et surtout soucieuse d’extorquer de l’ambre au soleil, Louise fredonne et pigeonne, sans cesse rajustant son pointu soutien-gorge. Michel, ce bel éphèbe dont le caleçon de bain n’altère pas l’éternel sérieux, accorde toute son attention aux bouées du grand chenal. (…) Bruno, quasi nu, scrute le secteur avec une attention d’Indien maigre, comme si en dépendait sa subsistance » p.87. Ils ont 16 et 13 ans. La barque chavire car tous se penchent d’un coup du même côté pour voir les barbillons. Le père laisse Michel nager, il sait très bien, Louise se dépatouiller, elle est assez grande, et attrape Bruno, le petit dernier. Pourtant, il sait un peu nager. « Il a pris le plus près », excuse Laure ; il a sauvé le coucou, pense la grand-mère. Bruno sait dès lors que son père l’aime autant et plus « moins » que les autres, comme il le disait. Il est devenu vraiment son fils. Mamette résumera un peu plus tard : « On déteste les épinards, on se force, on s’habitue, on y prend goût, on ne veut plus que ça… » p.178 Astin le narrateur dira : « En Bruno, j’ai accepté, puis découvert puis exalté un fils » p.190.
L’émotion affleure dans cette page où Daniel parle de la paternité contre M. Astin le pédagogue : « C’est mieux qu’il ne me soit rien, qu’il soit le champi, le gratuit, et en même temps ce qu’il m’est. (…) Il m’était réservé de l’être comme je le suis de toi, petit, il m’était réservé d’être cet homme qui, des années durant, s’est trouvé enceint de ta tendresse, qui, des années durant, forçant la nature, dû accoucher de toi. Non, tu n’es pas de mon sang. (…) Tu n’as pas mon sang, tu as eu plus : la filiation de la dilection. Aucun être sur terre ne m’a tant fait souffrir ni tant donné de joie. Aucun n’est plus proche de moi. Aucun, surtout, ne m’a mieux reconnu. (…) Nul n’est vraiment père que son fils n’a reconnu pour tel » p.288. Pourtant, il faudra qu’il accepte de voir ce fils se détacher de lui en passant un concours, se mariant, faisant un bébé. C’est la loi de nature. Maladroit, passionné, scrupuleux, Daniel Astin est touchant et grave.
Aujourd’hui la bâtardise n’est plus aussi socialement méprisée, les familles « recomposées » font des paternités multiples ; mais le lien demeure, plus ou moins fort selon qu’il y a besoin – ou envie. Être père n’est pas de nature, mais de culture. C’est un choix réciproque, un apprivoisement qui se transmute en affection, puis en lien filial.
Hervé Bazin, Au nom du fils, 1960, Livre de poche 1978, 381 pages, occasion €0,01
Hervé Bazin, Portraits de famille – Vipère au poing, La tête contre les murs, Qui j’ose aimer, Au nom du fils, La matrimoine, Omnibus 2011, 1184 pages, €28,00
Les romans d’Hervé Bazin déjà chroniqués sur ce blog













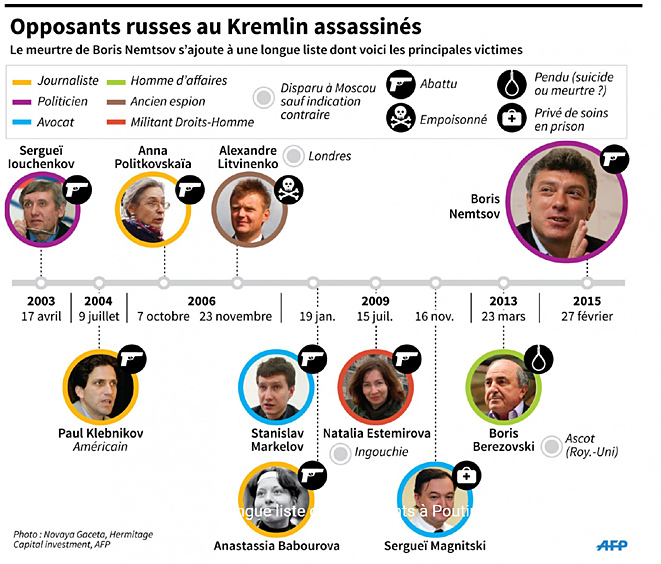 religion
religion














































































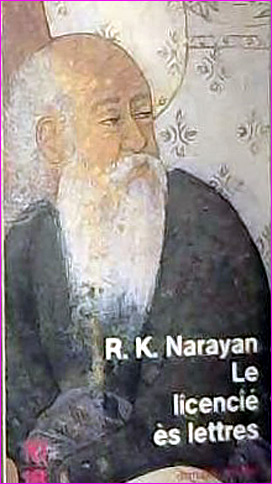










































































Commentaires récents