Frédéric Nietzsche était européen bien plus qu’allemand ; il exécrait tous ces braillards nationalistes ou antisémites, trop peu sûr d’eux-mêmes pour être forts. Le bouc émissaire est toujours le choix des faibles, de ceux dont « le système digestif » est fragile. Mais ce qu’il constate dans Par-delà le bien et le mal (1886) est ambivalent : une humanité positive qui dépasse les étroites nations – mais une humanité trop flexible, démocratique et bavarde, qui pourra aspirer à un tyran. Et il n’avait pas encore entrevu mai 68…
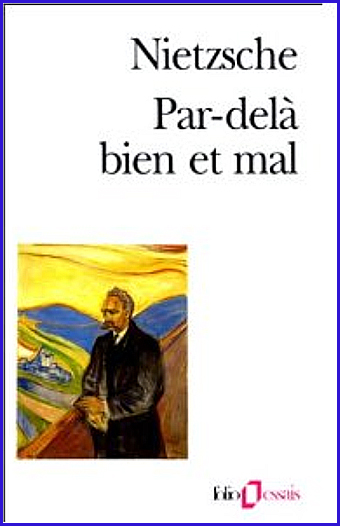
« Les Européens commencent à se ressembler tous ; ils se détachent graduellement des conditions qui font naître des races liées au climat et aux classe sociales ; ils s’affranchissent de plus en plus de tout milieu défini qui pourrait, au cours des siècles, imprimer aux âmes et aux corps des besoins identiques. Ce qui s’accomplit, c’est donc le lent avènement d’une humanité essentiellement supranationale et nomade, qui physiologiquement présente comme trait distinctif un maximum de don et de puissance d’adaptation. (…)
» Et d’autre part, dans l’ensemble, ces Européens de l’avenir se présenteront sans doute comme des travailleurs bons à tout, bavards, de volonté débile et extrêmement adaptables, qui auront besoin d’un maître, d’un chef, autant que de leur pain quotidien : la démocratisation de l’Europe tendra donc à produire un type d’hommes préparés le plus subtilement du monde à l’esclavage, mais dans des cas isolés et exceptionnels le type de l’homme fort ne pourra que devenir plus fort, plus prospère et plus riche qu’il ne l’a jamais été, grâce à son éducation libre de préjugés, grâce à la prodigieuse diversité de ses activités, de ses talents et de ses masques. Ce que je veux dire, c’est que la démocratisation de l’Europe est aussi l’une des causes qui concourent involontairement à former des tyrans, le mot pris dans toutes ses acceptions, même dans la plus spirituelle. » §242 Aristote n’avait pas écrit autre chose en disant que la démocratie glisse volontiers à la démagogie, quand des politiciens agitateurs cyniques manipulent des citoyens ignorants mal éduqués. Et que la démagogie aboutissant à l’anarchie, le retour du bâton arrive très vite avec la tyrannie.
Nietzsche a eu, un demi-siècle avant, la prescience de Mussolini, d’Hitler et de Staline : « Ce siècle est le siècle des masses ; elles sont à plat ventre devant tout ce qui est ‘massif’. Qu’un homme d’État leur construise une nouvelle tour de Babel, un monstrueux empire à la monstrueuse puissance, ils l’appelleront ‘grand’. Qu’importe que nous, plus prudents et plus réservés, nous n’ayons pas encore renoncé à notre vieille croyance que seule la grande pensée fait le grand acte ou la grande cause ! » §241. Nietzsche n’aurait certainement pas adhéré au parti nazi ! Il l’aurait trouvé trop plébéien, trop ‘massif’, sans aucune ‘grande pensée’.
Mais il sentait en Allemagne les prémices d’un désir de dominer. « Parmi les peuples de génie, on distingue ceux auxquels est élu le lot féminin de la gestation et la tâche secrète de modeler, de mûrir, de parachever ; les Grecs étaient un peuple de cette espèce, pareillement les Français ; les autres qui se sentent appelés à engendrer, et à implanter dans la vie un ordre nouveau ; tels les Juifs, les Romains et, je pose la question en toute modestie, peut-être les Allemands » §248.

Pourquoi les Allemands ? Parce que trop récents comme nation, trop peu sûr d’eux-mêmes, trop peu de Kultur, au fond. « Peuple fait du plus prodigieux mélange et d’une macédoine de races, peut-être même avec une prépondérance d’éléments pré-aryens, ‘peuple du milieu’ dans toutes les acceptions du terme, les Allemands sont de ce fait plus inconcevables, plus amples, plus contradictoires, plus inconnus, plus déconcertants et même plus effrayants que d’autres peuples ne s’imaginent l’être. »
Il voyait les Russes comme plus ‘barbares’, ce qui est chez lui un compliment : doués d’une plus forte volonté de puissance. Cette endurance primitive a d’ailleurs fait l’essentiel de la victoire contre les armées allemandes pendant et après Stalingrad.
Nietzsche admirait les Juifs, contre la majorité de ses compatriotes… « Ce que l’Europe doit aux Juifs ? Beaucoup de bien, beaucoup de mal, et surtout ceci, qui relève du meilleur et du pire, le grand style en morale, la majesté redoutable des exigences infinies, des symboles infinis, le romantisme sublime des problèmes moraux, c’est-à-dire ce qu’il y a de plus séduisant, de plus capiteux, de plus exquis dans ces jeux de couleurs et ces séductions dont le reflet embrase aujourd’hui le ciel et notre civilisation européenne (…) Nous qui parmi les spectateurs sommes des artistes et des philosophes, nous éprouvons à l’égard des Juifs – de la reconnaissance. » §250
Ce qu’il détestait le plus, comme culture en Europe, était l’anglaise. Moins les individus que l’ambiance, la façon d’être. « L’Anglais, plus sombre, plus sensuel, plus énergique et plus brutal que l’Allemand, le plus vulgaire des deux, est pour cette raison plus pieux que l’Allemand ; c’est pour cela que le christianisme lui est encore plus nécessaire. Pour des narines tant soit peu délicates, ce christianisme anglais conserve un relent bien britannique de spleen et d’ivrognerie, maux contre lequel il est employé comme remède, non sans de bonnes raisons. » Non sans ironie, il ajoute : « Mais ce qui nous offusque chez l’Anglais, même le plus humain, c’est son manque de musique, au propre et au figuré ; il n’y a dans les mouvements de son corps et de son âme ni rythme ni danse, ni même aucun besoin de rythme ou de danse, de ‘musique’. Écoutez-le parler, regardez marcher les plus belles Anglaises (aucun pays n’a de plus belles colombes ni de plus beaux cygnes) – enfin, écoutez-les chanter ! Mais c’est sans doute trop demander… » §252
Dommage, selon lui, que le modèle anglais ait contaminé la France vers le milieu du XVIIIe siècle… « Toute la noblesse de l’Europe, celle du sentiment, du goût, des mœurs, bref la noblesse dans tous les sens élevés du mot, est l’œuvre et l’invention de la France ; la vulgarité européenne, la bassesse plébéienne des ‘idées modernes’ est l’œuvre de l’Angleterre.

Nietzsche aimait bien l’Italie mais préférait par-dessus tout la France en Europe.
Pour lui, la civilisation française tenait du nord et du midi, dans un bel équilibre : de la passion latine et de la profondeur germanique, de la clarté romaine et de la sensibilité celte, l’âme et la raison, Apollon et Dionysos peut-être… Sauf qu’au siècle des révolutions, le XIXe, la civilisation française connaissait une éclipse plébéienne. « Aujourd’hui encore, la France est le siège de la civilisation la plus spirituelle et la plus raffinée de l’Europe, et l’école du goût supérieur ; mais cette ‘France du goût’, il faut savoir la découvrir. Ses représentants se tiennent bien cachés ; elle semble ne s’incarner que chez un petit nombre d’individus [par exemple Stendhal, Flaubert, Balzac] (…) Un trait leur est commun à tous ; ils se bouchent les oreilles devant la sottise déchaînée et les criailleries bruyantes des bourgeois démocrates. Ce qui s’agite au premier plan, en effet, c’est la France déchue dans la bêtise et la vulgarité ; récemment encore, aux obsèques de Victor Hugo, elle s’est livrée à une véritable orgie de mauvais goût et de béate satisfaction de soi. » §254
Et encore plus récemment encore, avec les Royal, Strauss-Kahn, Mélenchon, Trierweiler, Copé et autres footeux ou Hartistes ?…
Frédéric Nietzsche, Par-delà le bien et le mal, 1886, traduction Colli & Montinari, Folio 1987, 288 pages, €7.13
Nos citations viennent de la traduction de Geneviève Bianquis, publiée chez 10-18 en 1972.
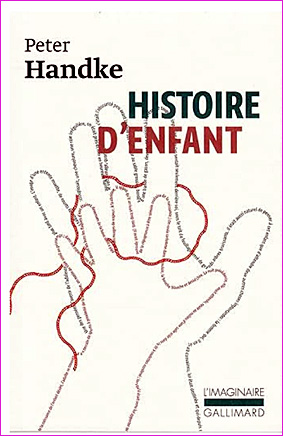








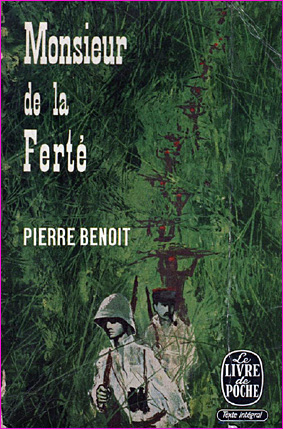


















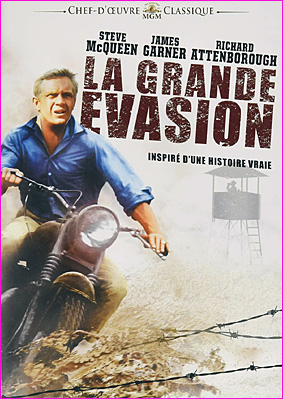













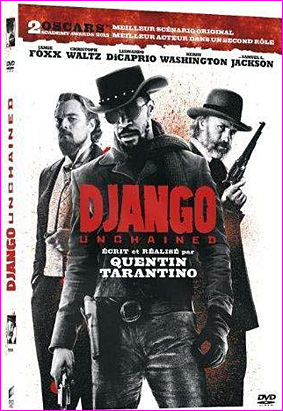







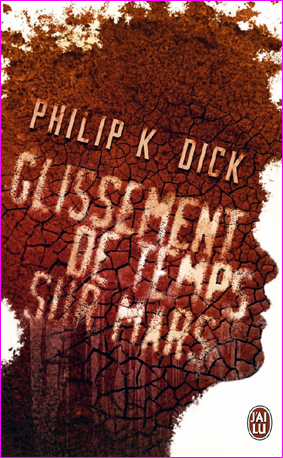
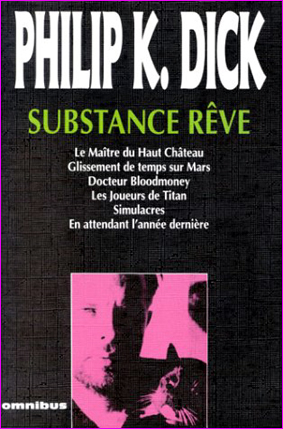
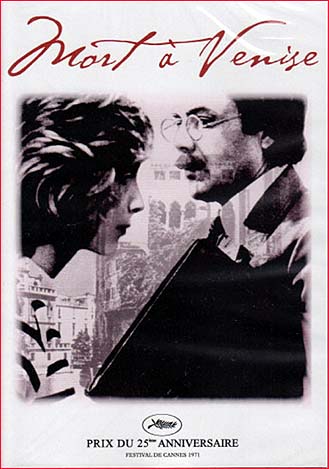



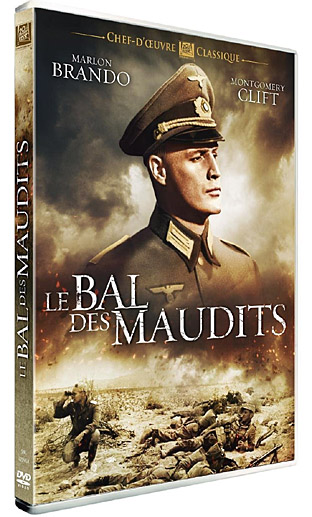


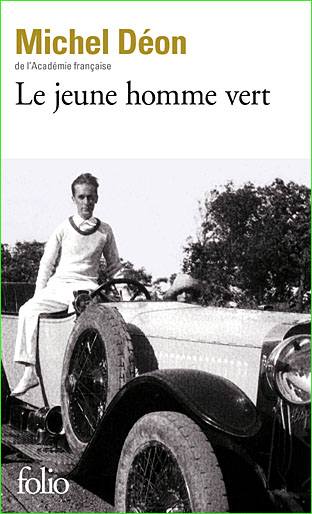




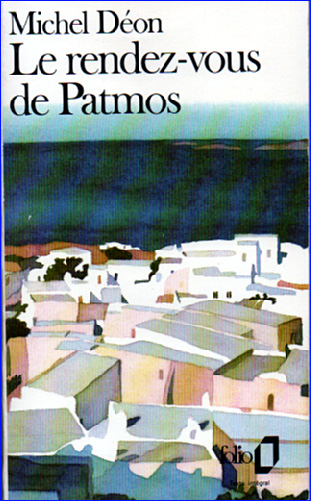
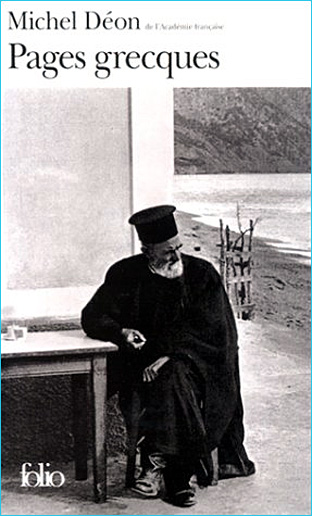








































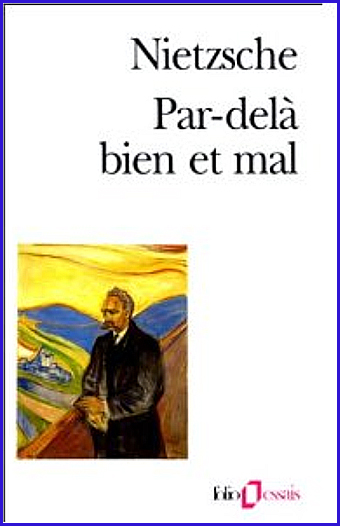


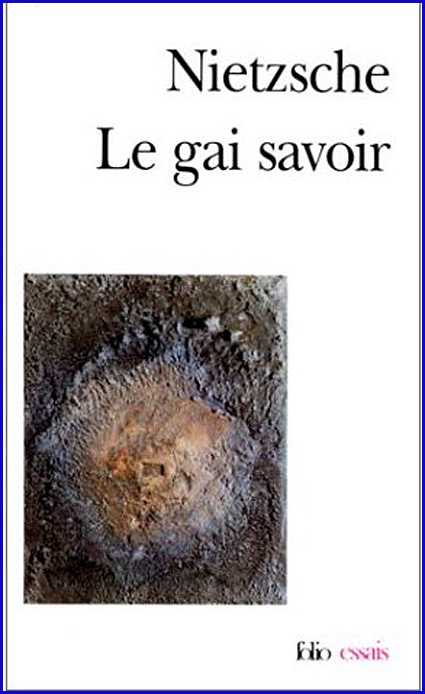





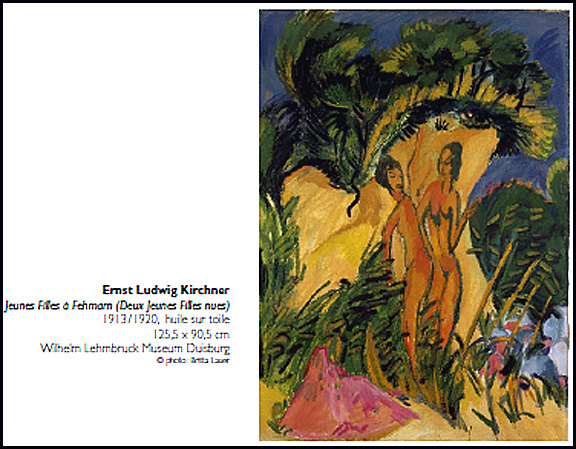
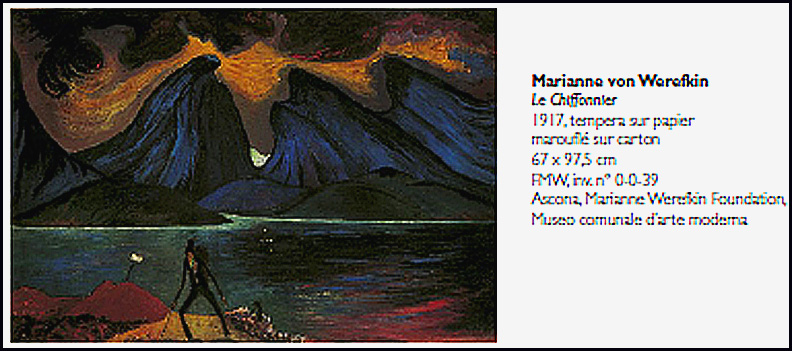
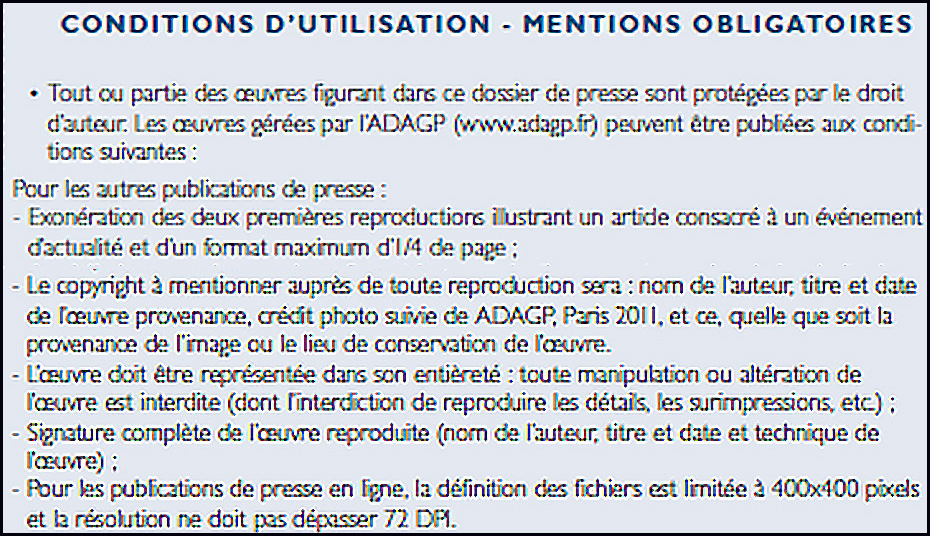
Commentaires récents