La jeune Andy (Anne Hathaway) sortie de l’université et ayant une petite expérience dans le journalisme postule, comme ailleurs, auprès de Miranda Priestly, rédactrice en chef du magazine de mode newyorkais Runway. A sa grande surprise, car elle n’a pas le profil habituel, elle est retenue par l’impérieuse et caractérielle Miranda devant laquelle tout le monde se couche tant elle fait la pluie et le beau temps dans ce monde futile et éphémère de la mode. Les branchés croient en « l’art » alors que Miranda, cynique et froide (Meryl Streep payée 4 millions de $ pour ce film), croit au seul pouvoir. La mode, pour elle, n’est pas une création mais une direction. Elle aux commandes, comme dans la réalité du magazine Vogue, elle domine le secteur et tous lui magnent dans la main.
Elle règne sur son duo d’assistantes qui doivent tenir l’agenda mais surtout assouvir tous ses caprices : ranger le sac et le manteau du matin jeté sur le bureau, réserver les avions, chercher les cafés et faire les courses, livrer le soir le book du prochain magazine à valider, les vêtements revenus du pressing, et ainsi de suite. Un travail d’esclave dans l’ombre de sa grandeur qui permettra – peut-être – au bout d’un an d’avoir une ligne prestigieuse sur son CV et de pouvoir évoluer ailleurs. Miranda consomme des assistantes comme des kleenex.
Andy n’a pas la taille mannequin anorexique et se « fringue » n’importe comment, plus confortable que soucieuse de son apparence – qui n’en a pas besoin. Elle n’est pas « une fashion victim » ni n’est attirée par le miroir aux alouettes des robes et autres accessoires branchés coûtant deux fois le salaire du mois. Elle cherche à faire son boulot et à écrire des articles. Mais Miranda la reprend alors qu’Andy rit sous cape devant le choix de deux ceintures bleues identiques : toute cette frime pour ça ! Non, récuse Miranda en public, vous-mêmes portez du bleu et pas par hasard : « ce bleu céruléen représente des millions de dollars et un nombre incalculable d’emplois, et je trouve assez amusant que vous pensiez avoir fait un choix qui n’a pas été dicté par l’industrie de la mode, alors qu’en fait vous portez un vêtement qui a été choisi pour vous par les personnes qui se trouvent dans ce bureau… » Ce monologue – devenu célèbre – essaie de justifier la futilité par le business. Au fond, la mode est une idéologie qui asservit volontairement. Être comme les autres exige de suivre les tendances avancées par quelques-uns, selon les meilleures règles du marketing pour faire vendre de l’inutile à ceux qui n’en ont pas besoin.
Ce pourquoi cet univers de paillettes en compétition permanente est impitoyable : chacun cherche à faire valoir son image au détriment des autres et le talent réel n’est guère récompensé. La première assistante, Emily (Emily Blunt), rabaisse sans cesse Andy. Seul Nigel (Stanley Tucci), le directeur artistique revenu de tout et fort de son utilité, donne des conseils paternels à la jeune assistante : il l’habille, l’initie au goût, lui indique les tendances de la mode. Andy séduit et il faut dire que l’actrice Anne Hathaway qui l’incarne est belle à 24 ans avec ses grands yeux et sa bouche un peu large qui lui donnent un air de Bambi. L’écrivain Christian Thomson (Simon Baker), sur lequel elle avait fait un article avant d’entrer chez Runway, la rencontre dans un cocktail et la drague.
Andy étend donc ses relations, ce qui lui permet, après des débuts maladroits, de satisfaire sa patronne. Elle trouve notamment in extremis pour ses jumelles le manuscrit à paraître du dernier Harry Potter ! Thomson connait l’illustratrice de la couverture. Miranda est étonnée de son initiative et de son obstination et commence à voir en elle un double d’elle-même.
Elle sera déçue car Andy ne veut pas piétiner les autres comme il est requis ; le pouvoir lui indiffère, elle préfère écrire, faire le métier qu’elle aime, en étant bien avec les gens. Lorsque Miranda lui dit qu’elle doit l’accompagner à Paris pour la Fashion Week à la place d’Emily qui en rêve depuis des mois, Andy commence par refuser, mais sa carrière s’arrêtera là. Elle tente alors de joindre Emily pour lui annoncer mais celle-ci la coupe, tout entière prise par ses préoccupations immédiates, rapporter les carrés Hermès exigés ce matin même par Miranda. Andy n’aura pas à lui faire de la peine, Emily distraite se fait renverser par un taxi et se retrouve à l’hôpital.
Andy souhaite aussi ne pas couper les ponts avec ses anciens amis de l’université qui exercent des métiers divers ni avec son compagnon, Nate (Adrian Grenier), saucier dans un restaurant, dont elle n’a pas pu souhaiter l’anniversaire. Elle n’a plus le temps de les voir, partant aux aurores pour être la première au bureau, le café prêt pour Miranda, et appelée tard le soir pour une réunion impromptue ou un book à livrer. Andy est écœuré lorsqu’elle lui apprend qu’elle suit Miranda à Paris : Son Andy serait-elle devenue celle qu’elle ne voulait justement pas être ? Est-ce qu’elle rêve de devenir une Miranda à son tour ?
La semaine à Paris lui décillera les yeux : Christian Thomson l’invite à coucher avec elle puisqu’elle est libre et lui livre sur l’oreiller l’information que Miranda n’en a plus pour longtemps à diriger Runway. Jacqueline Follet (Stephanie Szostak), directrice du magazine France est plus jeune et plus moderne. Andy cherche à prévenir Miranda de ce qui se trame, l’ayant vue le soir précédent défaite en évoquant son divorce prochain dû à son boulot trop prenant et les répercussions qu’elle anticipe sur ses deux filles. Mais Miranda annonce publiquement que c’est Jacqueline Follet qui quittera Runway pour aller travailler chez le styliste James Holt (Daniel Sunjata), au détriment de Nigel, pressenti pour ce poste. Malgré sa fidélité, elle sacrifie Nigel pour garder son pouvoir.
Ce dernier événement, qui révèle l’égoïsme sacré des puissants obéissant à la seule loi de la jungle, finit de rebuter Andy qui décide de tout plaquer. A commencer par sa maitresse tyrannique qui la rappelle déjà à l’ordre à peine sortie de voiture, place de la Concorde. Elle jette son téléphone sonnant dans la fontaine, ne remet plus les pieds à Runway, quitte l’univers frelaté de la mode et donne toutes ses robes branchées à Emily.
Elle postulera en pull et jean dans un journal newyorkais où elle sera acceptée malgré les références mitigées de Miranda tandis que Nate se verra proposer un poste de sous-chef à Boston. La vraie vie pourra alors commencer, loin des prédateurs et selon les bonnes valeurs.
Juste avant « la crise » de 2007-2008 due aux errements de la finance spéculative, ce portrait en pied du patronat style yankee est criant de vérité et ne manque pas d’humour. Tous les cadres des multinationales influencées par le modèle anglo-saxon l’ont vécu – j’en témoigne. Le film est un appel à résister à la tentation diabolique du pouvoir et de l’argent, à rester soi-même et à savoir dire non – parfois au détriment de sa carrière. Mais la vie bonne est à ce prix, surtout avec les siens. Il est intéressant d’observer que c’est Paris, ville lumière et atmosphère tradi, qui désensorcelle Andy du diable régnant sur New York.
DVD Le diable s’habille en Prada (The Devil Wears Prada), David Frankel, 2006, avec Meryl Streep, Anne Hathaway, Adrian Grenier, Emily Blunt, Stanley Tucci, 20th Century Fox 2007, 1h45, €6.00
Un roman récent sur le pouvoir d’une patronne en France









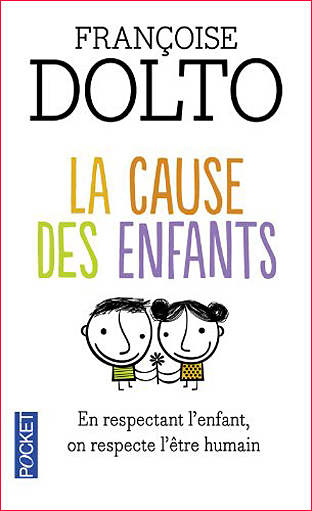


Commentaires récents