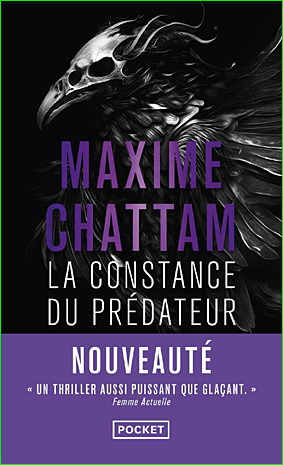
Maxime Chattam renoue avec ses obsessions de jeunesse : les tueurs en série. Il met cette fois en scène un tueur multiple, intelligent, insaisissable, issu inévitablement d’une enfance malheureuse et même perverse. Le meurtrier est fort, méticuleux, précis, il ne laisse pas de traces. L’ADN, « reine des preuves » depuis trente ans, devrait aider mais… il n’est pas fiable à cent pour cent. Ici, il est même déconcertant…
Tout commence par une phrase sibylline : « Claire n’aimait pas sucer ». Mais ce n’est pas ce que vous croyez, il s’agit de sucre et d’une adote dans un bus clapant de la langue sa sucette avec des bruits mouillés. Un substitut freudien, peut-être, qui agace clairement Claire. L’infirmière rentre chez elle et, à sa porte, se fait enlever. Le tueur a encore sévi. Il va s’en servir quelques jours, jusqu’à épuiser sa jouissance, puis l’étrangler dans l’orgasme, comme il l’a appris dès son plus jeune âge.
Le décor est posé, les personnages entrent en scène. C’est d’abord Ludivine, la lieutenante criminelle qui passe au DSC, le Département des sciences du comportement, une section de profilage nouvelle chez les gendarmes français. Ludivine Vancker n’en est pas à sa première enquête, Maxime Chattam l’a déjà mise en scène dans des situations limites, glauques comme il les aime, dans trois autres volumes précédents (La conjuration primitive, La patience du diable, L’appel du néant).
La gendarmette, experte en combat rapproché, vient de rentrer de vacances après une enquête qui l’a fort éprouvée. Elle a trouvé entre les bras de Marc, capitaine DGSI (le Renseignement intérieur) la protection et le réconfort que toutes les femmes normales de l’auteur recherchent selon lui (il a demandé conseil à sa compagne). Sitôt de retour à la brigade, direction le chef : elle est mutée illico au DSC à Pontoise, ils ont besoin d’elle immédiatement.
C’est du lourd. Avec sa cheftaine capitaine Lucie, direction l’hélicoptère qui file vers l’est. Ludivine a à peine le temps d’être briefée, un paquetage de fortune lui est attribué pour quelques jours et qu’elle puisse se changer. C’est qu’une vingtaine de cadavres ont été découverts dans une mine d’aluminium désaffectée. Certes aux puits obturés, mais pas noyée comme les autres, pour ne pas polluer les nappes phréatiques. Le béton a été fissuré, on s’est introduit dans les galeries, à plusieurs reprises, et des cadavres ont été déposés là. C’est un photographe local qui aime prendre des lieux isolés et des ruines macabres de l’abandon industriel qui a prévenu les gendarmes.
Ce sont toutes des femmes, jeunes, entre 20 et 40 ans, pas moins de dix-sept, habillées mais sans aucun sous-vêtements. Des croix ont été tracées avec du sang sur les murs, puis effacées. Mais le fameux bluestar les révèle. La gendarmerie est à la pointe de la technique désormais (Chattam en rajoute un peu) et son labo mobile est capable d’analyser l’ADN en 48 h pour un coût modeste. Un ADN est justement révélé dans chaque vagin – mais aussi un objet curieux et symbolique, un crâne de piaf. Aucune référence dans la base de donnée du Fnaeg, le fichier des empreintes génétiques qui ne date guère que de vingt ans. Car les corps remontent aux années 1970.
Mais le même ADN est retrouvé dans le sexe de femmes récemment tuées, jetées cette fois sans mise en scène dans la nature. Y aurait-il deux tueurs ? Deux rituels distincts ? Ou le prédateur a-t-il été isolé durant deux décennies, par exemple en prison ou à l’étranger ? Chloé, autre jeune femme bien vivante, en fait l’expérience. A un stop sur son trajet de travail, un 4×4 Dacia Duster noir emboutit son feu arrière. C’est le piège classique pour la faire sortir de sa voiture et s’emparer d’elle. Elle ne peut rien faire, le prédateur est physiquement trop puissant. Il va dès lors la violer régulièrement dans une cave, la jetant nue dans une cuve d’égout en plastique le reste du temps.
Ludivine est sur les dents – ce qui contraste avec son prénom qui signifie en germanique ‘longue patience’. Le tueur est désormais surnommé Charon, le passeur aux yeux noir d’abîme du fleuve des morts de l’Antiquité. Puisqu’on n’a pas retrouvé le cadavre de Chloé, c’est que le tueur en jouit encore, il y a peut-être une chance de la sauver si l’on fait vite. Et c’est « l’urgence », habituelle à notre époque de linottes ; tout se fait à la va-vite, stressé, sans recul. La raison recule devant l’« émotion », autre scie à la mode, qui fait faire n’importe quoi sans réfléchir, trop vite. Jusqu’à prendre des risques insensés : envers l’enquête, les collègues, les personnes, envers soi-même.
Le thriller est bien distillé, avec son lot d’horreurs inouïes – que l’auteur s’excuse d’imaginer, comme si elles étaient en lui seul. Ce pourquoi la fin s’étire, Chattam répugnant à couper court une fois l’enquête bouclée, désirant « réparer » les atteintes psychologiques faites au lecteur – autre scie à la mode.
Malgré cette démagogie constante, son roman policier se lit bien, ponctué d’action comme il le faut, sans trop se perdre dans les affres des personnages. Du sadisme, de la technique scientifique, de l’intuition policière, de l’audace militaire (les gendarmes en sont), un arrière-plan familial édifiant : tout dans ce roman d’imagination oppose la noirceur orientée vers la mort, le sexe égoïste, l’obsession familiale névrotique – à la lumière qui va vers la vie, l’amour, le compagnon, les enfants.
De quoi scruter les ténèbres bien armé.
Maxime Chattam, La constance du prédateur, 2022, Pocket 2023, 526 pages, €9,50, e-book Kindle €9,45
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)
Les thrillers de Maxime Chattam déjà chroniqués sur ce blog



















































Commentaires récents