Le thé, au Japon, n’est pas qu’une boisson énergétique, il est toute une philosophie. La voie du thé est l’expression conviviale du zen, un rituel qui permet de s’ouvrir en commun à sa vie intérieure, en harmonie avec la nature. Car le thé est une conception intégrale des relations homme-nature : son hygiène oblige à la propreté, son économie montre que le bien-être réside dans la simplicité, sa morale définit notre proportion dans l’univers.
Préparer le thé est célébrer un culte de pureté et de raffinement. L’hôte a une fonction sacrée et ses invités s’unissent pour réaliser ensemble la plus haute béatitude de la vie en société. Chacun fait silence dans la maison de thé, admire la qualité artistique des bols et des instruments, suit des yeux la lente élaboration de la recette d’un breuvage parfaitement infusé, puis goûte dans la chaleur du récipient le thé vert servi brut, au goût d’herbe et de nature. La pièce où s’élabore le thé est une oasis d’harmonie où l’art rituel est un moyen d’harmonie avec les autres et de communion avec le naturel.
Ancêtre du zen japonais, le Tao chinois est l’esprit du changement cosmique, l’éternelle croissance qui revient toujours à elle-même pour produire de nouvelles formes. Elle s’enroule comme le dragon. Le Tao est l’effort individualiste de l’esprit chinois méridional en contraste avec le grégarisme de la Chine du Nord qui a son expression dans le confucianisme.
Pour le Tao, l’absolu est le relatif. L’éthique reconnaît un bien et un mal selon les temps et les sociétés et non en soi ; ils sont vécus plus comme le bon et le mauvais de circonstance que comme des absolus moraux. Car définir une morale est toujours un arrêt du développement, donc une dictature du passé et de ses modèles – ainsi Confucius en Chine, Platon chez les philosophes et les Commandements divins pour les croyants du Livre. Le Tao comme le zen encouragent à l’inverse une conduite plutôt qu’une conformité. Le taoïste comme l’adepte zen accepte le monde tel qu’il est et non tel qu’il devrait être. Il s’y adapte et s’efforce d’y trouver de la beauté, ce qui signifie conserver leurs proportions aux choses et faire de la place aux autres humains sans perdre la sienne.
L’essentiel est le vide. Non le vide de la forme mais le vide comme encouragement à tout contenir, comme attente, comme éveil. Ainsi la chambre ou la cruche sont vides, mais elles peuvent accueillir quiconque ou quoi que ce soit. Ce vide existe par exemple dans l’art martial du jiu-jitsu qui s’efforce d’aspirer la force de l’adversaire par l’effacement de soi, ce qui crée un vide, tout en conservant sa propre force pour la lutte finale. Le vide existe aussi par la suggestion. En ne disant pas tout, l’artiste laisse au spectateur l’occasion de compléter son idée et de s’approprier ainsi l’œuvre. Il s’agit d’un vide à pénétrer, d’un désir à combler, le plaisir de tout ce qui est incomplet, inachevé, asymétrique, en devenir, sans cesse en mouvement. Telle la mer qui sans cesse bouge, ou l’enfant que l’appétence pour tout ne fait pas tenir en place, ou encore l’esquisse, les saisons, la musique, la poésie, la curiosité scientifique, l’exploration et l’aventure, la simplicité, la peur des redites, de la redondance et du baroque.
Pour avoir tout son prix, l’art doit être incarné dans la vie. D’où la voie du thé qui joint l’avenir au passé dans le présent immédiat. Car il faut jouir du présent, s’adapter aux instruments, s’accorder au moment – mais dans la coutume millénaire et en suivant la tradition des étapes rituelles. Ou encore l’ikebana, souvent associé au thé dans le décor de la pièce où se passe la cérémonie. Les légendes japonaises attribuent le premier arrangement floral à ces vieux saints bouddhistes qui ramassaient les fleurs fauchées par l’ouragan et qui, dans leur sollicitude infinie pour toutes les choses vivantes, les mettaient dans des vases pleins d’eau pour qu’elles vivent encore un peu.
Le thé est un art de vivre, un art de penser, un art d’être au monde purement japonais. Mais chacun, partout ailleurs, peut se mettre en situation de calme, faire silence en soi-même et avec les autres, pour accomplir un rituel comme celui du thé. Le vin, le fromage ou même l’eau peuvent remplacer le breuvage doré. Car tout est culture à qui veut vivre et penser son propre rapport à la nature.
Depuis plus d’un siècle, ce petit livre est constamment réédité et parle toujours, surtout à nos oreilles sensibilisées au devenir de la planète et de notre espèce, aspirant à vivre en harmonie avec le cosmos.
Kakuzô Okakura, Le livre du thé, 1906, Piquier poche 2006, 170 pages, €6.10 e-book Kindle €1.99










































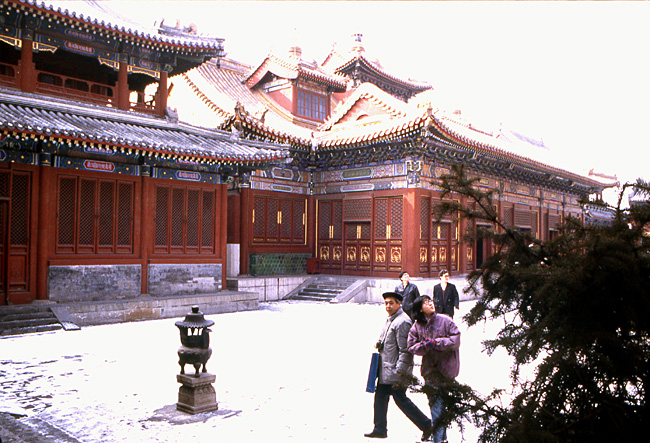








Commentaires récents