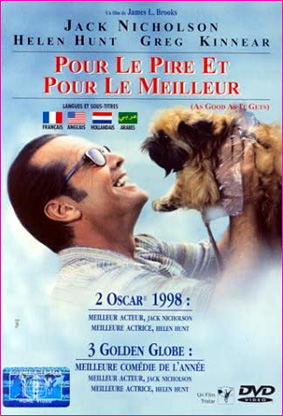
Huis-clos entre trois personnages, chacun enfermé dans sa paranoïa, et tous enfermés dans la grosse pomme, la New York polluée de la foule solitaire. Nous sommes à la fin des années 1990 et les Yankees réfléchissent avant de sombrer dans le chaos mental de l’après 11-Septembre. La solitude de chacun est construite, pas une destinée manifeste. En sortir est possible, sans l’aide des psys et autres monnayeurs de soins personnels. Pour en sortir, il faut agir par soi-même, procéder par petits pas, arriver à « l’aussi bon que possible » (as good as it gets) – qui est le titre américain du film.
Melvin Udall (Jack Nicholson) est un auteur sentimental à succès qui vit seul, affligé de névrose obsessionnelle compulsive. Elevé par un père sévère qui lui tapait sur les doigts lorsqu’il fautait au piano, il est devenu maniaque. Tout doit être dans le même ordre, rangé, chacun à l’heure, se défiant de la saleté. Il ferme sa porte à double tour, répétant trois fois la fermeture ; il n’utilise qu’un savon neuf à chaque fois qu’il se lave les mains, puis le jette aussitôt ; il évite soigneusement de marcher sur tous les joints des dalles au sol et un carrelage en damier trop petit le met en transes ; il porte des gants pour toucher toutes choses et apporte ses propres couverts en plastique au restaurant pour manger… Lorsqu’on l’interroge pour savoir comment il comprend si bien les femmes, il a cette réplique culte : « j’écris au masculin, puis j’enlève toute logique et toute responsabilité ». Il ne supporte pas que le chien d’en face vienne pisser le long du mur au lieu de prendre l’ascenseur. Il le fourre donc dans le vide-ordure.

Lorsque Simon Bishop (Greg Kinnear), le pédé d’en face, cherche son petit amour frisé de griffon bruxellois nommé Verdell, Melvin le rembarre : il n’en a rien à foutre du pisseux, rien à foutre de la pédale dépoitraillée qui s’offre à son regard, rien à foutre des autres. Il travaille et ne veut pas être dérangé. C’est le concierge qui rapporte le chienchien à son maîmaître en pleine partouse artistique entre mâles avec whisky, champagne et petits fours. Car Simon est peintre ; il a fait ses premiers essais durant sa prime adolescence, lorsque sa mère posait nue pour lui en toute innocence (c’était après 68…). Son père qui l’a découvert s’est mis en fureur et l’a interdit, finissant par frapper son fils pour que cela marque sa psychologie. Déjà tendancieux, Simon a viré pédale, incorporant l’interdit des femmes. A l’âge de l’université, papa l’a mis dehors et il vit de ses toiles pour lesquelles il demande des modèles dans la rue à son agent Franck Sachs (Cuba Gooding Jr).

Un jour, le jeune modèle dans la dèche Vincent (Skeet Ulrich), qui croyait devoir coucher et s’est mis aussitôt à poil, encourage ses copains à voler le pédé pendant qu’il se pavane devant lui pour qu’il le dessine. Un coup classique de la drague homo. Simon lui révèle la beauté qu’il voit dans chacun lorsqu’il le regarde assez longtemps pour percevoir ce qui est sous la surface sociale : une vieille dame, un enfant, n’importe qui dans la rue ou au café. Vincent est touché mais ses copains font du ramdam et le chien aboie. Simon va voir alors qu’il n’aurait pas dû. Il est tabassé sévèrement malgré Vincent qui s’interpose. Il finit à l’hôpital où sa beauté est ravagée pour plusieurs semaines, ce qui le met en dépression. C’est pire lorsqu’il sort : il est ruiné par les frais indécents de la médecine privée américaine, 61 000 $ pour les trois semaines.

Pendant ce temps, Melvin a gardé le chien. A contre cœur au début, forcé par l’agent de Simon qui lui fait les gros yeux et en rajoute sur l’attitude autoritaire pour lui renvoyer la sienne en miroir. Verdell le clebs se fait tout humble devant la grosse voix puis s’apprivoise. Il ne mange plus ni croquettes ni pâtée pour chien mais du bon : du rôti, de bacon. Il est pris par le ventre et n’a plus trop envie de retrouver son vrai maître, qui accuse un peu plus le coup lorsqu’il s’en rend compte. Personne ne l’aime, personne ne le comprend, l’art est une occasion de le flouer, et ainsi de suite. Franck l’agent va solder ses comptes, relouer son appartement en meublé, prêter sa voiture, une Saab décapotable bleu ciel pour que Simon aille demander personnellement de l’aide à ses parents… et c’est Melvin l’asocial qui va le conduire ! Il faut toujours forcer la main à ceux qui n’osent pas sortir de leur cocon mental.
Melvin va déjeuner chaque jour dans le même restaurant de son quartier de Manhattan ; il prend la même table et exige la même serveuse, Carol (Helen Hunt). Celle-ci l’a trouvé séduisant la première fois, puis insupportable par la suite, et elle le rembarre lorsqu’il va trop loin. Mais l’accoutumance est trop forte et elle est comme une drogue pour Melvin : elle le rend meilleur, plus efficace que le psy qu’il voit et qui ne jure que par les pilules à vendre. Mais Carol a un talon d’Achille, son fils Spencer (Jesse James à 8 ans) coiffé en blond cocker et asthmatique au dernier degré. L’hôpital public ne fait que des analyses superficielles et le gamin est obligé d’être conduit aux urgences six fois le mois. Un jour donc, elle s’est fait remplacer au restaurant, au grand dam de Melvin qui ne le supporte pas et est chassé par le patron sous les applaudissements des clients réguliers, outrés du malotru qui a traité la nouvelle de grosse vache. Carol se cache derrière son petit malade pour éviter de vivre, malgré les encouragements de sa mère Beverly (Shirley Knight). Pour son confort, Melvin engage à ses frais le mari docteur de son éditrice à succès pour soigner Spencer et que Carol revienne. Cette générosité égoïste n’en reste pas moins une générosité, tout comme la garde du chien et la conduite à Baltimore.

Car Melvin convainc Carol de se joindre à Simon et lui pour les deux jours d’aller et retour chez les parents de Simon. Son idée est de draguer Carol tout en faisant une bonne action pour Simon, sur la demande de Franck. Les relations sont compliquées mais chacun doit y trouver son intérêt. Les présentations sont vite faites, à la brute, version Nicholson de la grossièreté habituelle aux Américains : « je vous présente : la serveuse, la pédale ». Chacun est étiqueté et fait avec. Le voyage voit se concilier Simon et Carol tandis que Melvin est relégué à l’arrière de la voiture. Simon raconte son histoire, ce qui touche Carol. Melvin tente de se rattraper au restaurant de tourteaux où il emmène Carol seule, Simon préférant rester au lit. Il lui raconte son âme à lui mais la blesse par des propos trop directs, comme ce « tablier » qui lui sert de robe. Carol le quitte et rentre ; Simon, couché mais pas endormi, la voit se couler un bain dénudée et est pris d’une envie folle de la dessiner, tout comme il dessinait maman jadis. Il reprend goût à la vie et décide de seulement téléphoner à sa mère, sans rien demander aux parents ni les voir s’ils ne le souhaitent pas.
Ils rentrent donc tous ensemble à New York, ce qui ne fait pas les affaires de Melvin. Franck a installé le lit de Simon chez Melvin « provisoirement », en attendant de trouver un logement plus raisonnable à son poulain désargenté. Melvin accepte Simon après le chien mais pas question de coucher ensemble, il en pince pour Carol. Pourquoi ne pas aller le lui dire directement et dès maintenant, dit Simon requinqué ? Qu’à cela ne tienne, aussitôt dit, aussitôt fait et Melvin se rend chez Carol à deux heures du matin. Ils sortent se balader et s’embrassent, enfin conciliés.

Melvin, Simon, Carol, Spencer, Verdell, tout est aussi bon que possible. Les relations ne seront peut-être pas idéales ni sans orages à l’avenir, mais chacun a rentré ses piquants pour faire de la place aux autres sans se blesser mutuellement. Les compromis dans la vie permettent de faire société. Melvin en perd ses manies et en devient humain, Simon se reprend à dessiner, Carol à espérer autre chose que sa vie de serveuse et de garde-malade. Le petit Spencer vient de marquer un but au foot, pouvant enfin courir sans cracher ses poumons, enfant enfin normal vis-à-vis de ses copains.
La suite de ce couple à trois semble cependant incertaine ; ils vont rester amis et unis, mais sans peut-être aller plus loin. Les relations de Simon et de Spencer, soigneusement évitées dans le film, ne sauraient être que scabreuses au vu des mœurs affichées de Simon. Quant à un mariage entre Melvin et Carol, il reste très improbable. « Aussi bon que possible », mais il ne faut pas trop demander.
Jack Nicholson et Helen Hunt ont reçu l’Oscar du meilleur acteur.
DVD Pour le pire et pour le meilleur (As Good as It Gets), James L. Brooks, 1997, avec Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear, Cuba Gooding Jr, Shirley Knight, Skeet Ulrich, Jesse James, Sony Pictures 1998, 2h13, €10.00 blu-ray €12.67

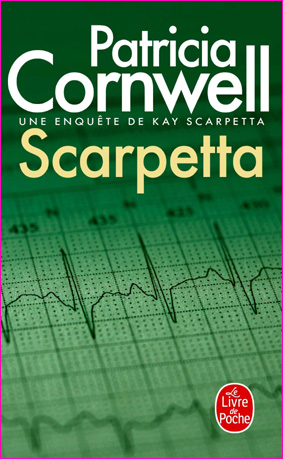

























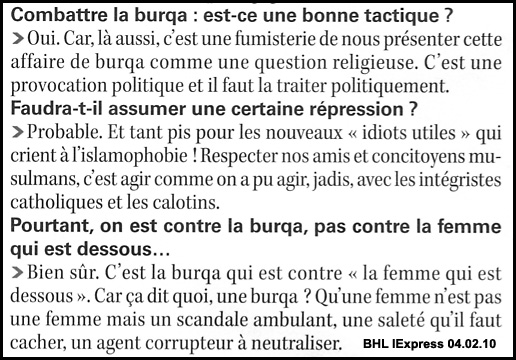



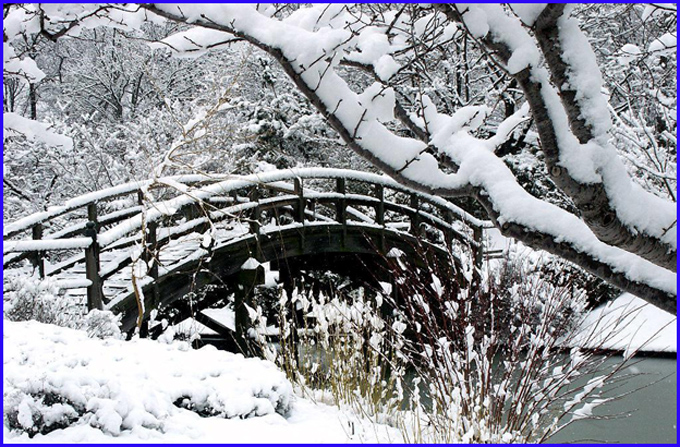
Commentaires récents