Chapitre énigmatique que la Sangsue de Zarathoustra. Le prophète se promène près de sa caverne en réfléchissant. Par mégarde, il heurte un homme et, effrayé, le bastonne en plus. C’est le choc entre le philosophe prophète et le scientifique rationaliste. Il présente des excuses. L’homme retire son bras nu du marais le long duquel il était couché et du sang en coule : c’est la sangsue.

Zarathoustra a été pour lui une autre sangsue, « la meilleure ventouse qui vive aujourd’hui », celui qui accroît sa science avec son sang. Mais Zarathoustra n’est pas cela. Il répand, il ne suce pas.
« Je suis le consciencieux de l’esprit », dit l’homme heurté, « et, dans les choses de l’esprit, il est difficile que quelqu’un s’y prenne de façon plus sévère, plus étroite et plus rigoureuse que moi, hors celui de qui je l’ai appris, Zarathoustra lui-même ». Est-ce à dire qu’il faut être obsédé jusqu’à l’obsessionnel et étroit jusqu’à la monomanie ? « Plutôt ne rien savoir que de savoir beaucoup de choses à moitié ! Plutôt être un fou pour son propre compte que sage dans l’opinion des autres ! Moi – je vais au fond. » Fatale erreur ! Arpenter son territoire, qu’il soit grand ou petit, car il n’y a rien de grand ou de petit pour la connaissance. La sangsue, animal répugnant et parasite, mérite autant qu’un autre animal dit « noble » l’étude et la passion de savoir. « C’est aussi un univers ! »
Aussi, l’homme heurté déclare : « Ma conscience de l’esprit exige de moi que je sache une chose et que j’ignore tout le reste : je suis dégoûté de toutes les demi-mesures de l’esprit, de tous les esprits nuageux, flottants et exaltés. » Permettons-nous de ne pas être d’accord avec lui sur ce point. Certes, Zarathoustra vilipende les demi-savants, ceux qui affirment sans vraiment savoir, ni tout savoir – et cela est juste. Mais avoir une teinture d’un peu tout, cela s’appelle la culture générale, et notre siècle en manque de plus en plus. Les spécialistes comme l’homme heurté sont peut-être inégalables dans leur étroit domaine, mais infantiles en tous les autres. Comment sauraient-ils être épanouis, équilibrés, sensés ? Comment sauraient-ils être utiles en société ? Comment pourraient-il préparer l’avenir ?
Nietzsche révère la « probité » mais l’homme heurté veut rester « aveugle » à tout le reste. La probité est l’honnêteté scrupuleuse, la justice et la rectitude. Le mot vient du latin probus, qui signifie examen, vérification ou jugement. Ainsi fait le scientifique, qui ne tient pour avéré que ce qu’il peut vérifier. « Je veux être probe, c’est-à-dire rigoureux, sévère, austère, cruel, implacable. » Car la vérité crue est dure aux illusions ; elle tranche les croyances, elle récure les à peu près. La réalité des choses est cruelle pour l’émotion et la sensibilité humaine. Or, pour Nietzsche, « l’esprit c’est la vie qui incise elle-même la vie. »
Mais cette formule est ambivalente. L’esprit seul ne fait pas l’homme. Nietzsche insiste souvent sur le trio des instincts vitaux, des passions émotives et de l’esprit logique. Pourquoi met-il l’accent en ce texte sur la seule probité de l’esprit ? Parce que les hommes savants considèrent que son prophète est la grande sangsue des consciences étroites. Or Zarathoustra philosophe est seul mais voit loin en altitude, alors que le scientifique est seul en son domaine, proche du marécage. La science est réductrice, elle opère une objectivation des êtres, une désubstantiation, en témoigne le sang qui coule du bras à cause de la sangsue objet d’étude. L’homme heurté par le philosophe est myope, réduit à un domaine très étroit.
Nietzsche critique ici la vérité, la foi en la vérité scientifique, qui n’est pour lui qu’une croyance parmi d’autres, même si elle pousse l’homme supérieur à se surmonter parce qu’elle fissure toutes les illusions – sauf la sienne, celle d’être absolue. Rien d’absolu en ce monde qui ne cesse de changer, pas plus la science – qui n’est qu’un outil. Nourrir son savoir de sa vie, comme le sang pour la sangsue, ne suffit en rien à l’humain : il lui faut encore surmonter ce savoir pour en faire quelque chose, au-delà du ‘savoir pour savoir’, du seul bonheur de connaître qui reste une illusion. Le savoir doit obéir au principe de vie, qui est la volonté de puissance ou, plus exactement en français, le tropisme vers la vie – tel le lotus émergeant de la boue pour monter vers la lumière.
(J’utilise la traduction 1947 de Maurice Betz au Livre de poche qui est fluide et agréable ; elle est aujourd’hui introuvable.)
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire) :
Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, 1884, traduction Geneviève Bianquis, Garnier Flammarion 2006, 480 pages, €4,80 e-book €4,49
Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra – Œuvres III avec Par-delà le bien et le mal, Pour la généalogie de la morale, Le cas Wagner, Crépuscule des idoles, L’Antéchrist, Nietzsche contre Wagner, Ecce Homo, Gallimard Pléiade 2023, 1305 pages, €69.00
Nietzsche déjà chroniqué sur ce blog































































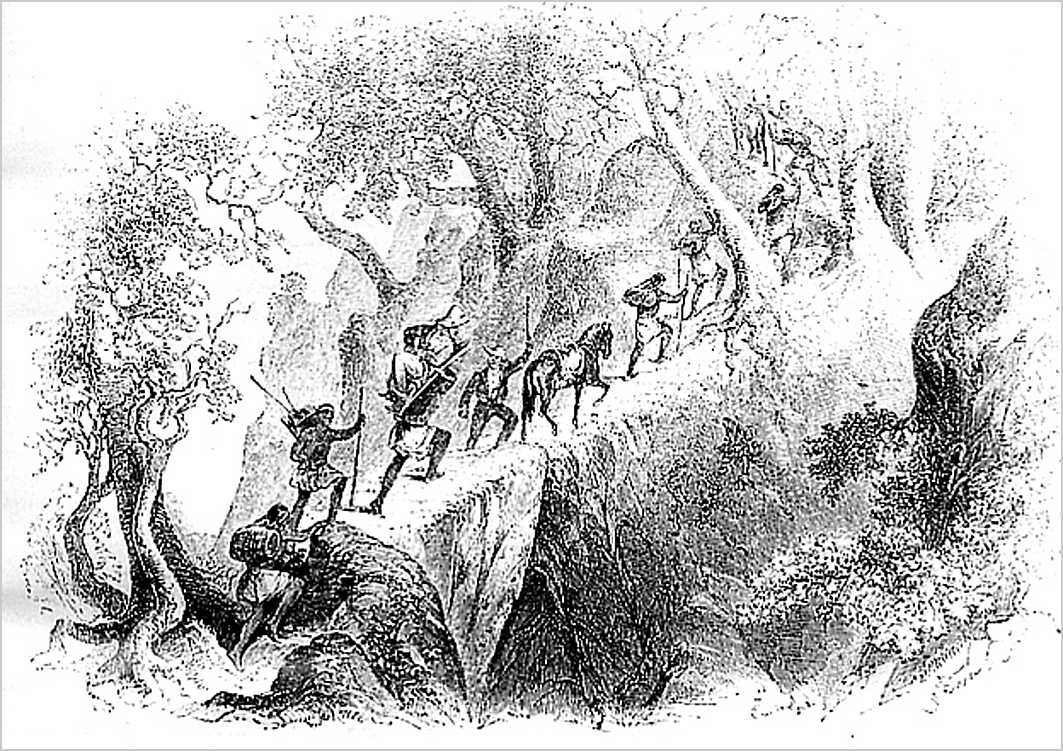











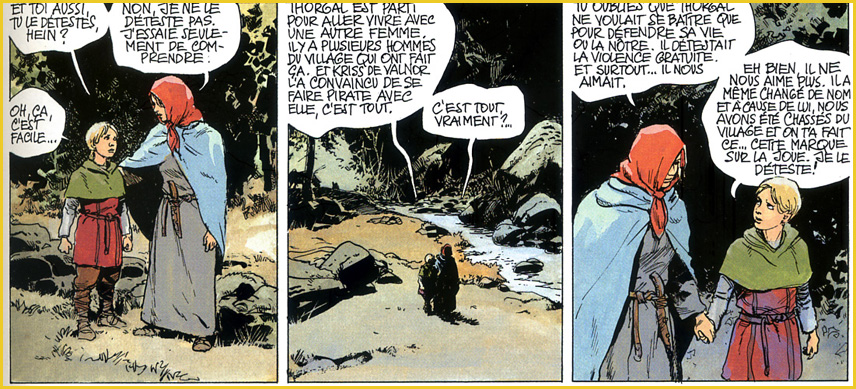






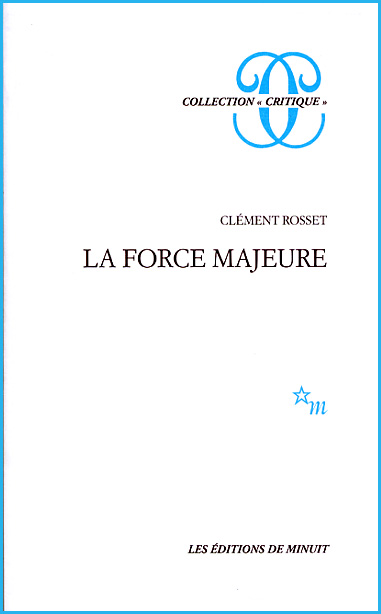












Commentaires récents