
Un bon roman à suspense écrit de façon originale. Tout part d’une petite annonce pour trouver une baby-sitter pour enfant de 5 ans, nourrie à condition qu’elle prépare les repas et logée dans un studio de 25 m² indépendant à côte de la grande maison dans un parc. Résumé par « un commandant » de police, il s’agit « d’un truc bien glauque dans une ville bien bourge » (p.166). On dirait plutôt les propos d’un adjudant, qui jadis menait les enquêtes, aujourd’hui, il faut qu’il ait au moins le grade de commandant – à quand le général ? L’histoire commence donc par un massacre en pleine nuit d’une famille aisée de Versailles avec trois enfants, par le père lui-même, au bout du rouleau. Un drame à la Dupont de Ligonès avec famille catho tradi, modèle maths-sup pour les garçons et machisme ambiant dans le couple.
Seule la baby-sitter en réchappe, puisqu’elle devait partir pour une semaine de vacances et que son train vers l’ouest a été supprimé par la SNCF pour « travaux » jusqu’au lendemain matin. Les éternels « travaux » de la SNCF qui, comme Sisyphe, pousse chaque année son rocher pour recommencer l’année suivante parce qu’il a dévalé. Laurie est décalée, issue d’un milieu populaire et élevée par sa mère seule, une égoïste inculte. Mais elle s’est attachée au petit dernier, Paul dit Polo, 5 ans, qui manque d’amour à la maison.
En effet, le père travaille beaucoup dans la sécurité informatique pour une société d’armement et n’est pas reconnu par son N+1, pervers narcissique typique. La mère est prof de maths mais en dépression depuis huit ans pour avoir perdu une petite Pauline de quelques mois à cause de la mort subite du nourrisson. Les deux autres enfants sont des mâles de 17 et 15 ans qui gardent leurs distances avec la jeune baby-sitter, poussés par leur père vers les maths et la physique, et engueulés pour leurs résultats pas toujours en progression.
S’ajoute à ce tableau de stress et d’amertume le fantôme d’un mystérieux « Nicolas » dont personne ne veut parler, et dont la chambre occupée un temps à l’étage a été condamnée, laissée en l’état et fermée à clé. Sauf qu’une fuite d’eau, due à une branche tombée du cèdre sur le toit lors d’une tempête versaillaise, exige son ouverture, ravivant des souvenirs qu’on aimerait mettre sous le tapis.
L’histoire est racontée par les témoins du drame, les principaux personnages de la famille, la baby-sitter la tante, les voisins, le commandant de police, des amis, des témoins au travail. Elle progresse ainsi par des visions croisées, partielles et complémentaires, dévoilant à mesure le drame de couple complexe qui s’est joué.
Le père a toujours été fêtard et flambeur, il est rattrapé par sa propension aux addictions en sombrant dans l’alcoolisme, d’autant que ça va mal dans son couple, mal à son travail, mal avec son banquier – et mal dans sa tête. Curieuse façon d’écrire, il « ouvre une bouteille de scotch ou de whisky » (p.94), comme si le scotch n’était pas un whisky d’Écosse – dirait-on « un scotch-terrier ou un chien »… ? Le père se sent coupable du naufrage qui vient, de plus en plus coupable.
La mère subit la violence de l’alcoolique qui sert d’exutoire aux frustrations, d’autant qu’elle reste passive, dans son rôle tradi de catho effacée, bien que n’étant pas mère au foyer. Ses enfants sont des garçons, ce pourquoi elle n’intervient pas pour eux. Laissé sans échanges sur l’oreiller ni à table, fautif d’avoir eu un moment de colère qui a fait rompre les ponts à « Nicolas », le père monte en pression. Son épouse et mère ne sert à rien, ni de raison ni de soupape, elle ne songe au contraire qu’à le fuir, dénier les problèmes, divorcer peut-être malgré la réprobation sociale catholique bourgeoise de la ville. Chacun se révèle victime et coupable, tournant en rond dans le huis-clos familial, accentué par les confinements Covid.
C’est l’impasse, donc le drame. Quand tout repose sur les épaules du père, accusé un peu vite de machisme par le féminisme d’ambiance, quand l’épouse reste sans rien tenter ni dire, préférant le confort mental de sa dépression et ses médocs adjuvants, quand les garçons n’osent pas dire ce qu’ils veulent et s’opposer – il finit par craquer. A l’effarement de Laurie, qui en parle au moins avec son psy. Les non-dits des souffrances sont ravageurs pour la personnalité, qu’on se le dise.
Oui, c’est un bon roman à suspense, original.
Hélène Rumer, Mortelle petite annonce, 2023, Pearlbooksedition Zurich, 201 pages, €18,00
Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com

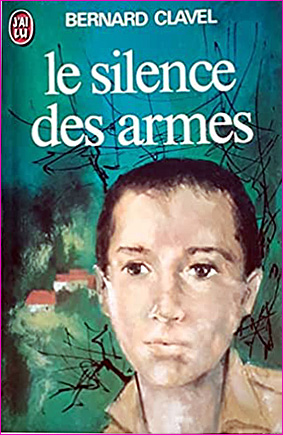





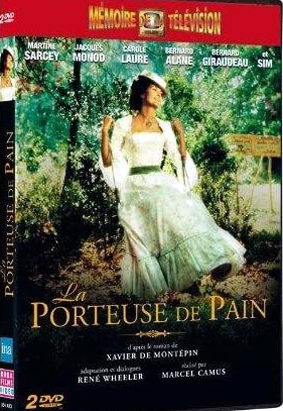

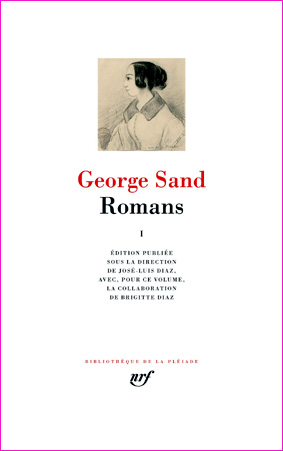
















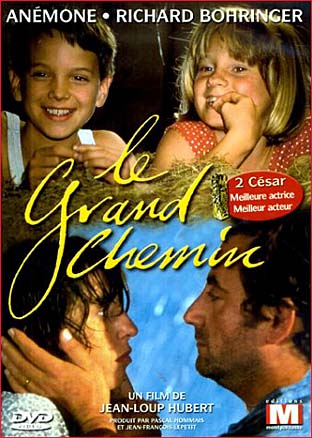










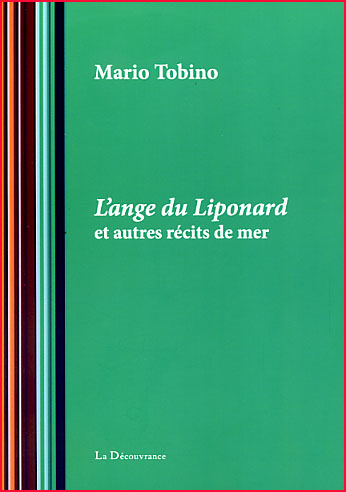









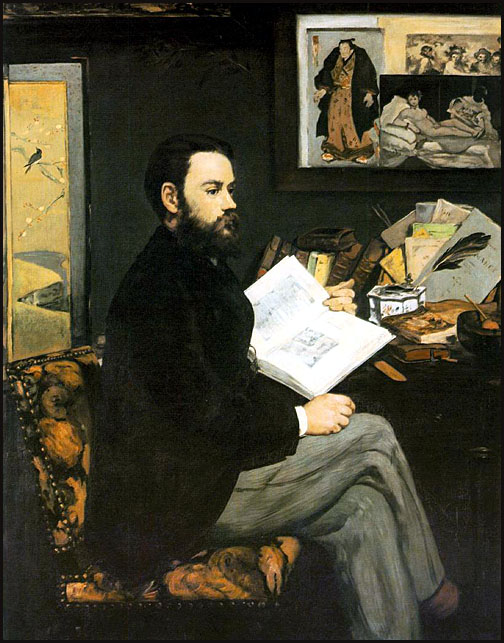


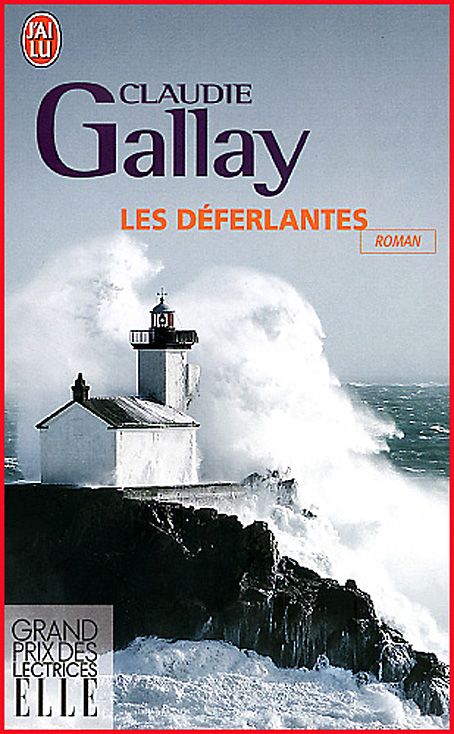
Commentaires récents