Un écrivain crée le personnage d’un écrivain pour écrire la biographie d’un écrivain.
Premier roman d’un russe écrit en anglais, en France, il fait phosphorer les spécialistes par ses mises en abyme. Car Sebastian Knight est un peu l’auteur, né la même année 1899, ayant connu le même amour à la datcha quand il avait 16 ans, éprouvé la même passion pour une Russe en 1937. Et le narrateur, dont on croit possible qu’il s’appelle Victor, le demi-frère de Sebastian né du même père, est un peu Vladimir lui aussi (qui a failli se prénommer Victor) ; Nabokov reproduit les relations compliquées qu’il a eues avec Sergueï, son frère cadet de dix mois plus jeune, musicien et homosexuel.
Et puis il est russe, comme lui : « Je suis né dans un pays où l’idée de liberté, la notion du droit, la pratique de la bonté humaine étaient choses froidement méprisées et brutalement proscrites. (…) Tout homme, dans ce pays, était un esclave s’il n’était un tyran ; et comme on y déniait à l’homme une âme et tout ce qui s’y rapporte, on en était venu à considérer qu’il suffisait d’infliger une douleur physique pour gouverner et diriger la nature humaine » p.406 Pléiade. Tant qu’il existera des Mélenchon et des Poutine, cette phrase restera d’actualité.
Sebastian est mort, d’une crise cardiaque, maladie héréditaire qui lui vient de sa mère. Plus âgé de dix ans que le narrateur, celui-ci l’a toujours admiré comme un grand frère mais n’a jamais osé lui déclarer, restant timidement à l’écart. Il aurait voulu se comporter en proche, mais il le fit trop tard, Sebastian était déjà mort – on dit toujours trop tard qu’on l’aime à quelqu’un. Non seulement nul ne fait jamais ce qu’il veut, faute de savoir justement son vrai vouloir, mais nul ne peut non plus connaître vraiment un autre, fut-il son frère. Chacun est seul et le reste. « La note dominante de la vie de Sebastian a été la solitude, et plus le destin essayait avec gentillesse de faire qu’il se sentit dans son élément, contrefaisant admirablement les choses qu’il pensait vouloir, plus nettement Sebastian se rendait compte qu’il n’était pas fait pour cadrer dans le tableau – dans aucun tableau » p.420. Sebastian, comme le saint, sera toujours percé de flèches pour sa différence. La connaissance intime comme la biographie vraie sont impossibles.
Dès lors, ce qui commence comme un récit recomposé de vie se transforme en un récit présent d’enquête sur une vie. Comme en physique, éclairer une particule la change, faire la lumière sur la vie d’un auteur n’éclaire qu’une facette du personnage – ce pourquoi toutes les biographies ont quelque chose de vrai, celle du pompeux et insipide Mr Goodman comme celle du narrateur. Nulle n’est vraie, chacune est vraisemblable.
Même « le sexe » n’explique pas tout, n’en déplaise à Freud et aux freudiens, que Vladimir Nabokov n’a jamais porté dans son cœur. « Laisser l’idée de ‘sexualité’, en admettant que la chose existe, tout envahir et s’en servir pour ‘expliquer’ tout le reste, est une grave erreur de raisonnement » p.469. L’auteur en sait quelque chose, qui est tombé amoureux d’Irina alors qu’il avait épousé Vera. Mais cette vague qui s’est brisée ne peut expliquer la mer tout entière, fait-il écrire Sebastian, cité par son demi-frère narrateur. « Les femmes de mœurs légères ont l’esprit lourd », se plaît-il à ajouter p.505. Ce qui est une vérité, je l’ai souvent constaté.
Même l’empathie la plus grande est au risque de passer à côté. Sebastian croit voir l’ombre de sa mère dans l’hôtel de Roquebrune où elle était descendue jadis – mais il s’est trompé de Roquebrune. Le narrateur, à la dernière heure, croit communiquer avec l’âme de Sebastian endormi qui respire dans la chambre d’hôpital à Saint-Damier – mais c’est un autre malade que le gardien peu lettré et endormi a indiqué.
Seule la recréation est légitime. D’où plusieurs textes et plusieurs personnages dans ce roman, beaucoup de masques, comme ce loup sur le visage que met un moment Sebastian pour lire son œuvre. Le vrai n’est qu’approché, il n’est que multiplication d’images plausibles et de faits vérifiés.
Mais pourquoi écrire sur la vie d’un autre ? Pour se couler en lui ou pour exister plus intensément soi ? Le désir est un manque-à-être disait Lacan.
Au total, pour un lecteur sans intention d’exégèse littéraire, le roman est séduisant. Il reprend des éléments « vrais » dans la vie de Nabokov et imagine des personnages différents qu’il est difficile de mettre en images. Sébastien est cet officier fléché pour sa foi différente – et soigné par les femmes ; Knight est le cavalier du jeu d’échecs qui se déplace en L en changeant de couleur de case mais reste une pièce mineure proche du fou. Comme tout est pensé chez Nabokov, le lecteur devra prendre cela en considération afin d’en tirer plaisir.
Vladimir Nabokov, La vraie vie de Sebastian Knight, écrit en 1939, publié en 1941 et revu en 1969, Gallimard Folio 1979, 320 pages, €8.30
Vladimir Nabokov, Œuvres romanesques complètes tome 2, Gallimard Pléiade 2010, édition de Maurice couturier, 1755 pages, €76.50 https://ww
Vladimir Nabokov chroniqué sur ce blog






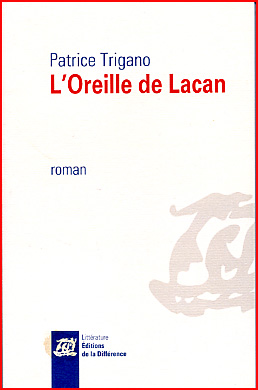
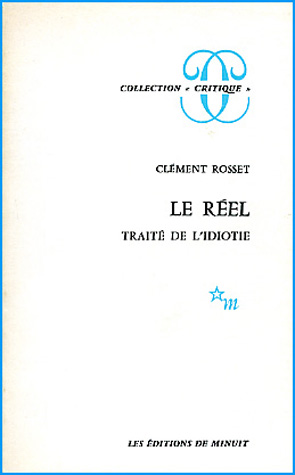
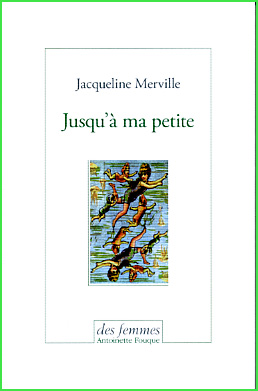

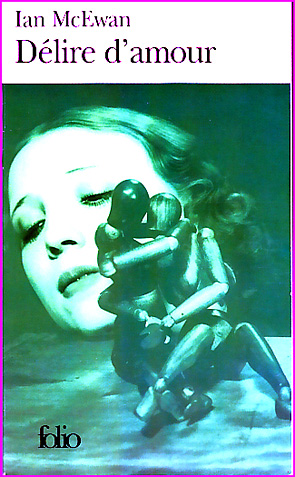


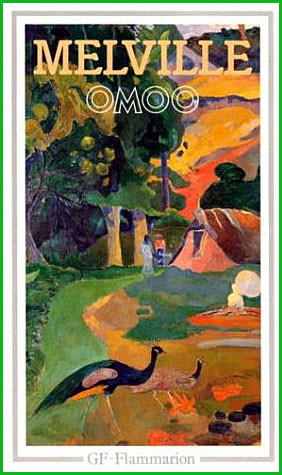

Commentaires récents