Le droit est, pour les Américains, la loi divine sur terre et ses avocats sont ses clercs et ses prêcheurs. Les lois sont si complexes et proliférantes qu’il ne faut rien moins que des spécialistes pour s’en débrouiller : où l’on retrouve la loi du plus fort chère aux pionniers, ou la loi du plus riche, ce qui revient là-bas au même. Qui a la puissance a l’argent donc les meilleurs avocats – et gagne ses procès.
Lorsqu’un jeune défenseur de Floride gagne trop souvent, le soupçon vient que le diable s’en mêle. Car faire acquitter un prof pédocriminel qui a attouché une ado de quatrième ingrate et bafouillante est un crime aux yeux de Dieu (s’il s’en préoccupe). Or il semble ne rien faire au nom du « libre arbitre ». L’être humain est libre depuis la Chute où la femme, séduite par le serpent, a croqué la pomme. La connaissance s’est révélée au couple humain et « ils virent qu’ils étaient nus » (quelle horreur ! au lieu d’en jouir ils en eurent « honte »). Désormais, ayant désobéi, à eux de se débrouiller tout seul dans la jungle terrestre et avec les autres humains qui prolifèrent à cause de la frénésie sexuelle. Kevin voit son client frétiller de la main sous la table lorsque l’adolescente raconte en pleurant comment il lui a mis la main sur le chemiser, puis l’autre sous la jupe et qu’il est remonté, de plus en plus haut, et ainsi de suite. Rien que le souvenir le fait bander et l’avocat lui dit qu’il irait jusqu’à éjaculer devant le juge ! Il s’aperçoit bien que son client est coupable mais, par vanité, lui qui n’a jamais perdu aucun procès, il ne veut pas laisser la justice gagner et, malin, va discréditer devant le jury la parole de la fille, moins innocente qu’elle ne paraît.
L’adaptation Hollywood du roman The Devil’s Advocate d’Andrew Neiderman, Kevin Lomax (Keanu Reeves, 33 ans) a la beauté du diable et l’habileté qui va avec. Après l’acquittement improbable du pédocriminel, une grande firme juridique de New York lui propose un pont d’or (à cinq chiffres) pour qu’il vienne seulement deux jours choisir un jury pour un procès. Il s’en tire avec les honneurs et son dirigeant John Milton (Al Pacino) décide de l’engager en créant pour lui un service d’avocat pénaliste au lieu d’envoyer les clients habituels vers d’autres cabinets.
Tout est trop beau pour être honnête : salaire mirobolant, appartement de fonction aux trois chambres dans un immeuble donnant sur Central Park, proximité du bureau, des commerces, des écoles et du staff de la firme qui loge dans le même immeuble réservé, d’étage en étage en fonction de la hiérarchie, le dernier au sommet étant réservé au chef. Composé d’une seule pièce immense, un grand feu y brûle toujours, été comme hiver, et une composition gigantesque du Paradis perdu du poète John Milton trône au-dessus du bureau principal.
Mary Ann, l’épouse de Kevin, n’aura plus à travailler mais se fera-t-elle au climat et à la trépidation de New York ? Kevin lui laisse le choix (encore le libre-arbitre). Mais est-on libre lorsqu’on est tentée ? Séduite par le fric et le luxe comme par le discours susurré du serpent Milton sur sa beauté et sa coiffure, elle se laisse tenter et croque la Grosse pomme. Elle va vite s’apercevoir de la fatuité des autres épouses qui ne pensent qu’à se regarder entre filles seins nus pour se faire valoir, dépenser en robes à 3000 $ portées une fois et à s’envoyer en l’air pour passer le temps. Est-ce cela la vie d’une épouse ? Attendre dans l’appartement immense et vide que son mari rentre à pas d’heures et qu’il la délaisse pour un boulot si prenant qu’il passe sa vie avec son patron plutôt qu’avec elle ? Mary Ann (les prénoms de la mère du Christ et de la mère de la Vierge) voudrait un enfant mais « on » (le diable ?) lui a, dit-elle, ôté les ovaires.
Kevin Lomax, de son côté, se prend au jeu et s’active. Son orgueil (plutôt que sa vanité, ainsi qu’il est traduit en français) est le plus grand des péchés capitaux car il voit l’homme tenter de s’égaler à Dieu, offense suprême ! Kevin ne veut jamais perdre et s’investit en totalité dans la défense de ses clients, même les plus vils salauds. Un promoteur immobilier très semblable à Trump, Alexander Cullen (Craig T. Nelson), très gros client de la firme pour se trouver constamment aux marges de la loi (plus de 1600 fois en un an…), est accusé d’avoir tué sa troisième femme, son beau-fils et sa domestique au pistolet en rentrant un soir chez lui. C’est un mégalomane menteur qui ne connait de vérités que celles qu’il affirme et qui compte bien être acquitté de toute accusation. Il va jusqu’à faire témoigner pour lui son assistante : il était en train de la baiser, trois heures durant, à l’heure des meurtres (« vous avez dû être éreintée », susurre malignement Lomax). Sauf que c’est probablement faux et que l’avocat malin s’en rend compte lorsque la fille ne sait même pas si Cullen est « coupé » (circoncis). Comme en Floride, Lomax va-t-il jouer le jeu du client ou celui de la justice ? Son patron Milton lui laisse clairement son libre-arbitre, puisque son épouse Mary Ann ne va pas bien : qu’il laisse l’affaire à un autre et qu’il s’occupe d’elle pour sauver son mariage. Mais est-on libre lorsqu’on est tenté ? L’orgueil parle une fois de plus – une fois de trop – et Lomax fait son métier au détriment de toute humanité. Le diable a gagné et ce pourrait bien être John Milton, patron cynique et sans aucun scrupule dont le sourire sardonique éclate trop souvent pour être honnête.
Mary Ann qui hallucine se réfugie à poil dans la plus proche église de son appartement et, lorsque son époux sort de sa plaidoirie pour la retrouver enveloppée dans un duvet rose de clocharde, sur appel d’une âme charitable, elle lui avoue que John Milton l’a baisée tout l’après-midi – le même argument que celui du promoteur. Or John Milton a assisté au procès aux côtés de Kevin Lomax durant tout ce temps. Déjà que Lomax l’avait surpris à parler plusieurs langues (chinois, italien, espagnol), ne voilà-t-il pas qu’il prend toutes les formes et peut se trouver en plusieurs lieux à la fois ? Si ce n’est pas la définition chrétienne du « diable », qu’est-ce donc ? La mère de Kevin, Alice au pays des Marvel comics (Judith Ivey) a fauté jadis avec un barman aux yeux de braise et a élevé seul son fils ; elle sait bien que New York est la Babylone de la Bible, où la Bête a établi ses quartiers, et que son Kevin a atteint 33 ans, l’âge du sacrifice du Christ. Mais son fanatisme obsessionnel à citer sans cesse les mêmes saintes Ecritures la dessert : qui peut croire en la répétition plutôt qu’en la dialectique ? Obéir à Dieu, c’est abolir toute pensée personnelle pour se soumettre et radoter ce qui est écrit une fois pour toute sans plus penser ; c’est donc abolir son humanité et son libre-arbitre. Est-ce sensé ? Mais le libre-arbitre est-il franchement libre ? La Bible ne guide-t-elle pas l’égaré sur les chemins du juste ?
Kevin fait donc interner Mary Ann qui, malgré les calmants, reste confuse. Quand Pam, l’assistante juridique de Milton (Debra Monk), tend à la jeune femme un miroir pour qu’elle se voit belle, elle aperçoit le visage démoniaque de l’assistante sous le masque de chair et brise le miroir ; elle prend un éclat et se tranche la gorge sous les yeux de son mari et de plusieurs témoins. C’est le moment (mal choisi pour Kevin Lomax) où sa mère lui avoue qui est son père et il déboule au dernier étage de l’immeuble Milton pour y trouver ce dernier avec une fille, Christabella (la belle Christ) que John lui présente comme sa sœur (Connie Nielsen). Ce qu’il lui apprend, je laisse le spectateur le découvrir, mais tout finit comme à Hollywood, avec le libre-arbitre mais dans les flammes et l’hystérie…
…Jusqu’à ce que Kevin Lomax se réveille dans les toilettes du tribunal de Floride du début, juste avant qu’il n’interroge la gamine abusée. Sa prescience le fait changer d’avis et « la justice » pourra peut-être passer. A moins que l’orgueil, toujours présent, ne compromette une fois de plus le processus, en abyme.
Les effets spéciaux ne manquent pas, des visages qui se diabolisent jusqu’à la fresque qui s’anime, faite par William Blake pour le Paradis perdu de John Milton, effet qui aurait coûté à lui seul deux millions de dollars. Keanu Reeves est parfait dans le rôle d’ange déchu ou de diable en herbe, juvénile séducteur de toutes les femmes ; Al Pacino est remarquable en Satan incarné, regard de braise pour les hommes et de baise pour les femmes, sourire méphistophélique qui n’atteint que les lèvres sans aller jusqu’aux yeux ; Charlize Theron est superbe en hystérique devenant progressivement folle à lier (l’hystérie étant une névrose d’origine sexuelle que le Moyen Âge a assimilé à la possession par le diable). La partition musicale angoissante de James Newton Howard ajoute au charme vénéneux du film. Je ne l’avais encore jamais vu, il est très bon.
Nous sommes dans l’extrême de l’Amérique : le tout est possible se transforme en tout peut-il être possible sans y perdre son âme ? Le pacte faustien de Goethe à la Renaissance rejoint l’ambition yuppie des années 1980 et 90 pour faire croire aux jeunes loups du droit, de la finance ou de la promotion immobilière qu’ils sont les maîtres du monde, les égaux de l’Éternel. Satan les tente par le sexe, l’argent, la gloire et le pouvoir. Ils en sont ivres et perdent leur humanité à l’image de Dieu au profit du diable qui en rit et les tient. S’ils trahissent par jalousie, ils sont exécutés, tel le directeur général Eddie Barzoon (Jeffrey Jones), tabassé à mort par deux clochards nègres (aux visages de démons) alors qu’il fait son jogging (à l’envers) autour de Central Park. L’enfer est désormais sur terre.
Il faut bien sûr entrer dans la mythologie chrétienne de Dieu, du Diable, de la tentation du Paradis perdu et de l’Enfer, mais cette culture se mérite tant elle continue d’irriguer tout ce qui vient des Etats-Unis. Une façon de prédire tout ce qui allait arriver en 2000 avec la chute des valeurs Internet en bourse, le krach séculaire de 2008 et l’arrivée du clown populiste Trump au pouvoir en 2016. Ce film apparaît comme une Apocalypse de saint Taylor.
DVD L’Associé du diable (The Devil’s Advocate), Taylor Hackford, 1997, avec Keanu Reeves, Al Pacino, Charlize Theron, Jeffrey Jones, Judith Ivey, Connie Nielsen, Craig T. Nelson, Ruben Santiago-Hudson, Tamara Tunie, Debra Monk, Warner Bros 1999, 1h18, €9.48 blu-ray €14.05









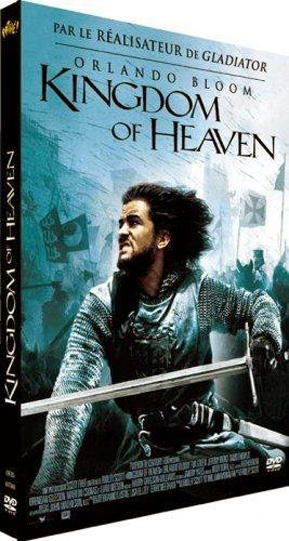




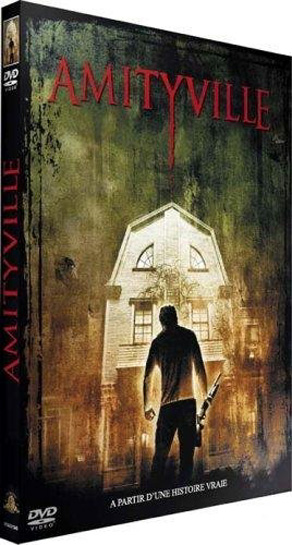





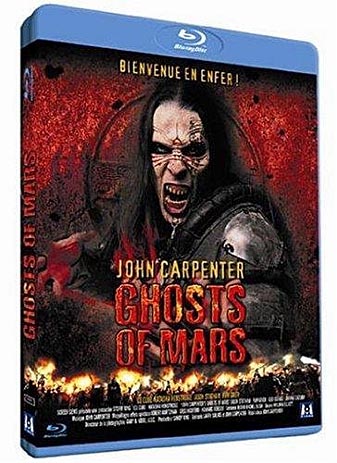


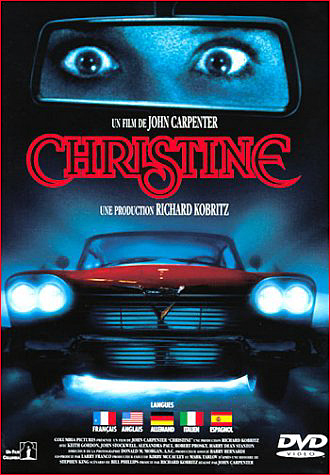




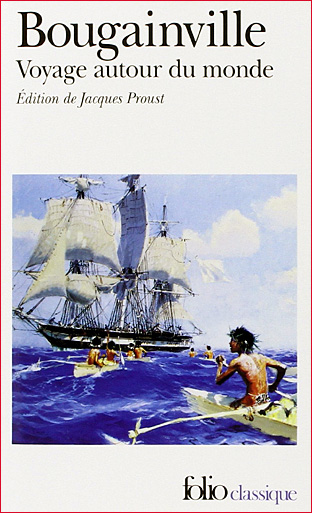


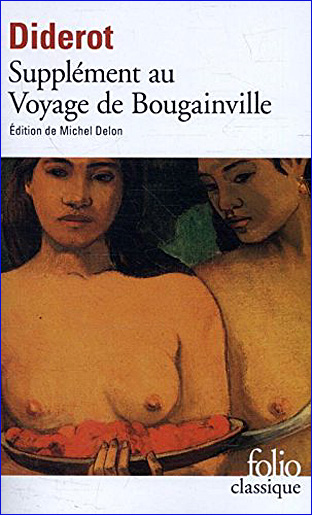














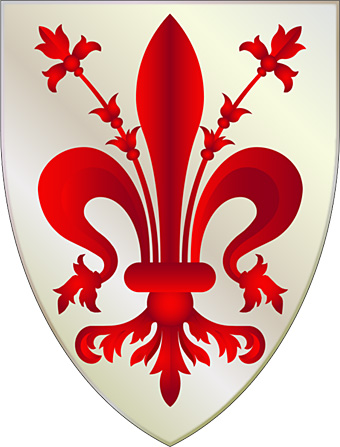


Commentaires récents