Quand l’ambition aveugle, poussée par une femme avide. La tragédie de Macbeth est celle du pouvoir qui rend fou, de l’hubris qui donnera le no limit post-68, l’orgueil renfermant soi-même dans sa paranoïa. Chacun peut citer Staline ou Hitler, mais aussi Manson le sectaire – qui fit assassiner un an avant le film Sharon Tate, l’épouse de Polanski.
D’où la violence, le sang qui gicle, la terreur qui prend. Mais aussi les prophéties, la croyance aux révélations, l’auto persuasion de son grand destin. Ce n’est pas par hasard, mais dans les conditions d’époque, qu’un tel film a pu être réalisé. Le « retour » au naturel est clairement anti-bourgeois après 1968 ; foin des délicatesses et des mignardises, la réalité doit être montrée crue. La guerre est sans merci, les armées pataugent dans la boue, les épées tranchent les têtes et fouaillent les entrailles, les poignards saignent les rois comme les enfants, les salles de bâfreries et beuveries ont le sol couvert de foin, les gens dorment nus sur la paille, ensembles sous leurs manteaux, le fils avec le père, les compagnons entre eux, les sorcières se réunissent à poil dans la fumée, dans les ruines d’un village détruit…
Ce choc va mal avec le texte en vers de Shakespeare, trop littéraire et trop bavard pour un film, d’où quelques longueurs. Nous ne sommes pas au théâtre mais sur la grève, parmi la lande ou à l’intérieur des lourds châteaux de pierre. Les humains sont ce qu’ils sont, en proie à leurs émotions incontrôlées, régis par leur inconscient bien plus que par la raison. La religion du Livre est omniprésente dans les esprits du XVIe siècle, année où William Shakespeare écrit sa tragédie. Macbeth est Caïn, il a tué son protecteur Duncan qui le traite comme un parent. Pour plaire à Dieu ? Non pas, mais à la prophétie des trois sorcières qui touillent leur bouillon sur la lande brumeuse enveloppée de pluie. Prophétie païenne tirée de la lecture des choses matérielles dans la fumée de l’hallucination, pratique anti-chrétienne et opposée à la raison classique. Des profondeurs du non-dit surgissent des monstres diaboliques et, quand l’inconscient règne, montre le dramaturge, les pulsions se déchaînent sans entraves.
Le scénario de l’histoire est connu – de ceux qui ont quelque culture, que certes l’éducation nationale n’assure plus, surtout en œuvres anglaises : trois sorcières (Maisie MacFarquhar, Elsie Taylor, Noelle Rimmington) marmonnent que Macbeth doit venir – en enfouissant un nœud coulant, un bras coupé et un poignard. Macbeth (Jon Finch, 29 ans) a assuré avec son ami Banquo (Martin Shaw) la victoire au roi Duncan (Nicholas Selby) contre les armées de Norvège et d’Irlande. En s’abritant sous des ruines, les deux capitaines rencontrent les trois sorcières qui, dans un rire grinçant, leurs annoncent que Macbeth aura le titre de Cawdor et deviendra roi, tandis que Banquo ne sera pas roi lui-même mais que sa descendance sera à la racine des rois futurs. Le thane de Cawdor est coupable de trahison et dépouillé de son armure pour être pendu torse nu avec de lourdes chaînes, et le roi donne son titre à Macbeth. La réalisation de cette première prophétie sème le germe de l’ambition chez le nouveau thane : pour qu’il soit roi, ainsi qu’il est prédit, il faut qu’il élimine Malcolm (Stephen Chase), fils de Duncan, et Duncan lui-même malgré ses bontés pour lui.
Bien qu’en proie aux affres du doute sur le bien-fondé de son acte, et se sentant coupable par avance de ce qu’il va faire, Macbeth finit par céder aux instances de sa femme, la vénéneuse Lady Macbeth (Francesca Annis, 26 ans) qui a versé un puissant soporifique dans les coupes des gardes royaux. La féminité est, pour les chrétiens depuis saint Paul, de l’ordre du diable ; la Bible elle-même accuse Eve d’avoir croqué le fruit défendu et d’avoir convaincu Adam de céder au serpent. Nous sommes bien dans ce mélange de chrétienté et de paganisme, le politiquement correct de l’époque faisant du second l’instrument du démon pour contrer le premier.
Une hallucination montre à Macbeth un poignard dans l’air qui lui indique la chambre du roi. Il le suit, passe les gardes endormis, se saisit de leurs dagues et finit par tuer Duncan dans une débauche de sang, visant n’importe comment dans la panique de l’acte. C’est Lady Macbeth qui va retourner dans la chambre, remettre les armes sanglantes dans les mains des gardes et les barbouiller du sang royal. Ils seront accusés au matin et massacrés par Macbeth avant qu’ils aient pu ouvrir la bouche pour démentir. Les deux fils de Duncan s’éclipsent et s’exilent, pensant être vite accusés puisque le crime leur profite.
Ne reste que Macbeth pour être élu roi, ce qui est fait par acclamations.
Mais la prophétie n’est pas finie et le destin se tisse quand on le laisse faire en croyant que tout est écrit. Banquo sera à l’origine d’une lignée de roi, il doit donc disparaître pour ne pas faire d’ombre à Macbeth. Mais les assassins, s’ils tuent Banquo au retour de la chasse, manquent son fils Fleance (Keith Chegwin, 14 ans au tournage) qui, plein de décision, parvient à fuir à cheval malgré son jeune âge ; son père se sacrifie pour lui en envoyant sa seule flèche au poursuivant, tandis que les autres lui brisent la colonne vertébrale d’un coup de hache. Macbeth, déstabilisé par ce demi-échec, croit voir le fantôme sanguinolent de Banquo lors du banquet qu’il organise avec ses hommes. C’est le milieu de la tragédie et le début de la fin : sa « folie » indispose ses compagnons, ils ne croient plus en lui, ils l’observent s’enfoncer dans la paranoïa et la terreur, ils le quittent un à un avant d’être soupçonnés à leur tour.
Macbeth, en proie au doute et sans volonté, s’en retourne voir les trois sorcières qui, cette fois, sont en nombre, entièrement nues à la lueur du feu de bois sur lequel bout un chaudron. Le breuvage qu’elles lui donnent lui font rêver d’une tête casquée lui disant de se méfier de MacDuff, d’un gosse sanglant qui lui dit que « nul homme né d’une femme » ne pourra le blesser, enfin d’un enfant couronné, un arbre dans une main, qui lui prédit encore que nul mal ne peut lui arriver tant que « la forêt de Birnam ne s’est pas mise en marche vers la colline de Dunsinane ».
MacDuff (Terence Bayler) s’est enfui en Angleterre rejoindre Malcolm et Macbeth ordonne qu’on saisisse son château par surprise et qu’on massacre ses gens, sa femme (Diane Fletcher) et ses enfants compris. Ce qui est fait dans une débauche de viols et de plaisir mauvais à éventrer et fouiller les corps au poignard, surtout celui du jeune fils du « traître » sortant du bain (Mark Dightam). Lady Macbeth, déstabilisée parce que les femmes sont meurtries par cette démesure, somnambulise à poil sous les yeux de sa suivante et du médecin appelé (Richard Pearson), parlant dans son sommeil et dévoilant tout. Elle ne cesse de se laver les mains d’une tache imaginaire, en Ponce Pilate qui a fait tuer le Christ.
Quand le pouvoir est aux mains de tels insanes, la tyrannie devient insupportable et le peuple gronde après les nobles. L’armée anglaise marche sur l’Écosse et les soldats se munissent de jeunes sapins qu’ils ont coupés dans la forêt de Birnam, vieille tactique de camouflage pour masquer leur nombre aux guetteurs du château. Mais, une fois encore, la prophétie se réalise et Macbeth se sait condamné. Ses gens aussi, à qui « sa langue » a maintes fois raconté ce qui est prédit, forçant le destin à accomplir ce que lui-même énonce. Tous le quittent, le château est ouvert, Lady Macbeth se jette du haut d’une tour, Macbeth est seul. Il a gardé la couronne sur son chef, mais n’a que son épée pour résister à l’armée. Il se croit invincible, puisque tous les humains sont nés d’une femme. Tous ? sauf un : MacDuff. Bien qu’ivre de rage Macbeth réussit à mettre à terre mais l’épargne, grand seigneur sur le tard ; ce sera sa perte car MacDuff est né par césarienne et non par les voies naturelles… MacDuff tue Macbeth tue en le perçant de part en part des reins à l’épaule, sous l’armure.
C’est alors le fils du roi Duncan, Malcolm, qui annonce le retour de l’ordre et se fait couronner roi d’Écosse sur la pierre de Scone.
Acteurs jeunes, paysages réalistes du Northumberland et château de Lindinsfarne, donnent à ce film sa rudesse réaliste. Il n’y a aucune complaisance pour montrer le sexe, sauf un viol entrevu par une porte lors du sac du château de MacDuff. Le thème est la violence, la croyance fanatique aux prophéties, l’anomie de la volonté. « Croire » que l’on a un destin vous enchaîne à son auto-réalisation. Vous n’êtes plus vous-mêmes, maître de soi, mais ballotté par les forces mauvaises de l’inconscient – proches du démon. Pour cela un grand film, à réserver aux adultes, seuls à même de prendre de la hauteur pour se sortir du réalisme des images et réfléchir sur les fins.
DVD Macbeth (The Tragedy of Macbeth) Roman Polanski,1971, avec Jon Finch, Francesca Annis, Martin Shaw, Terence Bayler, Nicholas Selby, Stephan Chase, Keith Chegwin, Sony Pictures 2002, 134 mn, €19.99 blu-ray €17.90

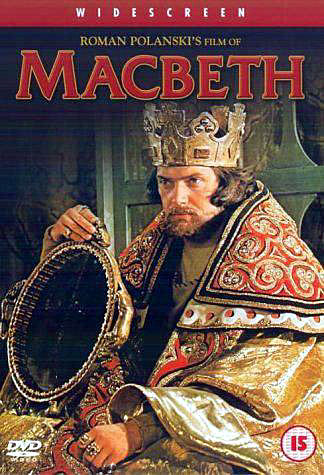



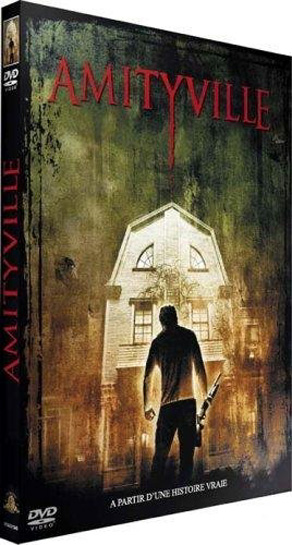




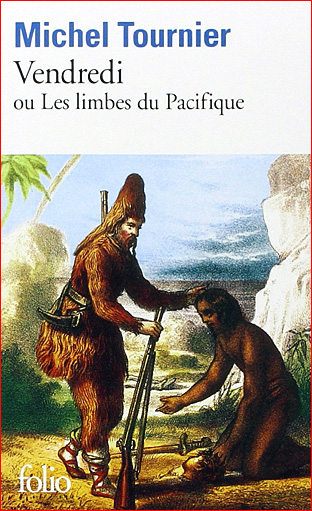
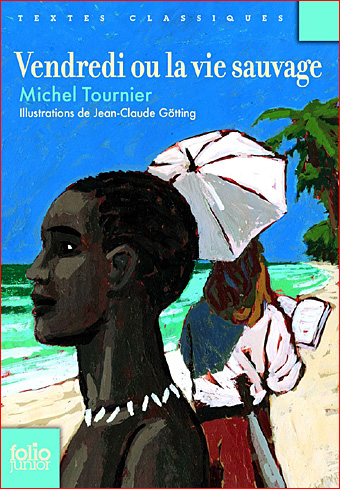
Commentaires récents