Dans le plus long essai des Essais, au chapitre XII du Livre II, Montaigne prend la défense d’un théologien catalan du 14ème siècle, Raymond Sebon. Sa Théologie naturelle a été publiée à sa mort à Toulouse en 1436 et le père de Montaigne, à qui un ami avait donné le livre, l’appréciait fort. Au point de demander à son fils de le traduire en français, ce qu’un bon rejeton ne pouvait « refuser au commandement du meilleur des pères qui fut oncques ». Montaigne entreprend cependant une critique radicale des thèses de Raymond Sebon, rébellion inconsciente contre le père ou avancée de ses connaissances due à la lecture assidue des antiques. Il dit ce qu’il pense au fond de Dieu, de la foi et de la connaissance humaine ; il y expose tout entier sa philosophie du ni trop, ni trop peu.
L’Apologie ne fait pas moins de 8,5 % de l’ensemble des Essais, 131 pages sur 852 dans l’édition Arléa, agrémentée de près de 220 citations ! Manie universitaire aujourd’hui, venue de la scolastique médiévale, façon pour Montaigne de se dédouaner de ce qu’il affirmait en ouvrant le parapluie de l’érudition. C’est que cet essai était destiné à Marguerite de Valois, épouse d’Henri de Navarre, protestant qui deviendra Henri IV par conversion d’opportunité au catholicisme. L’Église avait mis à l’Index le Prologue de Sebon en 1564 et Montaigne, qui était en train de le traduire et le publie dès 1569, prenait ses précautions.
Tout l’art de Sebon, issu de Thomas d’Aquin à ce qu’il semble, était de distinguer la science humaine de la science divine, donc le savoir terrestre (incertain, changeant, provisoire) du savoir divin (établi, immuable, éternel). « Il entreprend, par raisons humaines et naturelles, établir et prouver contre les athéistes tous les articles de la religion chrétienne ». Montaigne montre grâce à lui que tout ce qui est humain est relatif et que tout ce qui est divin est objet de foi. Le savoir s’établit dans le doute, la foi dans la croyance pure. Ni l’un, ni l’autre ne sont satisfaisants pour Montaigne ; il introduit le doute dans les deux. Pour la foi, il ne « croit pas que les moyens purement humains en soient capables » (de la prouver). Mais – « il ne faut pas douter que ce ne soit l’usage le plus honorable que nous leur saurions donner, et qu’il n’est occupation ni dessein plus digne d’un homme chrétien que de viser par tous ses études et pensements à embellir, étendre et amplifier la vérité de sa croyance. »
Car le savoir exige précaution et méthode, il n’est pas à la portée de tout le monde. Et la croyance soumission complète, exclut aussitôt quiconque diverge. Ce livre fut donné au père de Montaigne « lorsque les nouvelletés de Luther commençaient d’entrer en crédit et ébranler en beaucoup de lieux notre ancienne croyance. En quoi il (…) prévoyait bien, par discours de raison, que ce commencement de maladie déclinerait aisément en un exécrable athéisme ; car le vulgaire, n’ayant pas la faculté de juger des choses par elles-mêmes, se laissant emporter à la fortune et aux apparences, après qu’on lui ait mis en main la hardiesse de mépriser et contrôler les opinions qu’il avait eues en extrême révérence, comme sont celles où il va de son salut, (…) il jette tantôt après aisément en pareille incertitude toutes les autres pièces de sa croyance (…) et secoue comme un joug tyrannique toutes les impressions qu’il avait reçues par l’autorité des lois ou révérence de l’ancien usage. » Ce luthéranisme, qui est jugement par chacun des saintes écritures, est la crainte aujourd’hui de tous les théologiens d’État, que ce soient Khamenei en Iran, Erdogan en Turquie, Poutine en Russie ou Xi en Chine. Tous récusent le relativisme et le jugement personnel, au profit de la foi intangible (fût-elle profane) et de la tradition. Ce que fit l’Église catholique durant des siècles.

Quant à la foi, elle peut être affirmée sans être vécue… « Notre zèle fait merveille, quand il va secondant notre pente vers la haine, la cruauté, l’ambition, l’avarice, la diffamation, la rébellion. (…) Notre religion est faite pour extirper les vices ; elle les couvre, les nourrit, les incite. » Ce que la religion catholique a montré à Montaigne lors de la saint Barthélémy, la foi révolutionnaire l’a montré en 1792 lors de la Terreur, la foi nazie dans les camps de Juifs, la foi communiste lors des Procès de Moscou, la foi intégriste de Daech en Syrie et ailleurs en Iran chiite, la foi communiste chinoise contre les Tibétains et les Ouïghours. Notre religion n’est que celle du pays où nous sommes nés, constate Montaigne. « Nous nous sommes rencontrés au pays où elle était en usage ; où nous regardons son ancienneté ou l’autorité des hommes qui l’ont maintenue ; ou craignons les menaces qu’elle attache aux mécréants ; ou suivons ses promesses. » Ce sont liaisons humaines, pas divines. Notre sagesse n’est que folie devant Dieu. « Est-il possible de rien imaginer si ridicule que cette misérable et chétive créature, qui n’est pas seulement maîtresse de soi, exposée aux offenses de toutes choses, se dire maîtresse et empérière de l’univers, duquel il n’est pas en sa puissance de connaître la moindre partie, tant s’en faut de la commander ? » Une telle charge contre l’esprit prométhéen de l’humanité se devait d’être citée.
Car pour Montaigne l’homme est avant tout présomption. Elle « est notre maladie naturelle et originelle ». Ce pourquoi il faut douter de tout et ne croire en rien. Rien n’est établi, sauf « Dieu » – Montaigne ne va pas jusqu’à remettre en cause la Cause première, bien que son discours y tende. « C’est par la vanité de cette même imagination qu’il s’égale à Dieu, qu’il s’attribue les conditions divines ». Donc même le doute doit être lui-même objet de doute. Dans cette incertitude fondamentale – très moderne – il faut rester dans le juste milieu : suivre son temps sans excès, douter sans cesse sans pourtant cesser de vivre. « De toutes les opinions humaines et anciennes touchant la religion, celle-là me semble avoir eu plus de vraisemblance et plus d’excuse, qui reconnaissait Dieu comme une puissance incompréhensible, origine et conservatrice de toute choses, toute bonté, toute perfection ». Ne cherchons donc pas à comprendre l’au-delà et conservons ce qui nous est donné ici-bas.
Montaigne se montre libéral au sens de l’humanisme : conservateur par les règles mais ouvert à tout changement. « Il ne faut pas laisser au jugement de chacun la connaissance de son devoir ; il le lui faut prescrire, non le laisser choisir à son discours ; autrement, selon l’imbécilité et variété infinie de nos raisons et opinions, nous nous forgerions enfin des devoirs qui nous mettraient à nous manger les uns les autres, comme dit Épicure ». Ce que répétera Hobbes avec son homme loup pour l’homme, ce que répètent à l’envi les libertariens américains adeptes du chacun pour soi et de la loi du plus fort. Ils savent bien que les « créateurs de valeurs », comme les appelle Nietzsche, les leaders d’opinion, les charismatiques, n’entraînent et ne gouvernent que ceux qui ont peur de leur propre liberté et qui se réfugient sous leur aile. Pour ceux-là, la foi est indispensable. « Voulez-vous un homme sain, demande Montaigne, le voulez-vous réglé et en ferme et sûre posture? affublez-le de ténèbres, d’oisiveté et de pesanteur. Il nous faut abêtir pour nous assagir, et nous aveugler pour nous guider ». Les théories du Complot et la désignations des diables ennemis (ainsi les « nazis » ukrainiens pour les Russes) sont les ténèbres, tout comme les affres de l’enfer dans l’au-delà, la pesanteur des tu-dois et des commandements. Le plus sage (comme on le dit à l’école) est le plus bête : il obéit en silence. « Ce n’est pas par discours ou par notre entendement que nous avons reçu notre religion, c’est par autorité et par commandement étranger. La faiblesse de notre jugement nous y aide plus que la force, et notre aveuglement plus que notre clairvoyance. » La tyrannie douce des réseaux sociaux, hier des cancanières au village, est là pour en témoigner…
Ce qui n’empêche pas le jugement personnel sur la religion et sur la foi, selon Montaigne. « Quand Mahomet promet aux siens un paradis tapissé, paré d’or et de pierreries, peuple de garces d’excellente beauté, de vins et de vivres singuliers, je vois bien que ce sont des moqueurs qui se plient à notre bêtise pour nous emmieller et attirer par ces opinions et espérances, convenables à notre mortel appétit. » Pourquoi ne pas mourir de suite si c’est mieux après ? Dieu est autre que cet adepte du marketing. « Il m’a toujours semblé qu’à un homme chrétien cette sorte de parler est pleine de démesure et d’irrévérence : Dieu ne peut mourir, Dieu ne se peut dédire, Dieu ne peut faire ceci ou cela. Je ne trouve pas bon d’enfermer ainsi la puissance divine sous les lois de notre parole. (…) Notre parler a ses faiblesses et ses défauts, comme tout le reste. La plupart des occasions des troubles du monde sont grammairiennes. » Dans les faits, « nous n’avons aucune communication à l’être, parce que toute humaine nature est toujours au milieu entre le naître et le mourir, ne baillant de soi qu’une obscure apparence et ombre, et une incertaine et débile opinion. » Au contraire de Dieu, concept « réellement étant, qui, par un seul maintenant, emplit le toujours. »
D’où ce conseil ultime du juste milieu à Marguerite de Valois, de l’humilité face à l’ampleur de l’ignorance que l’on aura toujours du monde. « Tenez-vous dans la route commune, il ne fait mie bon être si subtil et si fin. (…) Je vous conseille, en vos opinions et en vos discours, autant qu’en vos mœurs et en toute autre chose, la modération et la tempérance, et la fuite de la nouvelleté et de l’étrangeté. Toutes les voies extravagantes me fâchent. » Car, il faut en être conscient, « notre esprit est un outil vagabond, dangereux et téméraire ; il est malaisé d’y joindre l’ordre et la mesure. » Aussi, « on a raison de donner à l’esprit humain les barrières les plus contraintes qu’on peut. En l’étude, comme au reste, il lui faut compter et régler ses marches, il lui faut tailler par art les limites de sa chasse. On le bride et garrotte de religions, de lois, de coutumes, de science, de préceptes, de peines et récompenses mortelles et immortelles ; encore voit-on que, par sa volubilité et dissolution, il échappe à toutes ces liaisons. » D’où la discipline inculquée dès la naissance aux enfants, la méthode scientifique pour ne pas divaguer, les lois juridiques pour rester dans les clous, la constitution pour établir la loi fondamentale – et ainsi de suite, jusqu’à la morale commune qui fixe les limites. La liberté ne va jamais sans règles – sinon elle devient licence et tyrannie, pour les autres comme pour soi.
Cet essai est touffu, fort long et digressif, Montaigne ne cesse de dire « mais revenons à notre propos ». Il est à l’image d’un esprit fantasque qui suit son plaisir et s’affranchit des contraintes, ce qui l’oblige à corriger à grand peine ses essais. « Je ne sais ce que j’ai voulu dire, et m’échauffe souvent à corriger et y mettre un nouveau sens, pour avoir perdu le premier, qui valait mieux. Je ne fais qu’aller et venir : mon jugement ne tire pas toujours avant ; il flotte, il vague ». On ne saurait mieux dire ni juger de ses propres défauts.
Un grand texte de Montaigne, même s’il est lourd à lire.
Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Claude Pinganaud), Arléa 2002, 806 pages, €23.50
Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Bernard Combeau et al.) avec préface de Michel Onfray, Bouquins 2019, 1184 pages, €32.00
Montaigne sur ce blog
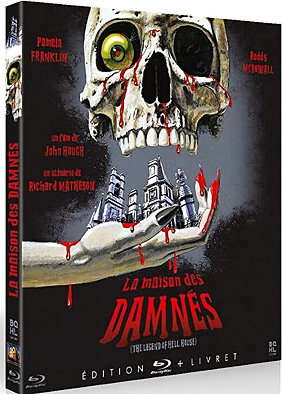































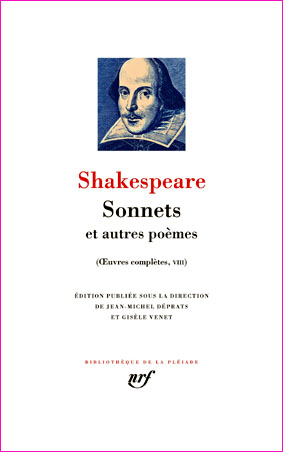






















Voltaire, la raison et les injures
A propos du Contrat Social de Rousseau – brûlé à Genève – François Marie Arouet – dit Voltaire – écrit :
« Si ce livre était dangereux, il fallait le réfuter. Brûler un livre de raisonnement, c’est dire : nous n’avons pas assez d’esprit pour lui répondre. Ce sont les livres d’injures qu’il faut brûler et dont il faut punir sévèrement les auteurs, parce qu’une injure est un délit » (Idées républicaines, 1762).
Il y aurait tant à dire de notre époque contemporaine, dans le style de Voltaire !
« Nous n’avons pas assez d’esprit pour lui répondre » s’applique évidemment aux cléricaux de toutes religions et de toutes idéologies, et aux imbus d’eux-mêmes (ou d’elles-mêmes). Plus particulièrement en France aux politiciens, aux histrions des médias, aux auteurs qui veulent faire leur pub mais n’acceptent pas la critique, aux blogueurs qui ne « commentent » que pour dire leur réaction. Et tant d’autres.
« Pas assez d’esprit », pensez-y ! Voltaire faisait de la raison, cette faculté d’intelligence, le « bon » sens au-dessus des cinq que sont le regard, l’ouïe, le toucher, l’odorat et le goût.
Nous le voyons sans peine, cette faculté de penser est bien rare parmi les politiciens, les histrions des médias et les blogueurs qui « commentent ». Bien sûr elle existe, mais elle est bien trop rare, mise en sommeil, effacée pour « ne pas avoir l’air », dans le désir d’être conforme à la masse, au plus petit con des nominateurs qui écoutent, lisent ou regardent.
Car il s’agit (séquelles de mai 68 ?) d’être dans le spontané, l’immédiat, le réactif, en ado attardé mû par son seul désir du moment, corps excité, cœur léger, esprit frivole.
« Si ce livre était dangereux, il fallait le réfuter. Brûler un livre de raisonnement, c’est dire : nous n’avons pas assez d’esprit pour lui répondre. Ce sont les livres d’injures qu’il faut brûler et dont il faut punir sévèrement les auteurs, parce qu’une injure est un délit. » Mais tout mot bizarre qui n’est pas dans le répertoire des 400 mots usuels est considéré comme injure. Evoquez le « grotesque » et on se sentira blessé : le mot signifie pourtant simplement « qui fait rire par son extravagance » – lequel dernier mot veut dire « hors de l’ordinaire, du convenu, celui qui vague en-dehors ».
Il est piquant que dans la langue de Voltaire les mots soient imprécis, qu’au pays de Voltaire les propos de Voltaire soient ignorés, les idées de Voltaire soient inappliquées et que le tempérament libéral de Voltaire soit honni par ceux qui prétendent « libérer » les hommes.