Curieux choc des époques… comme quoi la nature humaine reste la même au travers des siècles. Dans le chapitre L’Enchanteur,« Zarathoustra vit, non loin de là, au-dessus de lui, sur le même chemin, un homme qui agitait ses membres comme un fou furieux… » Peut-être est-il l’homme supérieur qu’il cherche ?
Las ! C’est un vieillard qui joue la comédie. Il se lamente que personne ne l’aime, que tout complote contre lui, « soumis à toutes les tortures éternelles ». Un hâbleur que Zarathoustra n’hésite pas à bastonner avec force de sa canne. « Comédien ! Faux-monnayeur ! fieffé menteur ! je te reconnais bien ! » Nous, nous avons reconnu sans conteste Trump le trompeur , 79 ans lorsqu’il sera à nouveau président.
« Que parles-tu de vérité ? Toi, le paon des paons, mer de vanité, qu’as-tu joué devant moi, vilain sorcier ? » L’homme supérieur serait un être charismatique chargé de prendre en main le destin des masses et de redonner sens à leur histoire par son œuvre exemplaire, un homme qui s’est efforcé de réaliser en soi une synthèse supérieure de l’humain. En bref un enfant rieur qui danse, pas un chameau qui se plaint du fardeau de vivre. Le vieillard, pas plus que Trump, n’est pas un homme supérieur mais son illusion pour les masses, sa baudruche comme un doudou compensateur.

« C’est l’expiateur de l’esprit que je représentais, répondit le vieillard (…) l’enchanteur qui finit par tourner son esprit contre lui-même, celui qui est transformé et que glace sa mauvaise science et sa mauvaise conscience ». Trump, gosse de riche avec des pulsions égotistes de gamin de 2 ans (la première adolescence), hostile à toute frustration, a tourné son esprit et ses capacités à arnaquer ses semblables. Dans l’immobilier où il fut promoteur, comme citoyen en échappant à l’impôt, comme candidat en affirmant n’importe quoi pourvu que ça mousse, comme président en croyant que le « deal » – son seul mantra – permet de tout négocier à son profit (cela n’a pas marché avec le tyranneau nucléaire de Corée du nord, ni avec la Chine), avec la démocratie en contestant les résultats des élections. Trump est le Trompeur, adepte des fausses vérités, qu’il appelle « alternatives » pour faire croire qu’elles sont vraies. Un Trump qui croit même à ses inepties : il s’est bourré d’hydroxychloroquine pour éviter le Covid… et il l’a attrapé, restant malade comme un chien une longue semaine.
« Que je t’ai trompé à ce point, c’est ce qui faisait intérieurement jubiler ma méchanceté », déclare le vieillard (et Trump très probablement). Zarathoustra avoue sa faiblesse, qui est celle de tous ceux épris de vérité et d’empathie pour ses semblables : « Je ne suis pas sur mes gardes devant les trompeurs, il faut que je néglige les précautions. » Mais il a percé à jour ce vieux comédien : « Mais toi – il faut que tu trompes : je te connais assez pour le savoir ! il faut toujours que tes mots aient un double, un triple, un quadruple sens. » Ainsi sont les fausses vérités,elles recèlent toujours quelque-chose que l’on peut croire en partie, cachées derrière le reste, pour embrumer les esprits.
Zarathoustra le transperce de son trait apollinien de clarté. La vérité, c’est que le vieux enchante tout le monde, mais plus lui-même. « Pour toi-même tu es désenchanté ! Tu as moissonné le dégoût comme ta seule vérité. Aucune parole n’est plus vraie chez toi, mais ta bouche est encore vraie : c’est-à-dire le dégoût qui colle à ta bouche. » A ces mots qui le révèlent en pleine lumière, le vieillard a une réaction d’orgueil offensé, bien dans sa nature congénitalement fausse : « Qui a le droit de me parler ainsi, à moi qui suis le plus grand des vivants aujourd’hui ? (…) J’ai voulu représenter un grand homme et il y en a beaucoup que j’ai convaincus : mais ce mensonge a surpassé ma force. C’est contre lui que je me brise. » Il manque encore à Trump de se rendre compte, comme le vieillard de Nietzsche, qu’il est menteur par construction. Qu’encourager ses partisans à marcher sur le Capitole pour contester le résultat des élections n’est pas digne d’un président des États-Unis. Contestera-t-il les résultats, s’il est élu ?
Trump, comme le vieillard face à Zarathoustra, est la grenouille de la fable. « J’en ai déjà tant trouvé qui s’étiraient et qui se gonflaient, tandis que le peuple criait : voyez donc, voici un grand homme ! Mais à quoi servent tous ces soufflets de forge ! le vent finit toujours par en sortir. La grenouille finit toujours par éclater, la grenouille qui s’est trop gonflée : alors le vent s’en échappe. Enfoncer une pointe dans le ventre d’un enflé, c’est ce que j’appelle un bon divertissement. »
Hélas ! « Notre présent appartient à la populace : qui sait encore ce qui est grand ou petit ? Qui chercherait encore la grandeur avec succès ! » En effet, on se demande… Les peuples élisent des bouffons, de Boris Johnson et son Brexit à Poutine et son rêve hitlérien d’empire pour mille ans, de Netanyahou qui ne cherche qu’à contrôler la Knesset pour faire voter la loi qui va amnistier ses malversations à Trump qui va favoriser les super-riches et les aider à échapper encore un peu plus à l’impôt.
Heureusement, les bouffons sont toujours rattrapés par leur démesure et les enflures finissent par crever. Il suffit d’y enfoncer une pointe, dit Nietzsche…
(J’utilise la traduction 1947 de Maurice Betz au Livre de poche qui est fluide et agréable ; elle est aujourd’hui introuvable.)
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire) :
Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, 1884, traduction Geneviève Bianquis, Garnier Flammarion 2006, 480 pages, €4,80 e-book €4,49
Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra – Œuvres III avec Par-delà le bien et le mal, Pour la généalogie de la morale, Le cas Wagner, Crépuscule des idoles, L’Antéchrist, Nietzsche contre Wagner, Ecce Homo, Gallimard Pléiade 2023, 1305 pages, €69.00
Nietzsche déjà chroniqué sur ce blog






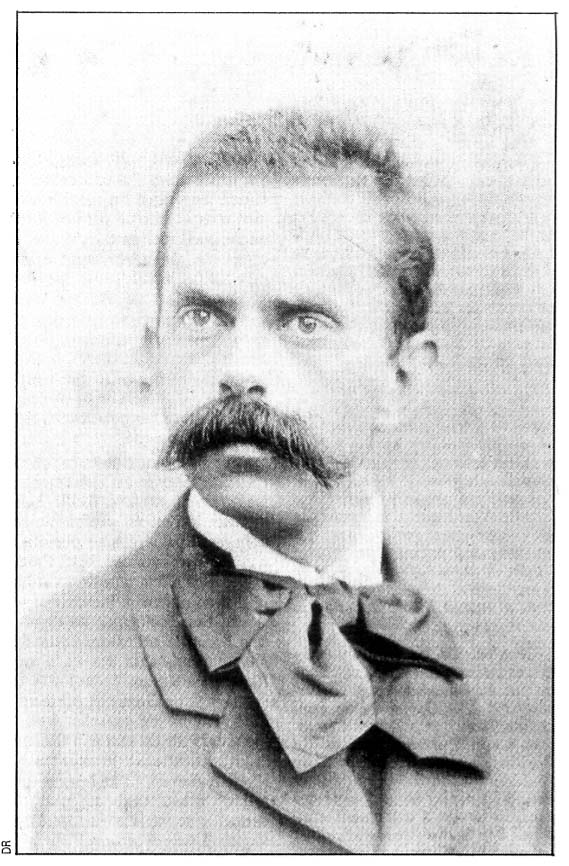






Commentaires récents