Le curieux chapitre des Discours de Zarathoustra intitulé « De l’ami » fera grincer quelques dents. Il est en effet plutôt sibyllin. L’individu ermite dans sa coquille commence par « il y a toujours quelqu’un de trop auprès de moi ». Mais la solitude rend fou : « Je et Moi sont toujours en conversation trop animée : comment supporterait-on cela si l’on n’avait pas un ami ? » se demande Nietzsche. La solitude entraîne vers les profondeurs de soi, pas vers le haut de l’homme – qui doit être surmonté. « Notre désir d’un ami est notre témoin ».
L’amitié est donc une façon de sortir de soi pour évoluer, se surmonter. « Souvent l’amour ne sert qu’à surmonter l’envie. Souvent l’on attaque et l’on se fait un ennemi pour cacher que l’on est soi-même exposé. » Le respect véritable de « celui qui n’ose pas solliciter l’amitié », demande que l’on soit au moins son ennemi. Car seul le débat avec quelqu’un d’autre que soi-même peut permettre d’aller au-delà de soi et d’avancer.
Suit un développement sur le meilleur ennemi. « Si l’on veut avoir un ami, il faut aussi vouloir se battre pour lui : et pour se battre, il faut être capable d’être ennemi. » C’est-à-dire de s’opposer, de ne pas toujours « être d’accord » comme nous enjoignent trop souvent la moraline commune et les réseaux sociaux, cette réduction au médiocre et au banal des personnalités. « Ton ami doit être ton meilleur ennemi. C’est quand tu luttes contre lui que tu dois être le plus près de son cœur. » Car l’amitié est exigeante, elle n’est pas fusionnelle. Il s’agit du choc des personnes qui élève, pas de faire œuf ou nid qui engluent.

D’où la distance nécessaire à ce que chacun se préserve de l’autre, le quant à soi qui n’est pas duplicité mais pas entière vérité non plus. En témoignent ces phrases quelque peu ambiguës sur l’amitié entre hommes : « Tu ne veux pas t’envelopper de voiles devant ton ami ? Tu veux faire honneur à ton ami en te donnant à lui tel que tu es ? Mais c’est pourquoi il t’envoie au diable ! » L’hygiénisme et le naturel romantique avaient développé le nudisme en Allemagne, peut-être est-ce à cela que Nietzsche fait référence ? Sa pruderie protestante, due à son éducation, l’inhibait en ce sens. L’attirance du désir est pour lui incompatible avec l’amitié, il le dira à propos des femmes. Un ami, c’est un partenaire en esprit, pas un corps fusionnel. « Qui ne sait se dissimuler provoque l’indignation : voilà pourquoi il faut craindre la nudité ! Ah, si vous étiez des dieux, vous pourriez avoir honte de vos vêtements ! » Mais les dieux ne sont pas contraints par les désirs, ils les surmontent.
Les hommes le doivent aussi, et pour cela s’habiller. « Tu ne saurais assez bien t’habiller pour ton ami : car tu dois être pour lui une flèche et un désir dirigé vers le Surhomme ». Pas vers le semblable mais vers le plus. Regarder dormir son ami, dit Nietzsche, montre son propre visage en miroir imparfait. De quoi désirer le Surhomme plutôt que l’homme que l’on est.
« Es-tu un esclave ? Tu ne peux donc pas être un ami. Es-tu un tyran ? Tu ne peux donc pas avoir d’amis. »
Suit un développement sur la femme, dont on sait que Nietzsche avait une expérience malheureuse et une méfiance profonde. Élevé par des femmes, tenu en pruderie jusque fort tard dans sa vie, baladé par la Salomé qui consommait les mâles par vide essentiel et vanité, contaminé par la syphilis qui le rendra fou, le philosophe avait tout pour haïr la gent femelle. Sa sœur même, qui avait épousé un futur nazi, tordra son œuvre posthume en publiant La volonté de puissance, un ramassis de notes éparses que Nietzsche n’aurait certainement pas publié tel quel. Mais ses remarques acides ne sont pas dénuées de fondement.
« Pendant trop longtemps un esclave et un tyran ont été cachés dans la femme. » Ce n’est pas faux, étant donnée la condition faite aux femmes par la domination millénaire des hommes, encouragée par les religions du Livre. « C’est pourquoi la femme n’est pas encore capable d’amitié : elle ne connaît que l’amour. » Tout est dans le « pas encore », ce qui laisse une perspective d’évolution de la condition féminine pour Nietzsche. L’amitié suppose en effet l’égalité, pour regarder ensemble dans la même direction, au lieu de s’entre-regarder dans la fusion amoureuse. « Dans l’amour de la femme, il y a de l’injustice et de l’aveuglement à l’égard de tout ce qu’elle n’aime pas. » L’hystérie des mitou ne fait que prouver tant et plus cette assertion en nos temps désorientés. « Des chattes, voilà ce que restent les femmes, des chattes et des oiseaux. Ou, en mettant les choses au mieux, des vaches. » Bien que ces références animales soient plaisantes, et peut-être au second degré (les chattes griffent et ronronnent, les oiseaux chantent bêtement, les vaches ruminent et allaitent), nous laissons à l’auteur son propos. A chacun de le méditer s’il le souhaite.
Propos qu’il tempère d’ailleurs aussitôt : « La femme n’est pas encore capable d’amitié. Mais, dites-moi, vous hommes, qui d’entre vous est donc capable d’amitié ? » En effet, il existe couramment de la camaraderie, mais peu d’amitiés véritables. Au mitan de sa vie, chacun peut les compter sur les doigts d’une seule main. Les « amis » des réseaux ne sont que des relations (plus ou moins utiles, sans plus), pas de véritables amis sur qui l’on peut compter. Pourquoi ? « Maudites soient votre pauvreté et l’avarice de votre âme, ô hommes ! Ce que vous donnez à vos amis, je veux le donner même à mon ennemi, sans en être appauvri. » Sommes-nous assez généreux pour nos amis ? Ouvrons-nous nos âmes assez large ? L’ami n’est-il que le faire-valoir de soi ou un protagoniste qui rend meilleur ? Une béquille qui soutient ou un défi pour aller de l’avant ?
Ce chapitre peu clair d’Ainsi parlait Zarathoustra jette sur le papier des idées qui mériteraient d’être développées.
(J’utilise la traduction 1947 de Maurice Betz au Livre de poche qui est fluide et agréable ; elle est aujourd’hui introuvable.)
Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, 1884, traduction Geneviève Bianquis, Garnier Flammarion 2006, 480 pages, €4,80 e-book €4,49
Nietzsche déjà chroniqué sur ce blog



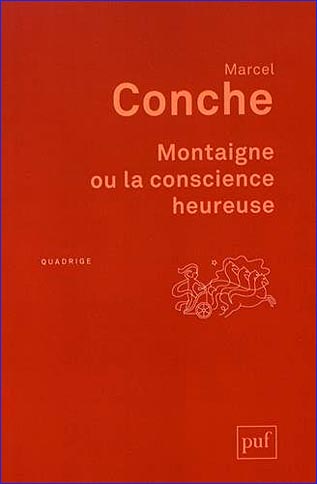
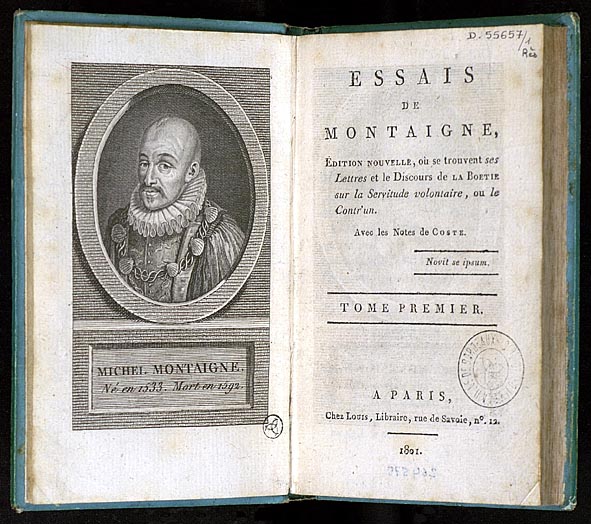
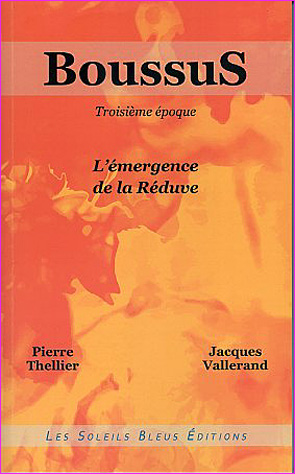
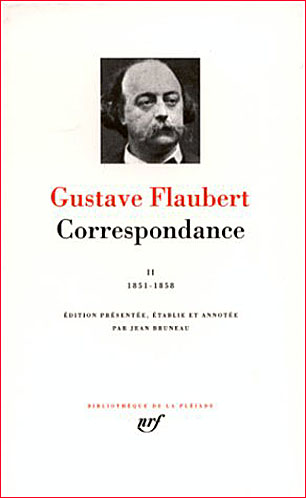





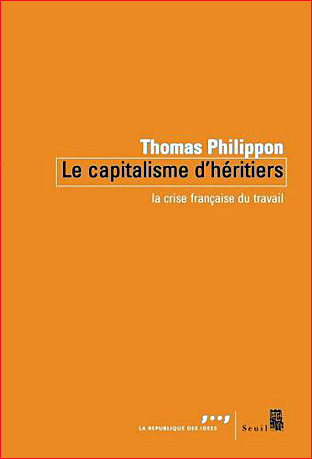









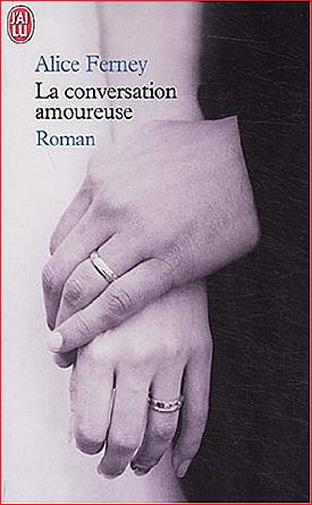



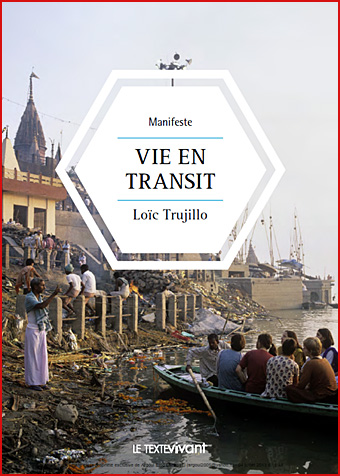

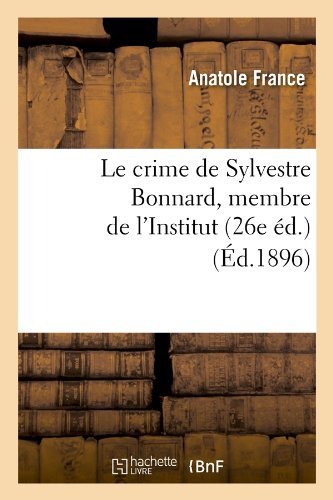



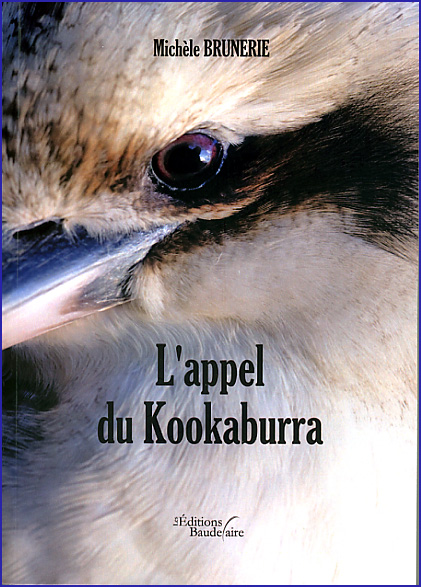



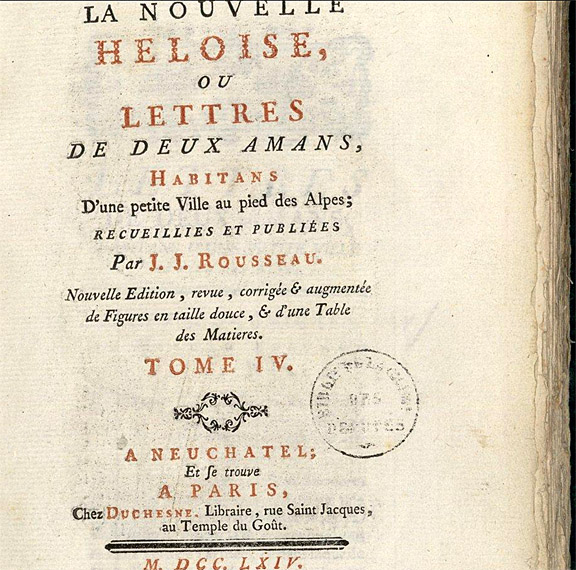

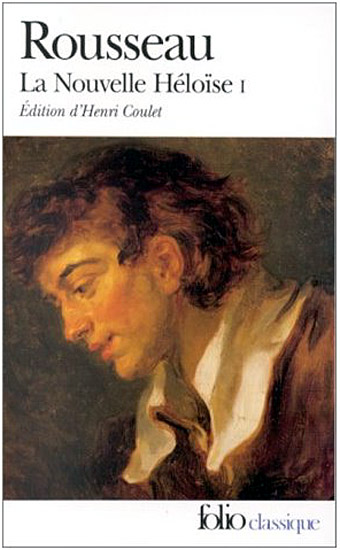






Commentaires récents