Ma peinture préférée reste La jeune fille à la perle qui affiche à l’oreille le microcosme du monde en même temps que sa goutte de rosée pubertaire. C’est une perle de rosée virginale qui sourd au moment où les lèvres s’entrouvrent et où le regard vous croise. La jeune fille à la perle, si pure et virginale d’apparence, ne serait qu’une simple pute. La perle était l’insigne des courtisanes, et la grosseur de celle qu’elle porte est disproportionnée par rapport à celles que l’on trouve habituellement. Elle est comme une enseigne à l’entrée des maisons closes et dit que la fille est prête à baiser. Je suis un peu dubitatif sur cette présentation de guide. La perle semble être en chrétienté un symbole de pureté, à la fois trésor caché et vanité terrestre. Mais ce pourrait être aussi, vu la grosseur, une perle de verre argenté ou d’étain poli, à moins que ce soit un effet spécial du peintre. Tout l’intérêt de l’art est justement de provoquer le spectateur à avoir sa propre vision. De plus, il semble que la fameuse Jeune fille ait été l’une des filles du peintre, âgée de 12 ou 13 ans et non pas une servante de 16 ans comme le romance Tracy Chevalier.

J’observe que les lèvres pulpeuses des filles de Vermeer rappellent les lèvres entrouvertes des garçons du Caravage à la fin du XVIe siècle, comme Le garçon mordu par un lézard ou Les musiciens. La façon dont est tourné le visage de la jeune fille à la perle de Vermeer rappelle également la façon dont est tourné le visage du Joueur de luth du même Caravage, peint en 1595. Il a la même coiffe, la même lumière, le même regard, les mêmes lèvres pulpeuses semi entrouvertes. Le Caravage a influencé les peintres de Delft, l’école caravagesque d’Utrecht rassemble les peintres néerlandais partis à Rome au début du XVIIe siècle pour parfaire leur formation. Réalisme et clair-obscur sont les principaux apports de l’Italie, ainsi que les scènes de genre et les buveurs ou musiciens. L’Entremetteuse de Dirck Van Baburen (1622) est inspirée des Tricheurs du Caravage (1595) ; elle a peut-être inspiré Vermeer, dont on sait qu’il a été influencé par l’utilisation de la couleur par cette école.


La fille au chapeau rouge, dans la même veine, me plaît moins car elle arbore trop de sensualité ouvertement et n’a plus rien de virginale. Il s’agit d’une claire invite sexuelle et non pas d’une envie affective d’admiration ou de protection. L’infrarouge montre que la première esquisse était un homme. L’inverse de la très jeune fille en fleur.

Le tableau de la Jeune fille, peint vers 1665, ne portait pas de titre, on l’a appelé successivement le Portrait turc ou la Jeune fille au turban et c’est le roman paru de 1999 de Tracy Chevalier, La jeune fille à la perle, qui lui a assuré son titre actuel dans le grand public. Le tableau était peut-être destiné à Pieter van Ruijven, un riche percepteur de Delft ami de la famille du peintre. Dans cette société prospère grâce au commerce, l’art est un marqueur social et un placement financier. Elle a refait surface lorsqu’un collectionneur, un Français, l’a achetée pour deux florins, soit moins d’un euro. Une fois nettoyée, il a vu que c’était un Vermeer et en a fait don à sa mort en 1902 au Maurithuis. L’œuvre a été restaurée en 1994 pour lui ôter son vernis qui s’était assombri, permettant de remettre en valeur les petites touches blanches qui ornent la commissure des lèvres.

L’usage du sfumato à la Vinci permet chez Vermeer que l’arête du nez de la jeune fille soit fondue dans sa joue. Le fond était vert sombre et nous paraît noir à cause du vernis ; ce vert représentait initialement un rideau. La torsion du buste crée une tension qui invite le regard du spectateur tandis que le fond sombre uni semble faire émerger le visage du néant. La couleur bleu-gris des yeux répond à la nuance de la perle. La jeune fille est mise en situation, le torse en rotation donne le sentiment qu’elle ne pose pas, qu’elle est surprise. Le tableau est fait pour nous attirer, au sens optique comme sexuel. Il instaure une relation et laisse du mystère, ce qui retient. Cette peinture reste universellement humaine avec ses trois couleurs primaires (rouge des lèvres, bleu et jaune du turban) et l’effet qui fait surgir la lumière de l’obscurité. Elle est aussi un fantasme, la manifestation du désir surpris, interdit. Comme il subsiste un mystère, la (très) jeune fille attire – elle a toujours attiré les hommes faits.

Les produits dérivés et les imitations dérisoires contemporaines gâchent un peu la vraie jeune fille, mais c’est l’époque : tout doit être rabaissé au niveau démocratique de celui qui regarde.




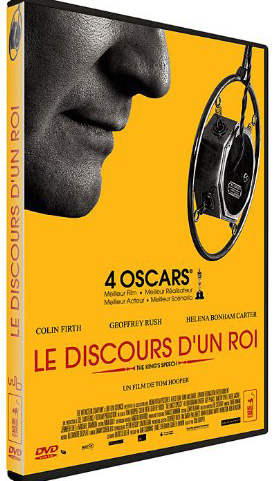



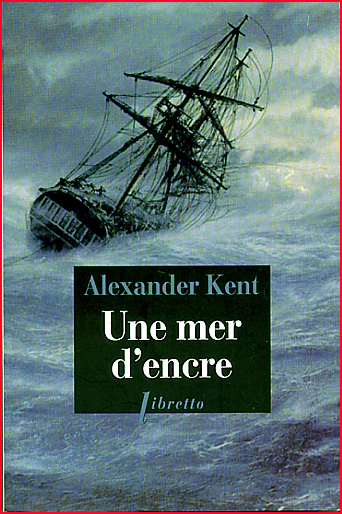















Commentaires récents