Le plus littéraire des romans policiers catalans, La Rose d’Alexandrie est aussi le nom d’un bateau ; c’est également le nom d’une fleur, blanche le jour, rouge la nuit, dit la chanson populaire. Tout comme la pute qui s’est fait zigouiller et couper en morceaux à Barcelone. La famille, effarée, demande à Pepe Carvalho, via la cousine Charo qui exerce le noble métier de call-girl au-dessus des Ramblas, de découvrir qui est l’assassin.
Le roman s’étage en marbré, les chapitres Carvalho à Barcelone alternant avec les chapitres Ginès dans les Caraïbes. Le lecteur comprend vite que le beau marin empli de saudade qui hésite à rembarquer, a vécu une histoire d’amour désespérée et qu’il est prenant de la partie carrée qui s’est déroulée autour de la pute dépecée.
Mais l’histoire est compliquée, comme toute histoire d’amour, surtout vécue à ce moment précis où la société espagnole, après Franco, bascule dans la modernité accélérée. Les siècles de catholicisme doloriste et les décennies de franquisme conservateur ont fragilisé les êtres. Leur amour a des relents de tiers-monde et de vieillerie, une sorte d’impuissance à se vivre naturellement. L’homme adulte a des pudeurs et des asthénies d’adolescent puceau ; la femme adulte a des envies et des déchainements de jouvencelle hystérisée au couvent. De leurs relations ne pouvait rien sortir de bon.
C’est ce que met au jour progressivement notre détective, entre deux rencontres d’êtres pitoyables et deux plats de cuisine populaire. Le lecteur pourra obtenir la recette du très roboratif riz aux sardines, d’un gaspacho aux galettes non moins nourrissant, et d’épinards tombés à la béchamel de gambas servis avec une cuissette de chevreau aux prunes qui met l’eau à la bouche (p.324). Narcís est l’autodidacte catalan toujours content de lui qui observe les autres comme un entomologiste les insectes ; le Quêteur d’âme est l’ancêtre mafieux d’une lignée de pauvres qui veille jalousement sur les intérêts de sa descendance ; Contreras est le flic franquiste qui sévit sous les socialistes et applique la loi avec une jubilation de comptable ; le capitaine Tourón ne tourne pas rond, se déguisant volontiers en Môme du Cabaret dans sa cabine verrouillée…
Quant à la pute, son prénom commence comme encular et comme encarnatión, un mixte d’Incarnation mystique purement catholique et de chair impure inassouvie. Encarnatión est mariée mais insatisfaite ; son mari viveur fin de race se meurt d’une maladie des os. Lorsqu’elle retrouve par hasard son amourette d’adolescente sur une avenue de Barcelone où elle passe le temps (officiellement) à consulter « des docteurs », elle renoue volontiers. Ginès la fait rêver d’exotisme dans la grisaille espagnole d’Albacete (ou elle vit maritalement) et de Barcelone (où elle s’envoie des mecs).
Mais la fille ne fait plus bander le marin et les rôles sont inversés : c’est elle qui réclame du sexe torride et lui qui préfère le romantisme du rêve à deux. Un « docteur » de trop suscitera le crime, embrouillé par l’entremetteur de la maison et le dépeceur de cadavre. Comprenne qui devra mais le voile est levé à la fin, ne laissant guère de bonheur à la société socialiste de l’Espagne du temps.
Nous sommes, dans ce roman mi-littéraire mi-policier, en univers Almodovar version pessimiste et cynique où les vins de pays, la bonne bouffe mijotée et les câlins sexuels de l’experte Charo finissent par laisser Pepe de marbre et le lecteur doux-amer. Une réussite.
Manuel Vasquez Montalbán, La Rose d’Alexandrie (La rosa de Alejandria), 1984, Points policier Seuil 2016, 384 pages, €7.90
Les romans policiers de Manuel Vasquez Montalbán chroniqués sur ce blog






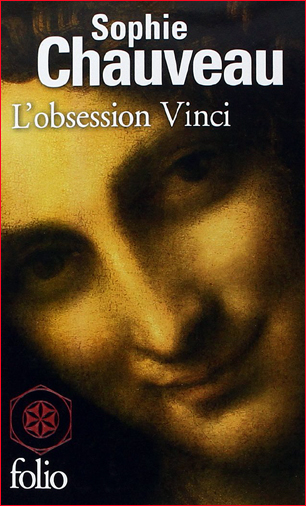







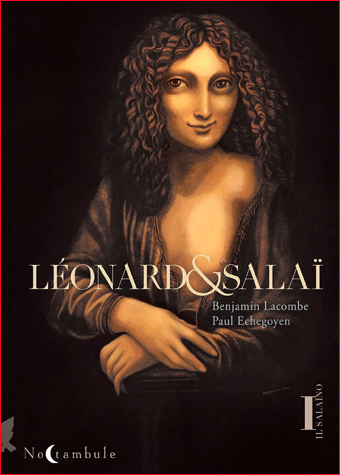



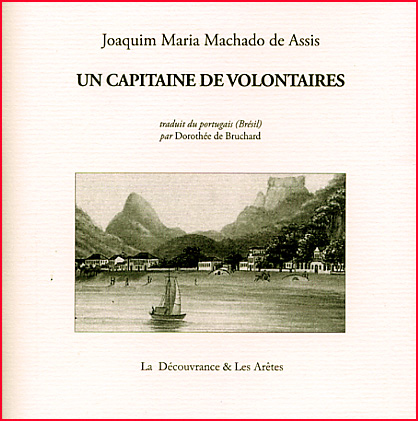



Commentaires récents