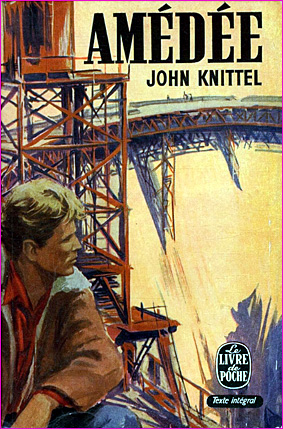
« L’un des plus grands romanciers de notre époque », disait Romain Rolland de l’écrivain suisse né en Inde John Knittel. Je ne trouve pas. Romain Rolland était trop conventionnel, trop inséré dans son époque, pour voir l’avenir. Knittel est passé de mode : tout, dans ses sujets, son style, sa description « naturelle » des mœurs, est renvoyé à son temps.
Amédée est un jeune homme devenu ingénieur par la force de sa volonté. Il est orphelin de père parce que sa mère a tué son mari après avoir été mise enceinte par son beau-fils amant (objet du roman précédent, Thérèse Etienne). Le fils unique doit vivre avec l’opprobre social, sa mère au bagne. Élevé par un oncle pasteur, il devient cependant un mathématicien pratique accompli, beau, bien fait, énergique… Un homme nietzschéen comme l’entre-deux guerres en produisait en Europe.
Mais il est seul, inapte à l’amour, ou du moins la vie sociale de couple. Pauline, sa voisine d’enfance à la campagne, en tombe amoureux, mais il rompt brutalement : il ne peut pas. Des années se passent, Pauline s’est mariée à 19 ans, par dépit, avec Gusti, le prototype du Suisse content de lui, amateur de charcutailles et de bonne bouffe, maniaque, fonctionnaire et conventionnel en diable, qui n’aime que faire des économies.
Pauline n’en peut plus lorsqu’elle revoit par hasard le bel Amédée. Il a obtenu l’ingénierie en chef d’un projet de barrage d’une haute vallée suisse, le Rossmer, destiné à fournir de l’énergie à tout le pays. Car l’énergie, tout est là : pas de prospérité sans énergie, pas d’économie ni de confort sans énergie. L’eau est la meilleure des énergies car naturelle et coulant tout en force, si elle est bien canalisée dans des turbines issues de la technique ingénieuse des hommes. Amédée sait que le pétrole s’épuise déjà. Il est à fond productiviste – mais aussi idéaliste.
Il reprend à son compte l’utopie d’un Herman Soergel, né allemand en 1885 et mort à 62 ans percuté à vélo dans une ligne droite par une voiture qui n’a jamais été retrouvée… Il faisait de l’ombre aux puissances. Car son projet était d’assécher en partie la Méditerranée par un barrage géant à Gibraltar pour récupérer des terres cultivable et alimenter en énergie hydroélectrique l’Europe et l’Afrique devenu continent reconstitué : Atlantropa. L’équivalent du continent américain et du continent asiatique en kilomètres carrés. Cette énergie abondante devrait apporter la paix, chaque ex-empire ayant intérêt à la prospérité. Je me demande ce qu’en a pensé Staline, ou Hitler… D’autant que l’utopiste a oublié carrément l’évolution de la démographie : en son temps, l’Europe était pleine et l’Afrique vide ; ce n’est plus le cas du tout, au contraire ! Atlantropa ou le métissage généralisé ?
Cet idéalisme du grand projet est l’un des thèmes du roman, qui veut promouvoir une idée. On comprend mieux la remarque de Romain Rolland, prix Nobel de littérature 1915, lui aussi humaniste poussé à faire communier les hommes par la technique et l’économie, via des héros pacifistes. Il a malheureusement terminé comme « idiot utile » de l’URSS à la fin de sa vie… Il croyait à l’avenir radieux – que l’on attend encore sous Poutine.
Amédée croit cependant en l’Europe à construire, à unifier par l’énergie et les grandes voies de communication, ce qui était prémonitoire, mais ne se fera qu’après une sale guerre nazie. Il a fallu vaincre le nationalisme pour cela. Et cela recommence : la Russie de Poutine ne veut pas être assimilée à l’Europe, par orgueil de mafieux arrivé. Pas question d’unifier par l’énergie et les grandes voies de communication le continent de l’Atlantique à l’Oural.
Pauline quitte donc brusquement son mari Gusti pour aller loger sur le chantier d’altitude où travaille Amédée et l’équipe qu’il a su fédérer autour de lui. Son charisme et son attention aux autres suscite l’enthousiasme des jeunes hommes, qu’il incite à se muscler physiquement et mentalement, et Pauline aimerait bien qu’il lui porte autant d’attention. Mais Amédée ne vit que pour le projet qui le consume. Le barrage terminé, il est vidé, malade. Pauline le soigne et il lui garde toute son amitié, mais pas au-delà. D’ailleurs elle n’est pas divorcée, son Gusti ne veut pas pour la punir par des chaînes. Ce n’était pas la femme qui décidait, en Suisse, avant-guerre.
Le roman se termine abruptement, comme si son auteur s’apercevait qu’il avait écrit déjà trop de pages. Tels des cow-boys solitaires, Amédée et Pauline s’éloignent l’un derrière l’autre, sur le glacier des hautes cimes. Pour quel avenir ? Mystère. L’histoire entre ces deux caractères pâtit du moralisme pacifiste du Projet d’Atlantropa ; il n’est jamais bon de mêler un prêche à un roman. Mais cette description de la mentalité optimiste d’avant-guerre nous parle de nos jours car nous sommes peut-être aussi en avant guerre. Poutine n’’st pas Hitler, mais il pense et il agit comme lui : par la force, la séduction et le mensonge.
John Knittel, Amédée (Power for sale – Amadeus), 1939, Livre de poche 1967, 500 pages, occasion €6,99
Attention sur Amazon aux langues des éditions, parfois la couverture est celle du Livre de poche en français mais le livre envoyé est en anglais ou en allemand. Mes liens tiennent compte de ce problème.
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)

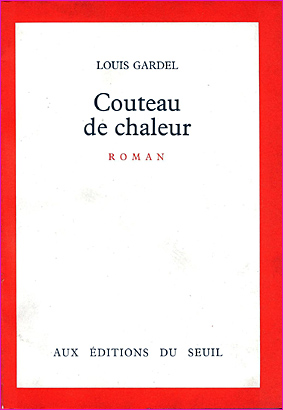



























































































































Commentaires récents