
Le titre, en américain comme en français, est la dernière réplique du film. Il se termine en happy end, comme il se doit. Entre temps, c’est le drame… désopilant. Chacun est dans son rôle et le joue jusqu’au bout – ce qui, aboutit à l’absurde. Lequel est, par son outrance, comique. Comme quoi le rire naît souvent de la caricature ; en faire trop provoque la moquerie car l’être humain présenté comme mécanique est en décalage.


Dans une petite ville perdue au bout du monde – et surtout loin de la grand route – Orville et Barney végètent dans leurs petites vies avec des idées de grandeur. Le premier (Ray Walston) donne des leçons de piano pour pas cher à un ado de 14 ans qui n’a aucune oreille mais qui commence à avoir la queue qui le démange. Le second (Cliff Osmond) est le garagiste station-service du village. Comme ils habitent l’un en face de l’autre, ils se réunissent pour créer des chansons. Barney compose les paroles, Orville les met en musique. Tous deux rêvent de succès, mais comment faire lorsqu’on habite un bled isolé ?


Le hasard, malicieux, va détourner le crooner de charme Dino (Dean Martin) de la route principale vers la petite route poussiéreuse et l’amener au village de Climax – dont le nom signifie ‘point culminant’ (plutôt drôle pour un bled paumé dans la grande plaine) mais aussi ‘orgasme’. Car il existe un bar à hôtesses pour routiers, le Belly Button (autrement dit le nombril), la seule chose qui les attire dans le coin. Les filles sont laides à faire peur mais exhibent leur ventre avec (pour contrer le code Hays de décence puritaine) un diamant (faux) dans le nombril. Elles servent des alcools, et plus si affinité. Celle qui a le plus de succès est Polly (Kim Novak), surnommée ‘Pistolet’ en américain pour son pouvoir de tir, et ‘Volcan’ en français, plus conforme au sens de bombe sexuelle.
Le hasard, malicieux, va détourner le crooner de charme Dino (Dean Martin) de la route principale vers la petite route poussiéreuse et l’amener au village de Climax – dont le nom signifie ‘point culminant’ (plutôt drôle pour un bled paumé dans la grande plaine) mais aussi ‘orgasme’. Car il existe un bar à hôtesses pour routiers, le Belly Button (autrement dit le nombril), la seule chose qui les attire dans le coin. Les filles sont laides à faire peur mais exhibent leur ventre avec (pour contrer le code Hays de décence puritaine) un diamant (faux) dans le nombril. Elles servent des alcools, et plus si affinité. Celle qui a le plus de succès est Polly (Kim Novak), surnommée ‘Pistolet’ en américain pour son pouvoir de tir, et ‘Volcan’ en français, plus conforme au sens de bombe sexuelle.


Barney, qui sert de l’essence dans la grosse auto blanche de l’artiste pressé qui doit rallier Los Angeles le lendemain, reconnaît sans peine la célébrité et incite Orville à lui faire la réclame de leurs chansons. Mais Dino en a vu d’autres, il est sans cesse sollicité par l’un ou par l’autre d’intervenir auprès des producteurs de radio ou des maisons de disque. La seule chose que peut le retenir est sa voiture – et Barney la sabote en coupant l’arrivée d’essence dans le carburateur – et les filles – car il ne peut passer une nuit sans décharger, au risque d’avoir la migraine le lendemain. Cette outrance sexuelle est déjà désopilante, ses conséquences psychosomatiques encore plus. Mais Barney, l’entrepreneur du duo, ne se démonte pas. Puisqu’il a pu retenir Dino à cause de sa voiture (dont il doit commander la pièce, etc.), il le confie à Orville pour l’accueillir la nuit.
Sauf qu’Orville est diablement jaloux. Sa femme Zelda (Felicia Farr) est trop belle pour lui et il n’en revient pas d’avoir pu la lever dans sa jeunesse. Après le jeune laitier (James Ward) qu’il soupçonne d’échanger des mots doux avec sa femme (lorsqu’il vérifie, il s’agit d’une commande de lait et de beurre), il a déjà molesté, arraché le tee-shirt et jeté dehors le « Lolita mâle » Johnny Mulligan (Tommy Nolan, 16 ans au tournage) qui vient d’offrir des fleurs à sa femme – à 14 ans ! Il ne veut surtout pas que Dino lui tourne autour, surtout qu’il est de notoriété publique que la star chavire les cœurs et que Zelda apprécie ses chansons. Barney décide alors Orville d’éloigner Zelda pour un jour ou deux, le temps que Dino reconnaisse le talent des compositeurs-interprètes. Mais comme Orville a annoncé qu’il va faire la connaissance de sa femme, il lui faut en trouver une à louer pour l’occasion. Deux missions désopilantes qui ne vont pas se passer comme prévu car les femmes sont autrement bâties que les hommes.


Afin d’éloigner Zelda, rien de tel qu’une bonne dispute pour l’inciter à retourner un temps chez sa mère, comme le font toutes les épouses qui en ont marre. Sauf que Zelda est toujours amoureuse de son Orville et qu’elle veut le lui prouver par une bonne baise en plein jour. Il y a urgence, Dino fait justement la sieste dans la chambre d’amis à côté. D’où un quiproquo dans la salle de bain communicante où Zelda prend Dino pour Orville et lui tapote les fesses au travers du rideau de douche. Dino est incité à en vouloir plus et Orville est forcé d’accentuer la dispute. Il critique sa femme, la mère, les souvenirs du mariage, du voyage de noces. Enfin ! Zelda prend son sac et sa voiture pour filer chez maman.
Quant à trouver une épouse de substitution, Barney a l’idée de payer la pute Polly pour jouer le rôle. Elle est bonne fille et ne crache pas sur les beaux billets, d’autant que baiser avec un Dino n’est pas donné tous les jours à tout le monde. Big Bertha la mère maquerelle accepte (une Barbara Pepper dûment choucroutée en blonde vaporeuse malgré ses formes informes). Barney enlève Polly dans sa dépanneuse pour dépanner Orville. Polly est ravie de jouer la ménagère plutôt que la serveuse, et d’exiger des égards plutôt que des avances. Dino est émoustillé et frustré, ce qui accentue son goût de rester et l’incite à prêter une oreille favorable aux chansons que lui inflige Orville. Après tout, elles ne sont pas si mal et il a besoin de rajeunir son répertoire qui commence sérieusement à battre de l’aile.


Tout va donc pour le mieux dans un climax euphorique pour tous lorsque Zelda revient plus tôt que prévu. Sa mère, une vieille bique acariâtre qui ne cesse de bavasser et de critiquer tout et tout le monde, ne cesse de lui reprocher son mariage, lui vantant tous les ex-prétendants qui, eux, ont réussi à gagner beaucoup d’argent et une position sociale. En bref, tout le discours assommant de la génération qui a vécu la guerre et qui ne comprend pas la propension à l’hédonisme et à l’individualisme des jeunes du baby boom. Nous sommes en 1964 et 1968 pointait déjà, il suffisait de humer l’air du temps.
C’est donc la catastrophe, l’écroulement des scénarios bien peaufinés, l’explosion du rêve de gloire. Zelda est outrée que son mari l’ait remplacée au pied levé par une pute. Elle quitte la maison une fois de plus mais ne peut retourner chez maman ; elle échoue donc au Belly Button, où elle se saoule consciencieusement. Big Bertha la fait porter dans la caravane de Polly, puisqu’elle n’est pas là. Dino, privé de femme parce qu’il a à peine pu sauter Polly qu’Orville revient et le fout dehors, pris de remords d’avoir exposé son épouse, va échouer lui aussi au Belly Button où il demande à un serveur s’il existe une serveuse un peu moins moche que les autres. Évidemment ! C’est Polly. D’ailleurs sa caravane est juste en face. Dino s’y rend et trouve Zelda, pas claire, qui se laisse sauter avec un certain plaisir. Il laisse en partant une grosse somme en billets.


Content, il récupère sa décapotable réparée le lendemain et file vers Los Angeles. Il va proposer les chansons des bouseux pour mettre un peu de sang neuf dans les productions. Orville a été convoqué par Zelda via Barney pour la rejoindre devant le cabinet d’un avocat pour une demande de divorce. Le trio est attiré par une vitrine où les gens sont collé aux écrans de télé qui diffusent Dino chantant. C’est justement l’une de leurs chansons ! Le rêve de gloire est arrivé puisque le crooner les cite nommément comme auteurs en public. Passe alors Polly qui, avec les 500 $ laissés à Zelda et que celle-ci lui a remis pour avoir joué son rôle, a pu s’acheter la voiture qui pourra tirer la caravane – et se tirer de ce trou ! Dérision en ultime pirouette : l’auto est une Fiat 500 minuscule et peu puissante, qui ne vaut d’occasion que 495 $, ainsi que l’indique l’étiquette collée sur le pare-brise.
De l’époux traditionnel au tombeur professionnel, de l’amoureuse ménagère à la pute au grand cœur et chaud vagin, les écarts à la norme donnent la mesure de ce qui était acceptable au milieu des années soixante du siècle dernier. La jalousie ne mène à rien, pas plus que la possession d’un soir. Un couple est une rencontre dans la durée. L’épouse comme la pute désirent et aiment ; elles peuvent interchanger leur rôle sans changer au fond. L’époux comme le tombeur désirent et aiment ; ils peuvent jouer divers rôles mais sans changer eux non plus au fond. L’american way of life de la pruderie puritaine est une stupidité que Billy Wilder conspue avec une insolence réjouissante : il s’agit avant tout d’aimer, et peu importe comment ! Quant aux médias de masse comme la radio, la télé ou le disque, ils apportent la révolution des mœurs jusque dans les campagnes perdues.
DVD Embrasse-moi, idiot (Kiss Me, Stupid), Billy Wilder, avec Dean Martin, Kim Novak, Ray Walston, Felicia Farr, Cliff Osmond, Filmedia 2014, 1h59, €7,76

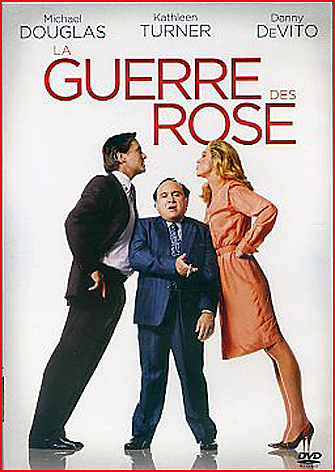

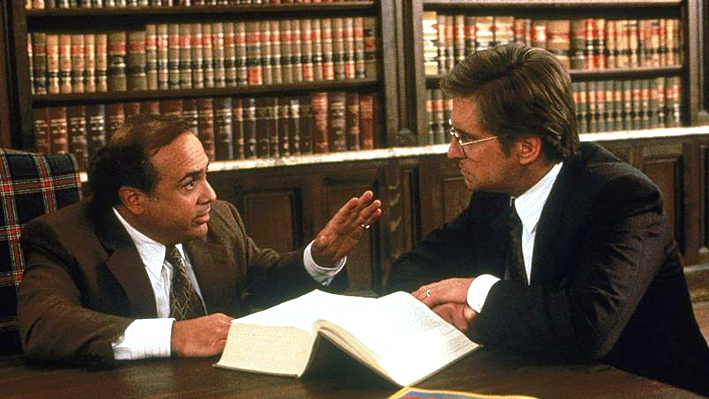

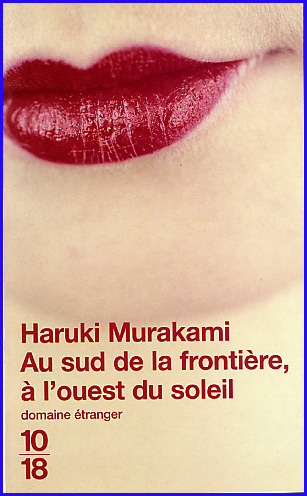


Commentaires récents