Les Français ont une devise : Liberté, Égalité, Fraternité. Tout paraît bien équilibré, la liberté en premier qui seule permet le reste, l’égalité en second qui permet à chacun de se révéler, la fraternité pour le tout afin de ne laisser personne sur le bord du chemin.
Sauf que, selon les périodes, la liberté est vue comme opportunité ou comme aliénation, comme l’expression de sa propre responsabilité ou comme une soumission aux forces qui dépassent : le capitalisme, le monde, le destin, la religion. Si ceux qui ont fui Pétain et les nazis à Londres en 1940 avaient agi comme les gréviculteurs d’aujourd’hui, crispés sur leurs acquis, la France ne serait plus la France mais une province éloignée de l’Hinterland allemand. Résister, c’était faire preuve de sa responsabilité en faisant le pari de la liberté. Oh, ils étaient bien peu nombreux, ceux qui ont osé ! La majorité attendait de voir, tergiversait avant de se décider, accrochée par mille liens trop respectables aux habitudes, aux droits acquis, au regard de leur milieu, à la révérence envers l’autorité, à la force imposée…
2016 n’est pas 1940 et nulle armée n’occupe encore la France pour enjoindre de se soumettre ou de mourir. Mais le dilemme entre liberté et abandon est toujours là. L’égalité est ce qui permet de se justifier lorsqu’on ne veut rien changer : tout le monde pareil, évidemment figé dans les positions acquises… Tiens, cela ne rappelle-t-il rien à ceux qui se piquent d’un peu d’histoire ? Mais si, souvenez-vous : ce fameux Ancien régime que l’on se vante tellement, deux siècles après, d’avoir renversé par « LA » Révolution !
Le statut était d’Ancien régime : on naissait noble et nanti ou réduit au tiers et asservi ; seuls « les ordres » religieux (encore un statut !) permettaient de botter en touche lorsqu’on avait quelque talent. La révolution a voulu mettre la chose du peuple (la république) avant les privilèges de quelques-uns et le pouvoir du peuple (la démocratie) au-dessus du pouvoir de quelques privilégiés. Mais, pour fonctionner efficacement, la démocratie exige que chacun y mette du sien : chacun doit trouver sa place, elle n’est plus acquise ; initiative et compétences font avancer la machine, hier figée dans l’idéologie d’un Ordre divin.
Or, aujourd’hui, chacun se réfugie en ses statuts et privilèges, cherchant à reconstituer cet Ordre immobile d’Ancien régime face au mouvement du capitalisme, à la déferlante du monde, aux changements de la modernité. Ce pourquoi la « démocratie » est moins démocratique, les privilégiés s’arrogeant le droit de gouverner dans l’abandon général. Les gens s’effraient de voir que tout va plus vite, que rien n’est plus acquis, que toutes les situations peuvent être remises en cause. C’est humain.

Mais ce qui est humain aussi est de savoir réagir, « prendre ses responsabilités » comme dit la langue de bois politicienne. Il s’agit en fait de voir le monde tel qu’il est et de s’adapter aux réalités. Pas forcément en démissionnant des règles et procédures élaborées pas à pas depuis longtemps, mais en les adaptant, en en créant de nouvelles.
C’est ce que refusent de comprendre une partie des syndicats, des partis politiques, des fonctionnaires, des employés, des citoyens. Oui, l’économie est désormais globalisée et il est nécessaire d’adapter notre façon de produire et ce que nous produisons pour simplement survivre : existe-t-il encore des allumeurs de réverbères ? des rempailleurs de chaise ? des chaisières dans les parcs ? Pourquoi voulez-vous que certains métiers restent les mêmes alors que tout change autour d’eux ? Pourquoi les taxis garderaient-ils leur monopole ? Pourquoi telle usine, de moins en moins rentable, ou telle raffinerie, inadaptée à la mutation anti-diesel, ne devraient-elles pas fermer ? Pourquoi tel service administratif, qui produit des règles et du papier, ne devrait-il pas être aminci, précisé et réorganisé ? Pourquoi tant de collectivités locales emboitées en poupées russes, avec à pour chacune sa bureaucratie ? Ne sommes-nous pas à l’ère du numérique où nombre de procédures peuvent s’effectuer en ligne ?
Aujourd’hui, la démocratie, la technique et le capitalisme (qui sont liés), demandent de l’autonomie, pas de l’obéissance ; de l’initiative, pas de la discipline militaire. Schumpeter a remplacé Ford. Il est nécessaire de s’affranchir des habitudes pour adapter son travail à une consommation et à des services publics de moins en moins standards (pareil pour tout le monde, montraient les magasins soviétiques avec un seul paquet de lessive sans possibilité de choix – tout le monde pareil, clamait l’Administration à la française qui ne voulait voir qu’une tête). Chacun exige aujourd’hui qu’on le considère dans sa personne particulière et pas comme un « ayant-droit » lambda ou un consommateur « de masse ». Même les téléphones portables sont customisés.
Employés du privé habitués à suivre et fonctionnaires habitués à obéir aux règles sans jamais se poser de question se trouvent perdus, renvoyés à leurs compétences et à leur autonomie – qui, justement, ne s’apprennent pas dans les écoles : le savoir-vivre, le savoir-être. L’obéissance était un confort, un art d’être conforme, une protection contre la responsabilité (c’est pas moi, c’est la règle). Aujourd’hui que la génération rebelle a enjoint chacun d’être différent – parce que l’autonomie de l’individu a progressé – il faut se distinguer ou stagner. Le statut acquis par un concours ou un premier emploi vers 20 ans n’est plus acquis : il faut prouver ses compétences année après année.
D’où la « souffrance au travail », les périodes de chômage et de reconversion, la dépression dans le couple, la « perte du lien social » que pointent tant de sociologues. Et les échappatoires vers le déni, l’alcool et les drogues, ou vers la violence, conjugale, parentale ou sociale. Ce sont tous des symptômes de cette liberté qui ne passe pas.
Il est bien loin, ce mois de mai 1968 où les forces de la jeunesse, les énergies du printemps et l’élan de la vie faisaient craquer les gaines, tomber les tabous, briser les carcans, et libérer le désir comme les initiatives ! Mai 68 a permis la libération des déterminismes : être soi-même devenait possible. Sauf que… a-t-on toujours le cœur de se regarder tel qu’on est ? Un coming out est-il personnellement libérateur ou bien socialement dangereux ? Le regard des autres est parfois fatal à l’estime de soi.
N’est-on pas mieux, au contraire, dans le nid fusionnel où tous égalent tous, grognant ensemble (pas une voix plus haute que l’autre), dormant ensemble dans le même panier formaté, tétant ensemble, en ayant-droits bien sages le même lait standard des mamelles en apparence inépuisables de l’État-providence ? (Mais qui paye ?) De Ford à Schumpeter, de la chaîne à l’innovation, le capitalisme (cette technique d’efficacité économique) s’est adapté – pas la société française. Car le Français n’aime rien tant que de se savoir à sa place, en hiérarchie et statut, là où la fonction crée l’organe (même inutile), où l’on n’est rien si l’on « n’appartient » pas : à une grande école, à un corps d’État, à telle entreprise, tel parti ou telle association d’anciens ci ou ça. Presque tous les Français rêvent d’être « président » – le plus souvent d’une insignifiante association sportive de quartier – mais ils « appartiennent », là est leur honneur, leur seule personnalité. Ils ne sont rien sans le titre, la carte ou l’uniforme. Ils ont trop peur d’être simplement eux-mêmes, tout nu face à tous les autres et au monde entier qui regarde comment ils sont foutus et comment ils s’en sortent… Hier il fallait obéir, aujourd’hui créer – cela change tout !
D’où la peur sociale : du changement, de la mondialisation, des jeunes (« qui ne sont pas comme nous » – air connu), du progrès, des autres. D’où l’angoisse intime : de ne plus être soi, de ne pas être capable, de se montrer à la hauteur, d’être submergé par des forces qui dépassent, voire par les mœurs étrangères. Les Français ne veulent pas être libres, ils veulent être égaux. Ils préfèrent appartenir que s’appartenir ; ils se disent non pas citoyens, ni producteurs, mais fonctionnaire, cheminot, profession libérale, corps des Mines, franc-maçon, socialiste… Ils ne veulent pas penser par eux-mêmes, ni décider en conscience de par leur libre-arbitre – ils préfèrent obéir aux consignes, suivre les mouvements, voter selon la ligne. Et tant pis si leur petite décision individuelle fait crever le collectif : ils se seront trompés avec tout le monde – irresponsables. Cela fait 40 ans que les politiciens, les syndicalistes, les idéologues des partis, les corps de métier, nous prouvent tous les jours que cela se passe ainsi. Mérah évitable ? – C’est pas moi, c’est la règle. Brétigny une erreur ? – C’est pas moi, c’est faute de moyens. Le chômage plus qu’ailleurs ? – C’est pas moi, ce sont les patrons, Bruxelles, l’euro, le droit du travail, les charges sociales et j’en passe – ce ne sont jamais les politiques néfastes des gouvernants, ni les règles tatillonnes et prolifiques des faiseurs de lois.
La grande peur de la liberté fait se précipiter les gouvernants dans le convenu, les fonctionnaires dans les procédures, les employés dans l’attente des ordres et les syndicats dans les manifs rituelles (aussi braillardes, voire violentes, qu’inefficaces). Quant aux pauvres en esprit, pauvres gens, inadaptés du système, paumés du changement, flemmards et profiteurs (mais oui, il y en a), ils sont laissés pour compte. Personne ne s’occupe d’eux. Ils se précipitent donc vers ce qui brille, ce qui promet, ce qui gueule plus fort : les religions, les partis extrémistes. Eux promettent protection, barrières, surveillance, souveraineté.

Mais les autres ? Les jeunes, les ouverts, les responsables, les coopératifs (qu’ils soient californiens technologiques ou écolos de proximité) ? Ceux qui préfèrent la liberté dans les règles à l’égalité d’obéissance ? Ils existent aussi, ils sont de plus en plus nombreux comme en témoignent tous les mouvements « alternatifs » – parfois naïfs et velléitaires, mais qui prouvent une quête de neuf : Occupy Wall Street, Los indignados, Nuit debout, En avant, Rassemblement pour l’initiative citoyenne – et tout le reste.
Gageons que les perdants seront les vieux, les rigides, les privilégiés du statut. Et les gagnants seront tous les autres, à commencer par ceux qui représentent l’avenir. Cette note est loin d’être pessimiste, au contraire ! Elle fait le pari de la jeunesse, du futur, de la vie qui va et qui s’adapte. Sans cesse. Contre les vieux cons…


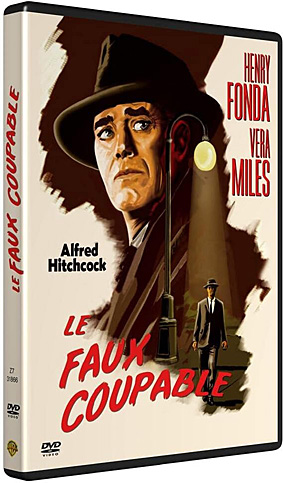




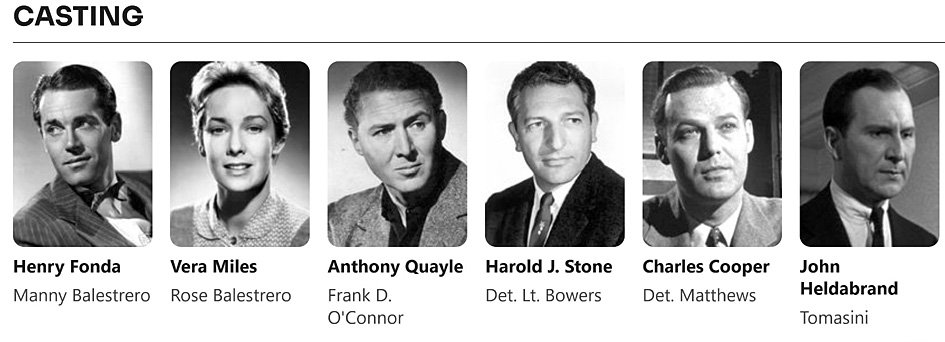
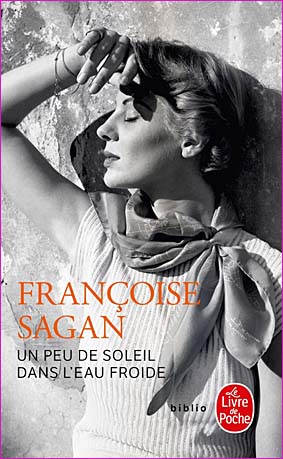
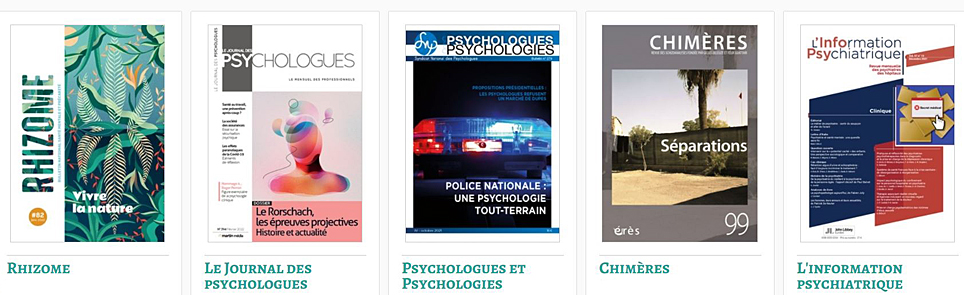
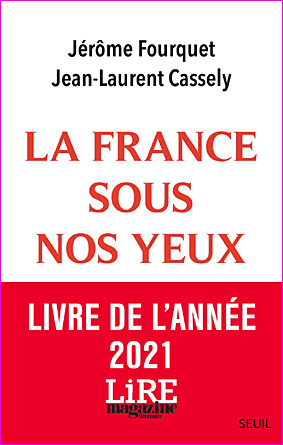
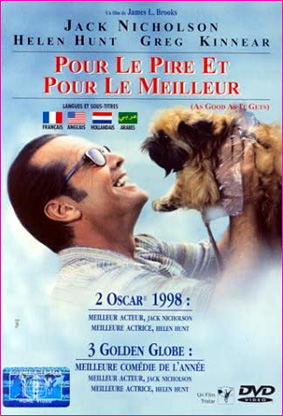







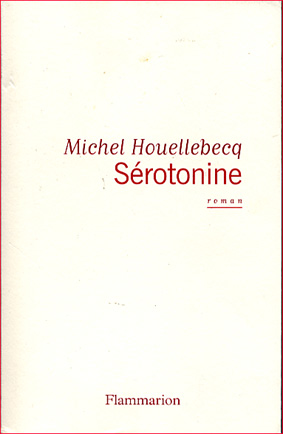


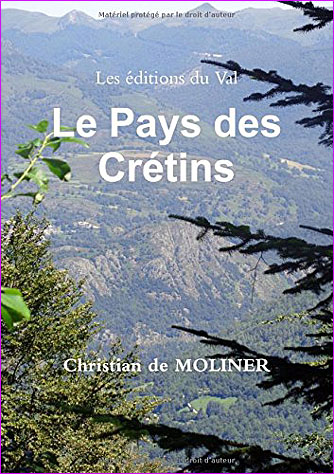











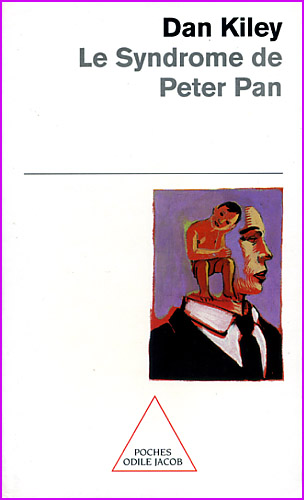

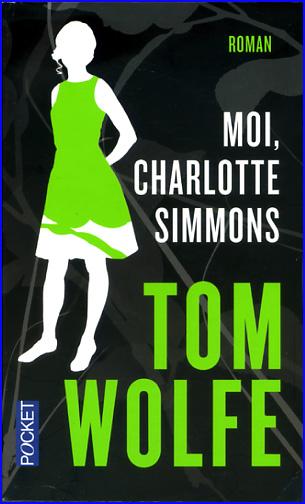



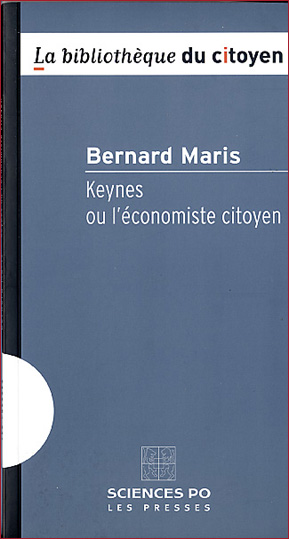




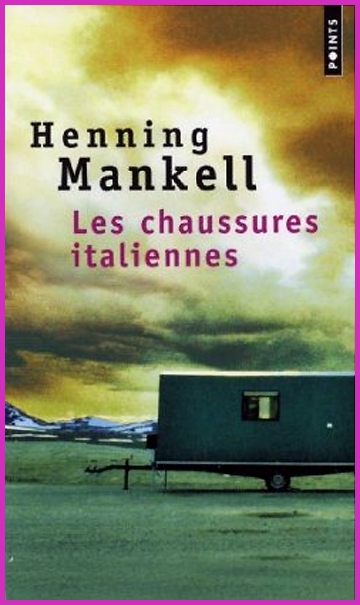



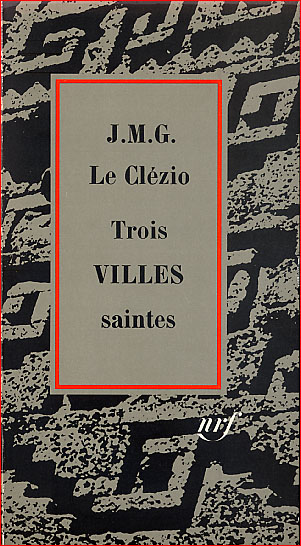




Commentaires récents