L’autre attrait de cette église est son paganisme affiché. Saint Sébastien est le patron de l’église de Chamula et il a du travail. Rien de catholique dans cette église, je ne sais si l’on y célèbre parfois une messe. Je comprends pourquoi il est interdit de filmer, de dessiner et même d’écrire ! Devant « l’autel », une vieille est en train d’égorger un coq en psalmodiant des paroles qui ne sont pas d’Evangile. De frêles bougies tentent d’éclairer cette scène de sacrifice, creusant les visages et amplifiant les ombres mouvantes des officiants à genoux. Les sorcières de Macbeth ne devaient pas être autres. Le sol est jonché de brassées d’aiguilles de pin qui donnent une atmosphère de crèche à cet endroit que les petites fenêtres rendent sombre. Pas de banc ni de chaise, « on ne s’assoit pas » est un autre de ces mandements menaçants affichés complaisamment en espagnol ET en anglais à l’entrée.

Les « saints » font tapisserie, j’en ai relevé (de mémoire) au moins une bonne vingtaine, pour tous les maux que vous pouvez avoir. Pas de problèmes sans solutions, même les cas les plus désespérés, « amour, affection retrouvée, retour immédiat de la personne aimée, fidélité absolue entre époux, mariage, travail, chance, désenvoûtement, impuissance sexuelle, résout les difficultés de famille, attraction de clientèle pour commerçants, neutralise toute adversité et influence néfaste ou maléfique, surmonte tout obstacle quel qu’il soit » – on croirait une litanie de griot africain dont les cartes vantent les mérites dans les boites aux lettres parisiennes.

C’est la même chose ici. Point de marabouts en cette église mais des saints qui pendent, visages de bois vers vous, prêts à écouter n’importe quelle élucubration d’un air docte et impassible, les lueurs de cierges coulés dans des verres à moutarde allumés à leurs pieds animant leurs visages de bois, leur donnant un œil qui voit tout. Les prières deviennent mélopées, la raison se perd dans le bercement chanté, la cure se fait dans la tête. C’est une psychanalyse vieille comme le monde qui fait « dire » à haute voix les maux qui, s’objectivant en mots, se rendent neutres, s’atténuent, disparaissent.

L’ambivalence des dieux païens et des saints chrétiens a permis de trouver avec pragmatisme un équivalent martyr catholique pour chacun des anciens dieux mexicains. L’ange luttant contre le Mal, saint Michel ou saint Georges, est un guerrier aztèque ; les guerriers morts au combat accompagnaient le Soleil dans sa course comme les anges compagnons de Dieu. Anne, mère de Marie est Toci « notre aïeule », Saint André le Cinquième Soleil, saint Barthélémy Xipe Totec, le dieu de l’écorchement, saint Christophe à tête de chien le dieu qui accompagne les morts.

Saint Jean-Baptiste est dieu de l’eau et protège les moutons alentours, saint Juanito serait son petit frère ; lui protégerait les saisonniers employés dans les fermes de la côte. Saint Jacques est le patron des bêtes de somme, face d’Espagnol têtue comme une mule (il y a de l’ironie méchante chez les Tzotzil). Saint Michel patronne les musiciens, on ne sait pourquoi ; peut-être parce qu’il est chargé de garder leurs femmes quand ils jouent (donc de terrasser le dragon de la luxure ?). Saint Nicolas protège les poules (!) – je ne sais s’il les ressuscite des saloirs bouchers. Saint Jérôme est appelé Jermino, il veille sur tous les guérisseurs par analogie avec son lion qui le garde, le « bolom » comme l’animal est appelé ici. Saint Manuel et saint Matthieu (dieu Telpochtli) veillent sur les gens et sur les enfants.
Saint Jean l’Evangéliste aurait été le premier à cultiver le maïs, il faut y voir la christianisation du dieu maya. Saint Laurent sur son grill a recyclé le dieu du feu Xiuhtecutli. Je trouve même un saint Judas mais ce n’est pas le roux de légende au nez crochu, appelé « pukujes » ici (Juif ou diable) et qui a vendu le Christ pour 30 deniers avant de se pendre. Il s’agit de Judas Tadeo. Il apparaît le dernier de la liste des douze apôtres selon Matthieu 10.3 et Marc 3.18. Sans doute était-il le frère de Jacques le Mineur.

Je ne tarde guère à ressortir sur la place pleine de lumière où se tient un marché aux légumes sur l’esplanade et des artisans dans une rue qui descend. Ce dernier endroit, plus libre et plus vivant offre quelques opportunités de photos. Les gens d’ici n’aiment pas cela, croyant toujours soit que l’on vole leur âme ou que l’on fait de l’argent sur leur dos. Il faut rester discret, agir avec naturel sans assaillir. La photographie est un art du regard, elle ne saurait être une agression. Pas de confrontation pour voler on ne sait quel scoop mais un accompagnement des êtres dans leur vérité d’attitude. Il faut pour cela être seul car je connais trop ce panurgisme des touristes, même des mieux intentionnés, qui, dès qu’ils voient un de leur congénère prendre une vue, se disent aussitôt : « tiens, pas mal je n’y avais pas pensé ». Et hop ! En un tour de main vous avez quatre ou cinq pékins alignés comme à la parade, l’appareil à l’œil. Pas de cela avec moi !

Trois-quarts d’heure nous suffisent largement pour humer l’atmosphère malsaine de l’église et explorer par contraste la place pleine de lumière et de trésors humains. Quelques notables sortent d’un conseil vêtus de la culotte courte, des sandales, du panama et de la tunique tzotzil en laine noire qui leur donne un vague air de yétis. Ils piétinent devant la maison commune que l’on reconnaît à son horloge. Ils portent les bâtons, signes de leur commandement annuel et instruments du respect de l’ordre.
Des gamins jouent, indifférents à l’univers, gavroches de 12 ans aux boutons défaits, petite fille traînant un bébé dans un chariot, petits patauds qui se roulent autour de leurs mamans commerçantes à étal. Passe un adolescent soigné en chemise bleu roi dessinée et en jean noir de noir. Lui aussi porte panama mais il ne doit pas vivre au village, plutôt connaître la grande ville. Est-il un rejeton de l’élite locale ? Le fils d’un fonctionnaire fédéral ou d’un cadre du parti nommé ici ?

Nous reprenons le bus pour une trentaine de minutes. Nous poursuivons à pied, parmi les villages. Le pays apparaît très rural, très fermé. Peu de « bonjour » de la part des paysans ; les enfants, à notre vue, se cachent. Des femmes s’enfuient en attrapant leur dernier né ou un agneau. Notre passage provoque un véritable choc culturel. Nous sommes le premier groupe du premier voyage. Dès la fin de l’année, les touristes qui marchent feront partie du paysage mais on nous prend encore pour des espions fédéraux ou pour des « passeurs » de clandestins vers les Etats-Unis. L’immigration sud-américaine qui traverse le Mexique est en effet très répandue.
Ici la fertilisation des champs se fait encore sur brûlis, méthode ravageuse bien qu’écologiquement « correcte ». A un moment, un verger entier de pêchers est en fleurs. Ces petits doigts roses au bout des branches, agités par la brise, semblent se tendre vers nous pour nous saluer. Ils sont plus amicaux que les gens.
Un champ de maïs séché sur pied dresse ses tiges mortes comme une malédiction vers le ciel. Nous parlons un peu avec le guide du jour ; il nous apprend quelques mots de tzotzil. Bonjour se dit « léoté », au revoir « tian mé », va doucement « oun koun », merci « kolaval » et – grâce à Hélène, qui est belge – nous apprenons que le chou de Bruxelles (appelé à Bruxelles « petit chou ») se dit « itah ».
Nous marchons 21 km en tout aujourd’hui, six heures coupées par la visite de Chamula. Le terrain connaît pas mal de dénivelés. Le groupe est plutôt fatigué de toutes ces pentes à monter puis descendre. Arrivés à la route, nombre veulent attendre que le bus, depuis la ville voisine, vienne nous prendre plutôt que de marcher encore un quart d’heure. Mais le bus, comme le Manitoba, ne répond plus (les amateurs d’Hergé comprendront). Nous poursuivons donc un quart d’heure le long de la route pour atteindre le bourg.
















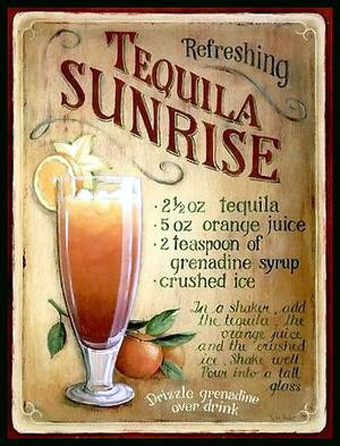










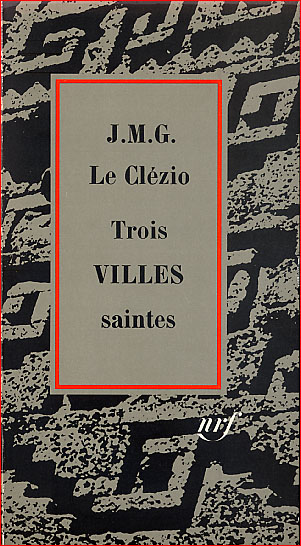
Commentaires récents