
J’ai retrouvé dans un vide-livres un vieux livre de poche 1968 qui avait enchanté mon adolescence. L’auteur, campagnarde anglaise flanquée d’un goître (elle ne mangeait pas assez d’huîtres) et épouse d’instituteur, écrivait au début du XXe siècle des romans à ses heures perdues entre cuisine et potager. Elle a enchanté la vie rurale traditionnelle et est devenue célèbre chez les Anglais – malheureusement après sa mort.
Elle situe cette histoire après la victoire (anglaise) de Waterloo dans le Surrey resté isolé du monde, chaque ferme en son terroir, la « ville » servant à vendre les produits au marché. Les superstitions et les rumeurs y courent, comme dans toute communauté fermée où chacun s’épie, se regarde et se jauge, sous l’emprise des langues les mieux pendues à défaut du talent du pasteur. Sarn est un étang bordé de champs où la brume s’élève souvent en volutes inquiétantes à l’automne. Sarn est aussi le nom de la famille du lieu, dure à la tâche et impitoyable aux enfants. Le fils, régulièrement battu par un père impie qui le force à aller écouter le pasteur pour lui en rapporter le sermon, est fouetté pour avoir été jouer avec ses copains et copines, dont il est le chef.
Un dimanche, à 17 ans, il se rebelle et, face au fouet, charge son père. Le choc dans le bide lui fait avoir une attaque et voilà le Gédéon devenu chef de famille. Il reprend la ferme et, devant tout le village, les péchés du père. Il fait promettre à sa sœur Prudence, dite Prue, de lui obéir. Le but ? Travailler dur pour gagner dur et s’offrir enfin le repos dans une belle maison avec porcelaine et valets. La maison existe, elle est habitée pour le moment par un oncle du châtelain qui devrait ne pas faire de vieux os. Le temps de planter d’autres champs en prenant sur les landes et d’ensemencer le tout en orge et blé dont les prix montent après la guerre.
Ce qui fut fait. Le garçon est royal, vigoureux, obstiné, sa sœur le seconde efficacement tandis que la mère garde les cochons. La ferme est vite prospère et une récolte inespérée s’annonce un été, quelques années plus tard. Mais voilà : l’orgueil ne paie pas, la démesure est punie par (les) dieu (x). Gédéon est amoureux de la belle blond Jancis, fille du sorcier flemmard du coin qui ne s’est jamais entendu avec le père Sarn. Gédéon veut la fille avec le blé et, dès avant le mariage, l’ensemence comme une belle terre. Le vieux sorcier, jaloux et ulcéré, se venge… Il lui a jeté un sort « par le feu et par l’eau » et va tout faire pour le réaliser. Car il est plus rusé que savant, faisant apparaître « Vénus » au fils émoustillé du châtelain qui lui paye bien les séances – mais ce n’est que sa fille toute nue livrée aux regards dans l’ombre et la fumée, hissée à la corde par une trappe de la cave.
L’avers de la pièce familiale des Sarn est la sœur Prue, cadette, effacée, dotée d’un bec-de-lièvre. Elle n’a rien de la prestance de son aîné, encore qu’elle ait un beau corps grâce aux durs travaux des champs, apprécié par les jeunes gens lorsqu’elle remplace Jancis en Vénus dans les sorcelleries de son père. Mais elle en a l’obstination et apprend à lire et écrire avec le sorcier qu’elle paye pour cela en journées de travail. Lorsque le père louera Jancis à un fermier pour aider à la laiterie, Prue écrira les lettres de Gédéon à sa fiancée, qui les fera lire par Kester le tisserand, beau jeune homme cultivé habile à la lutte. C’est ainsi que de quiproquos en billard à trois bandes, Kester verra Prue toute nue dans les ombres du sorcier, lira ses lettres d’amour adressées par un autre à une autre. Et si tout finit mal pour l’orgueilleux frère, tout finit bien pour la compatissante sœur. Si lui court après l’argent, elle court après l’amour.
Le roman est somptueusement placé dans un décor champêtre où rien n’est laissé de côté. Ni la brillance des blés mûrs la nuit, ni le vent échevelé dans les hêtres, ni les reflets des nénuphars dans l’eau trouble de l’étang. La pluie ou l’hiver font se sentir au chaud dans sa chaumière, une fois le cheval rentré, les bêtes à l’étable et le chat devant la cheminée. Lorsque « le Maître est ici », citation de la Bible, tout est en ordre et chacun en sécurité. Mary Webb, via Prue Sarn, sait nous offrir ces sentiments intimes qui sont universels. J’ai relu ce roman que j’avais oublié avec un grand plaisir.
Mary Webb, Sarn, 1924, Grasset Les Cahiers rouges 2008, 392 pages, €10.90













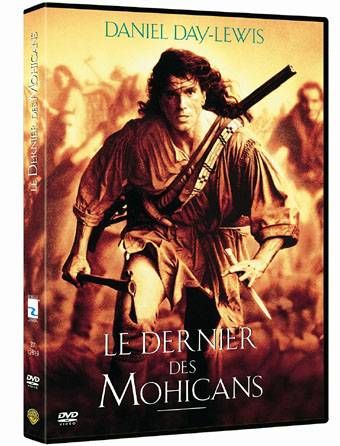































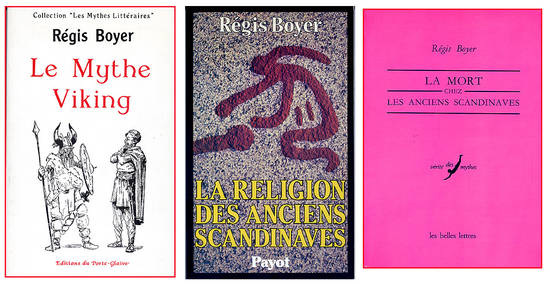
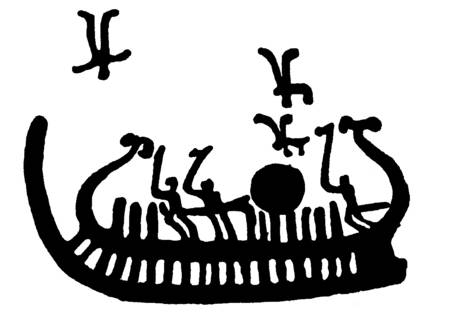
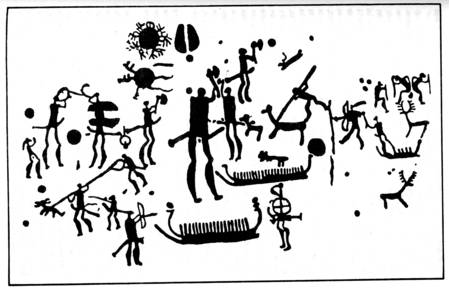

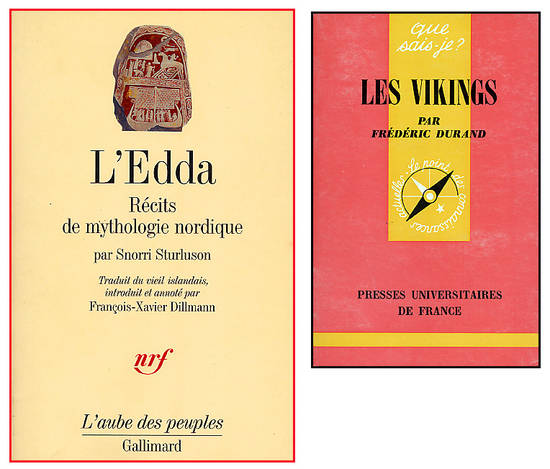

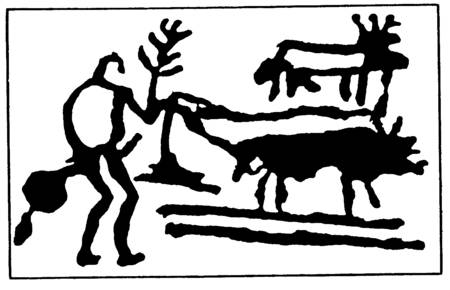

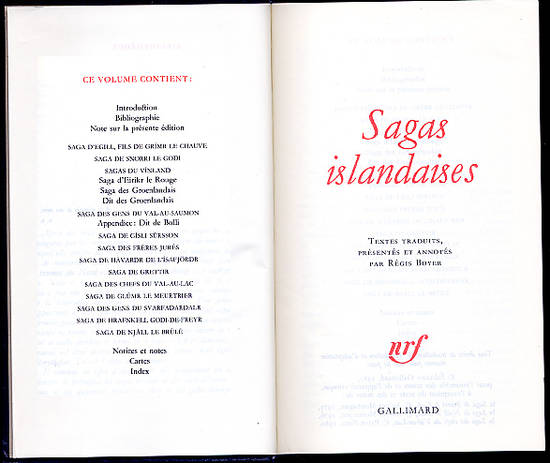
Commentaires récents