Une « peinture de l’esprit provincial » selon l’auteur (p.996 Pléiade) sous la forme de deux femmes confrontées à deux mondes : celui de la petite ville et celui de Paris.
Les deux étaient amies depuis leurs 15 ans, dans la même ville très moyenne de Saint-Front. L’une est partie, l’autre pas. Laurence est montée à Paris pour devenir comédienne, poussée par la misère et par sa mère ; Pauline est restée en province pour être brodeuse, vivant chichement en soignant son acariâtre de mère. Deux femmes, deux destins.
« C’était par une nuit sombre et par une pluie froide » que commence le roman. La berline qui transporte Laurence vers Lyon s’est trompé de chemin et s’arrête pour laisser souffler les chevaux et leur faire le plein d’avoine dans l’auberge de Saint-Front. Laurence reconnait les lieux de son adolescence. Dix ans ont passés et elle veut revoir Pauline, son amie de cœur, qui a cessé de lui écrire. Son métier à la capitale préjugé libertin par les petits-bourgeois de province la rabaissent au rang d’une pute à fanfreluches et non de l’artiste de la scène habillée selon le chic de Paris qu’elle est en réalité.
Lorsqu’elle retrouve la maison de Pauline, les deux amies tombent dans les bras l’une de l’autre. C’est par pudeur que Pauline n’a pas écrit, et à cause de sa mère emplie des préjugés étriqués de la province. Cette dernière est devenue aveugle et, après un premier mouvement de dégoût et de mépris pour la catin, elle se reprend devant la voix plus grave et la diction devenue distinguée de Laurence. L’auteur commence alors une satire du milieu bourgeois des petites villes, son dada depuis ses propres épreuves d’adolescente à La Châtre. La curiosité des bigotes est sans borne, la femme du maire pousse son gros mari à intervenir pour « demander son passeport » à la visiteuse, un prurit très administratif qui a fait plus tard les délices de Courteline et qui continue à le faire pour les citoyens confinés du coronavirus obligés de « faire des lignes » de pensum pour se déclarer eux-mêmes de sortie. La bêtise paperassière a une longue histoire en France ! Toujours est-il que le salon de Pauline, habituellement vide, se remplit de toute la faune emperlousée de la cité provinciale qui s’invite spontanément, caquette à qui mieux mieux, chacune se poussant des plumes pour approcher l’actrice et envier sa robe toute simple de grande dame.
Laurence ne reste qu’une journée à Saint-Front avant de repartir. Mais les liens sont renoués avec Pauline et, lorsque sa mère meurt, Laurence la convie à venir à Paris pour qu’elle ne finisse pas dans la peau d’une vieille fille de province. Elle est belle, prend spontanément des poses de Phèdre et peut devenir actrice comme elle. Pauline, d’un caractère différent, se laisse séduire. Mais les mois passent et, si elle se fait une place dans la famille de Laurence, sa mère et ses deux petites sœurs, elle se sent sous la coupe de son amie et cela lui pèse.
Commence alors la dialectique typique de Sand entre les deux femmes, complétée en miroir par la dialectique de deux hommes en mode mineur : Lavallée l’acteur mentor de Laurence et le superficiel mondain Montgenays. Pauline en reste à la morale bourgeoise du convenable avec la naïveté sociale qui va avec, tandis que Laurence est passée par des épreuves qui lui ont ouvert les yeux et permis de remettre en cause les « convenances ». Le bonheur se trouve-t-il dans la norme sociale ? L’exemple de Laurence prouve que non et Pauline en est jalouse. La soi-disant catin n’a pas d’amant et ne change pas de flirt avec la saison ; elle mène une vie de famille dans une maison tranquille et, si elle se fait applaudir, c’est parce qu’elle travaille beaucoup ses rôles. Pauline croit en revanche à l’amour, au mariage et à l’établissement social bourgeois.
Elle se laisse donc circonvenir par Montgenays, riche cynique qui courtise Pauline pour rendre jalouse Laurence, qu’il ne convoite que parce qu’elle est en vue. Pauline ne comprend rien à cette intrigue et croit que toute mise en garde des uns et des autres envers les manœuvres du mondain ne vise qu’à la rabaisser et à laisser la place à Laurence. Les deux amies finissent par se fâcher et Montgenays par échouer. Mais Pauline lui a cédé, il l’a mise enceinte et prend comme un défi social de la marier. Il ne l’aime pas, l’ignorera dès la noce terminée, mais Pauline sera établie dans l’état de bourgeoise mère de famille auquel elle aspirait tant. Sera-t-elle heureuse ? Le lecteur devine que non.
Malgré le titre, ce n’est pas Pauline l’héroïne mais bel et bien Laurence en femme artiste, indépendante et sensible, forte et généreuse – tout comme l’auteur se voulait et dont elle a pris l’exemple sur l’actrice Marie Dorval, connue en 1833. La femme nouvelle de George Sand ne sacrifie rien de sa personnalité ni de ses dons ; elle ne les enterre pas dans le mariage et la soumission au mâle. Elle reste autonome financièrement et socialement, au contraire de l’épouse aliénée sous la tutelle légale de son mari. Elle peut s’épanouir, elle n’est pas dépossédée d’elle-même. Pauline, à l’inverse, nourrit de la frustration qui mène au ressentiment ; elle s’enferme, s’aigrit, se protège par un statut social dont elle fait une « vertu » sans plus exister personnellement.
Ce roman d’émancipation sociale et psychologique est très agréable à lire et reste d’actualité tant la France contemporaine permet d’observer encore de tels milieux, de tels réflexes et de tels portraits.
George Sand, Pauline, 1840, Folio 2€ 2007, 144 pages, €2.00 e-book Kindle €0.00
George Sand, Romans tome 1 (Indiana, Lélia, Mauprat, Pauline, Isidora, La mare au diable, François le champi, La petite Fadette), Gallimard Pléiade 2019, 1866 pages, €67.00

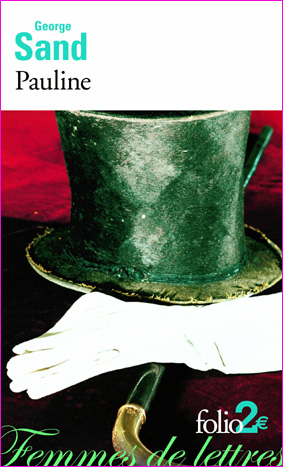

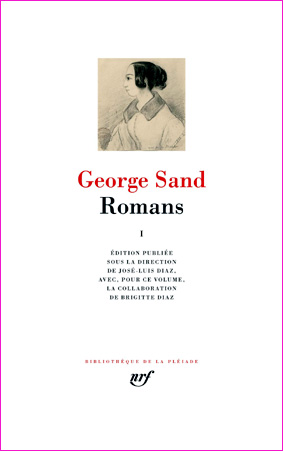
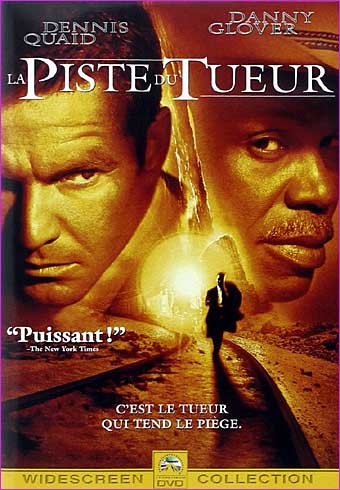

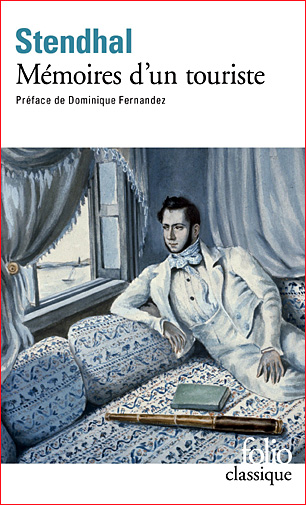





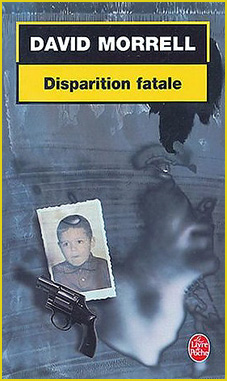
Commentaires récents