Les Français sont heureux (8 sur 10) mais la France est malheureuse. Comment le comprendre ?
Jamais l’éducation n’a été si répandue, la santé si accessible et si peu chère, la vie active plus libre (notamment grâce au télétravail, mais aussi aux méthodes moins hiérarchiques de management). Heureux comme Dieu en France, disent les Allemands, et c’est vrai, vous ne rencontrez que très peu de Français personnellement malheureux.
A l’inverse, le pays a le sentiment de décliner. Moins comme puissance militaire qui compte dans le monde que comme (im)puissance économique. La désindustrialisation est croissante, malgré les rodomontades des patrons et de quelques énarques. Pas rentable, pas compétitif, pas sérieux. Que reste-t-il ? Le luxe, l’agroalimentaire, le tourisme… Voitures et avions sont remis en cause par l’écologisme montant, très fort dans la jeunesse, même celle qui ne vote pas. Et les vélos sont produits en Chine, comme les panneaux solaires et de nombreux éléments des éoliennes. Il resterait bien le nucléaire, mais… à reconstruire tant nous avons perdu les compétences.
L’armée reste une fierté mais avec le sentiment d’une action parfois néocoloniale en Afrique, ou suiviste chien-chien des yankees au Proche-Orient. Chirac a eu raison de dire non à Bush fils ; Sarkozy a eu raison d’aller en Libye avec les Anglais et sans les Américains (en apparence, car les « gros » moyens de transports et de renseignements restaient US Army…). Mais Hollande a-t-il eu raison de rester au Mali ? Serval oui, Barkane non. S’enkyster sans faire de politique est toujours voué à l’échec ; et faire de la politique dans les pays africains finit toujours par raviver les rancoeurs coloniales. Laissons donc les généraux et despotes africains se débrouiller tout seul ; ils réclament de l’aide et ne manquent jamais de se servir de la France comme bouc émissaire commode de tout ce qui part en vrille. Laissons-les montrer combien ils sont meilleurs tout seuls.
Il nous manque la certitude d’avoir un but, ou au moins une morale. Un récit collectif. Nous l’avons perdu depuis l’échec du gaullisme dévoyé par les technocrates à la Chirac et depuis l’échec de la social-démocratie après les dérives du premier gouvernement Mitterrand. Pompidou aurait pu incarner la France industrielle qui réussit dans le monde, mais il est mort trop tôt ; Giscard, poussé malgré lui par l’ambiance de gauche de son septennat, a forcé les réformes sociétales sans améliorer la compétitivité économique, la faute aux deux chocs pétroliers arabes de 1973 (guerre des Six jours) et 1979 (ayatollah Khomeini), et à l’inflation qui a donc explosé.
Mendès-France puis Rocard auraient pu incarner une gauche de réformes sans les excès des utopistes et des « révolutionnaires » qui, soit obéissaient à Moscou (Marchais), soit étaient plus menés par leur ego et l’avidité de pouvoir que par l’intérêt populaire (Royal, Strauss-Kahn, Mélenchon, Hamon, Hidalgo, Taubira). Mitterrand a calciné les meilleurs à gauche, tout comme Chirac l’a fait à droite pour ses successeurs possibles (Balladur, Juppé, Villepin). Les Français ont le sentiment d’être sans boussole. D’où le recours magique à Macron en 2017 et son « en même temps », au fond pas si loin de Rocard s’il avait mené à bien quelque réforme plus sociale que les gilets jaunes l’ont forcé finalement à prendre. D’où le recours tout aussi magique aujourd’hui à un polémiste de banlieue qui affirme se vouloir « le sauveur » de la France alors qu’il nie tout ce qu’elle est devenue depuis 1789.

Peut-être ces échecs de sens conduisent-elles au déplacement constaté du désir ? La ville et son mode de vie étaient l’aspiration du plus grand nombre, depuis la fuite des campagnes après 1918. Quitter la terre, c’était quitter le labeur asservissant et les cancans de village pour enfin se réaliser dans un petit métier, voir des gens divers et assister aux spectacles. Plus tard, c’était accéder aux logements modernes et à leur confort, avec les études facilitées pour les enfants dans un environnement stimulant. La ville, c’était la libération, l’accès au progrès technique et scientifique. En 1968, la seule « libération » sexuelle a d’ailleurs été urbaine, très peu dans les campagnes, sauf de la part des néo-hippies qui pratiquaient le sexe comme on pratique aujourd’hui le yoga (il y a d’ailleurs certaines ressemblances…).
Ce mode de vie est aujourd’hui remis en cause. Les manifestations, les grèves des transports urbains, le Covid, la pollution, les entraves social-écologistes à la circulation (restriction des bagnoles, proliférations des vélos, trottinettes et autres deux roues sur trottoirs qui ne respectent ni les sens de circulation, ni les feux, et sont insultants quand ils vous forcent le passage) – tout cela détruit le sentiment d’être comme un poisson dans l’eau en ville. Les vieux aspirent à la campagne, à l’air sans particules fines, au calme, au repos paisible qu’il est de plus en plus difficile de trouver en ville ; les gamins sont intenables le week-end et obligent à aller le passer ailleurs. Le net et la possibilité de travailler à distance ont accentué le phénomène, sans parler des prix du foncier urbain.
Malgré les écolos qui voudraient forcer l’habitat en tours à la soviétique, 70 % des Français habitent dans une maison individuelle et veulent poursuivre ce mode de vie. Retour à la terre, mais sans les vaches des grands-parents ni les chèvres des parents. Retour aux arbres, au potager, au terrain de jeu pour les gosses, aux randonnées à pied ou aux balades en vélo. Les Français qui restent en habitat collectif aspirent à la résidence secondaire ou pour la retraite ; ils ne font plus de la ville une libération. C’est une mutation profonde du mode de penser sa façon de vivre. Le populisme est la conséquence de l’étalement périurbain non structuré, ni ville, ni campagne, où les travailleurs comme les citoyens sont relégués, extérieurs, oubliés, sans avoir les moyens de s’évader. Ils tournent en rond.
Les Français sont individuellement heureux mais collectivement mal dans leur peau. Les bénéfices de la croissance semblent mal répartis puisque ceux qui travaillent au bas de l’échelle ne parviennent plus à s’en sortir. C’est que les métiers qui rapportent sont ceux qui exigent une expertise, laquelle ne va pas sans études et diplômes, que l’école dévalue en les donnant à qui se présente sans assurer une orientation adaptée (elle est trop tôt, trop superficielle et trop autoritaire, selon les jeunes sondés). Les autres métiers sont ceux de domestiques d’Uber, de MacDo, de Deliveroo ou d’Amazon, pour ne citer que quelques enseignes. Ils sont mal payés, mal considérés, sans intérêt. Les métiers de services à la personne suscitent plus d’intérêt personnel mais sont contraints dans leur rémunération par les moyens des gens qui les emploient (hôpital, particuliers, maisons de retraite). Si une nounou des beaux quartiers ou un gardien d’immeuble peuvent être payés correctement, l’assistante de vie ou la sous aide-soignante à domicile sont payés à l’heure travaillée, souvent en plusieurs endroits dans la journée.
Le malheur public résulte de ce manque de cohésion sociale. Est-ce que les exigences de lutte contre le dérèglement climatique pourront rebâtir du politique en alternative aux récits morts ? Pas sûr tant les écolos français sont loin d’être des pragmatiques à l’écoute des vrais gens et restent des idéologues en bureaux aseptisés.
Pourtant, reconstruire des réseaux d’appartenance et de territoire est vital pour la démocratie comme pour la vie en commun. Dix métropoles produisent 81 % du PIB avec 40 % de la population. Et le reste ? Il existe aussi, il doit être pris en compte.









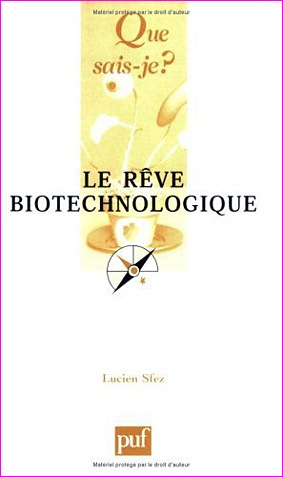




















































Commentaires récents