Le cynisme philosophique est le contraire de l’idéalisme qui prend la valeur pour la vérité, mais aussi le contraire du cynisme trivial qui prend la réalité pour norme. C’est un matérialisme en acte qui refuse de prendre ses désirs pour la réalité mais aussi de céder sur la réalité de ses désirs.
L’illusion, c’est espérer, désirer sans savoir. Les valeurs sont une illusion quand elles prétendent faire d’une vérité purement subjective (« j’aime le miel ») une vérité objective qui vaudrait en soi, pour tous (« tout le monde aime comme moi le miel »). Les valeurs sont au contraire relatives, historiques et variables.
Le « désespoir » (dé-espoir) est la désillusion poussée au bout pour laquelle aucune valeur n’est vraie et aucune vérité ne vaut. Le réel ne juge pas et il n’existe rien d’autre que le réel. La vérité, qui est une valeur, est donc illusoire – mais en tant que valeur, non en tant que vérité. Rien n’est certain, la vérité existe mais ne nous est pas assurée. Le sceptique aime la vérité mais sans certitude – c’est là son tragique.
Il est nécessaire de renoncer au rêve platonicien d’une science du Bien. Il s’agit plutôt de désapprendre le Mal, de libérer la volonté de ce qui l’aliène ou la corrompt. Il n’est pas d’autre « bien » que la volonté en acte. L’absolu est singulier, concret, sensible, mais n’est pas moins absolu pour autant. Tout est possible et – justement ! – nul ne peut s’y opposer que soi-même. Nul ne juge qu’à l’intérieur d’une certaine culture, mais nul ne renonce pour cela à juger. Héritage culture, éducation, permettent une fidélité de la volonté. Alain le disait : « la justice n’existe pas, ce pourquoi il faut la faire ».
Montaigne est un sceptique, ni sophiste ni nihiliste. Il n’affirme pas que rien n’est vrai, ni qu’il ne sait rien, mais que rien n’est certain. Toute croyance est de fait et d’opinion. D’un côté est l’ordre de la raison ou de la connaissance, qui prend les valeurs comme objets, historiquement relatifs ; de l’autre est l’ordre de la volonté ou de l’action, qui prend les valeurs comme normes et les vit comme absolues. Mais c’est parce qu’il n’y a pas de justice absolue qu’il est bon pour chacun de se soumettre à la justice relative de sa contrée et de son temps. Montaigne est sceptique en théorie, épicurien en pratique.
La leçon du cynisme philosophique est qu’il faut militer pour une « politique du pire ». Il est nécessaire de récuser l’optimisme idéaliste pour voir lucidement les choses telles qu’elles sont. Nous sommes attentifs au pire lorsque nous nous efforçons de comprendre non ce qu’il faudrait faire (une politique idéale) mais ce que l’on fait (la politique réelle). Ni le marxisme, qui voulait faire coïncider l’homme réel à l’homme idéal, ni le libéralisme, qui croit que la société laissée à elle-même s’autorégule au mieux, ne tiennent compte de la volonté. Il n’y a jamais d’autres politiques possibles pour les avant-gardes comme pour les technocrates experts (TINA : There is no alternative, disait Thatcher). La « vérité » ne se vote pas.
Nous y opposons un relativisme cynique : vouloir ne dispense surtout pas de connaître (contre le volontarisme), mais connaître ne dispense jamais de vouloir (contre la technocratie). La survie d’une société est dans la conservation, mais on ne peut conserver qu’en transformant. Il ne s’agit ni de révolutionner (utopie), ni de maintenir (conservatisme réactionnaire) mais de transformer la société telle qu’elle existe en réduisant le pire.
Pour Pascal, il s’agit de ne confondre aucun des quatre ordres : 1/ le réel, 2/ la chair, 3/ la raison, 4/ la charité. Les confondre est sombrer dans le ridicule ; les accepter est tragique – mais c’est être responsable et il n’est pas de responsabilité sans tension.
La transgression des ordres, c’est l’angélisme, la tyrannie de l’ordre supérieur. L’angélisme politique est dangereux en ce qu’il annule toute contrainte technique ou économique : il suffit de dire « je veux » ou yaka, comme si tout allait par magie se résoudre. L’angélisme éthique vise lui aussi à se libérer de toute contrainte politiques ou autres au nom d’un « amour universel » (Peace and Love, sans frontières). Autre transgression des ordres, la barbarie ou tyrannie de l’ordre supérieur : la réduction de la politique au seul marché, de la morale aux nécessités politiciennes, de la vérité à ce qu’on a envie de croire (storytelling, vérités alternatives ou fake news), de l’amour au seul respect des devoirs (moralisme).
Par exemple, le capitalisme est réel et rationnel, mais il n’est pas moral. Il est une technique économique efficace qui consiste à produire le plus avec le moins, pas une valeur (sauf peut-être en écologie… lorsqu’il s’agit d’économiser la planète et d’optimiser toute consommation des ressources).
Pour le groupe, les ordres inférieurs priment ; on peut ainsi construire le tableau suivant :
| ORDRE | TEMPERANCE | VALEURS | ECLAIRAGE | DEGRES |
| Charité | Miséricorde | Amour | L’interdit | Ame |
| Raison | Equité | Morale | L’esprit critique | Esprit |
| Volonté | Déontologie | Politique | L’expertise | Caractère |
| Réel | Nature | Economie | L’efficacité | Chair |
Dans le matérialisme, le supérieur domine l’inférieur quant à la valeur mais en dépend quant à l’être. L’amour ne doit pas se dégrader en morale, ni la morale en légalité ou en rapport de force, ni le droit ou la politique en simple technique du pouvoir. Le marxisme en sa gloire a réalisé le pire : angélique en réduisant l’économie à la volonté du Plan), barbare en réduisant la personne à la seule ligne du parti, et tyrannique parce que seule la politique compte – et sans débat puisque le Parti a toujours raison comme interprète « scientifique » de l’Histoire.
Notre époque disjoint l’humanisme théorique (l’essence de l’Homme) et l’humanisme pratique (ce qui est humain en l’homme n’a rien de naturel mais est culturel, historique). Or l’humanisme est une valeur : c’est vouloir que l’homme devienne humain par l’éducation, la tradition et le mouvement de la société – et non se contenter naïvement de « croire en l’homme ». Confondre valeur et vérité mène au pire.
Un livre aisément lisible qui fait penser et aide à percevoir le quotidien.
André Comte-Sponville, Valeur et vérité – études cyniques, 1994, PUF, 282 pages, €23.50 e-book Kindle €18.99
André Comte-Sponville sur ce blog




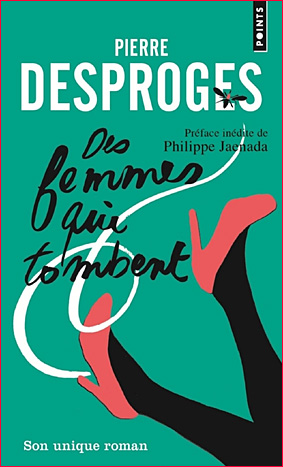


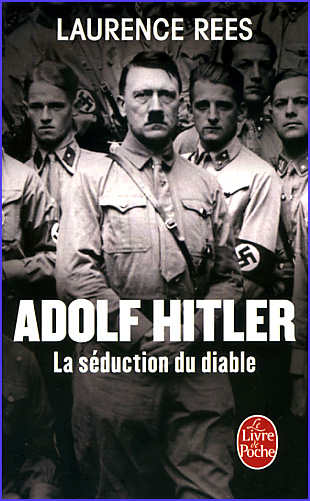



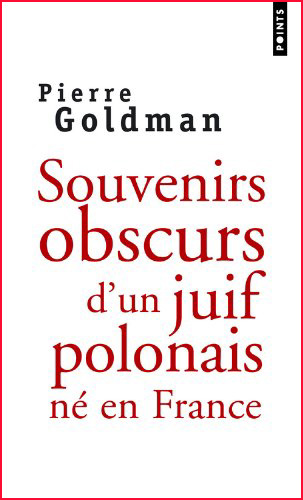

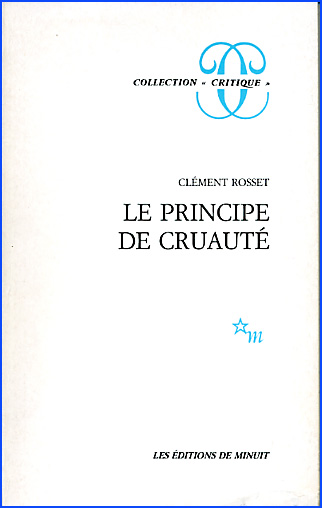

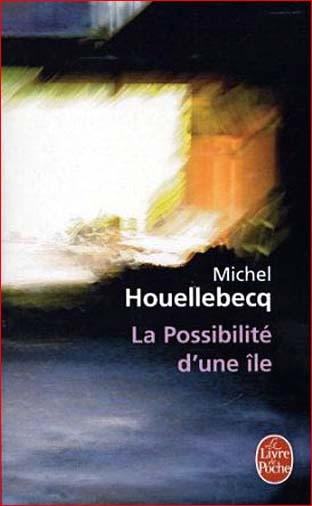


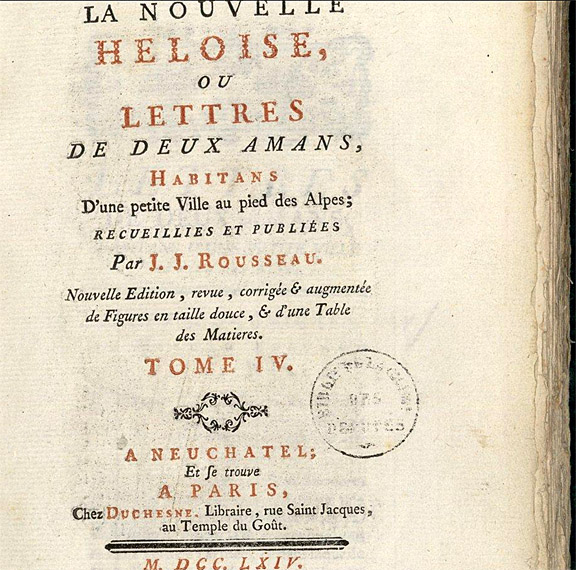

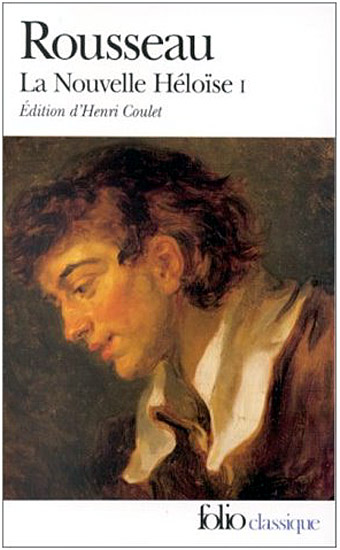



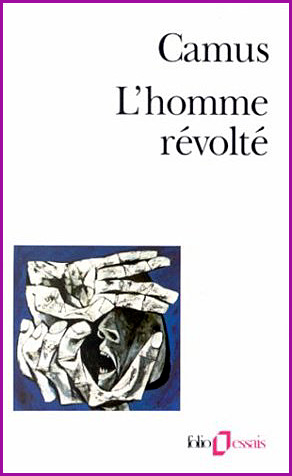
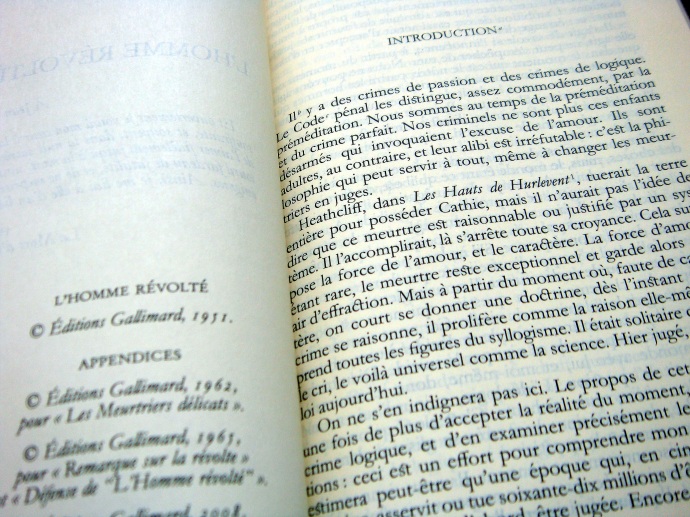
Commentaires récents