
L’auteur vit une période de grands bouleversements extérieurs : la défaite de l’Allemagne, son occupation, les réfugiés de l’est, les restrictions alimentaires. Cela l’incite à se détacher du mouvement, à rentrer en lui-même : « Il me semble que, dans les passes d’anarchie, on seulement je me suis senti particulièrement serein, mais j’ai mieux travaillé. J’ai dû le savoir de bonne heure, dès mon enfance, d’où, sans doute, ma nostalgie des forêts vierges. La pesanteur énorme, le poids atmosphérique de la civilisation, disparaît alors. Les pensées perdent leurs fanfreluches. La vie devient plus juteuse » p.15.
Ses réflexions, elles, deviennent plus mystiques. Il relit la Bible, parle de Dieu comme un stoïcien ou s’oriente vers les causes de la défaite.
Il pense, encore et toujours, à son fils aîné Ernstel, aimé peut-être plus d’avoir été tué parce que lui son père est intervenu pour qu’il ne reste pas en prison, mais il ne parle qu’une fois du petit Alexander. Jünger évoque « un petit marécage où Ernstel aimait jouer dans son enfance. Il s’était bâti son château dans ce coin, à la manière des enfants » p.200. On rencontre chez de tels père une indulgence amusée pour les entreprises des fils ; ils favorisent leurs rêves, leurs donnent des outils, les laissent indépendants dans leur univers imaginaire. Qui dira les bienfaits pour une personnalité de tels écrans créés entre le garçon et le monde extérieur entre le fils et la mère ? Rêver est indispensable à la structuration de soi. Heureux les enfants des pères qui en savent le prix et en protègent les réalisations.
Jünger, lui, poursuit ses rêves d’adulte. Il cultive son jardin, il lit. « Tant qu’on a encore un livre dans les mains et le loisir de la lecture, une situation ne peut être désespérée, ni tout à fait dépourvue de liberté » p.113. Car lire permet de s’évader dans l’imaginaire, de rêver adulte comme le font les enfants. Ernst Jünger laisse le monde extérieur venir à lui désormais, tel Michel de Montaigne en sa tour. « Seul l’aspect de l’individu, de notre prochain, peut nous ouvrir les yeux sur la souffrance du monde » p.30. Retour au réel, au tangible, au proche de soi : les Allemands, ses compatriotes, ont trop cher payé leurs chimères, les abstractions techniques auxquelles ils se sont laissé aller, la machine du pouvoir et les camps de la mort.
Il faut désormais éviter ce qui a créé le nazi, « ce mélange de mépris des hommes, d’athéisme et de grande intelligence technique » p.42. Exemple : Heydrich. « L’un des secrets de ces gens, c’est tout simplement qu’ils avaient plus de cran que les autres » p.32. Himmler : « On voit se manifester dans son cas le degré auquel le mal a imprégné nos institutions : le progrès de l’abstraction. Derrière le plus quelconque des guichets, notre bourreau peut apparaître. Aujourd’hui, il nous remet une lettre recommandée ; demain, notre arrêt de mort. Aujourd’hui il perfore notre billet et demain notre nuque. Il accomplit l’un et l’autre geste avec une égale application, et la même conscience professionnelle » p.65. L’analogie n’est pas gratuite : Lénine voyait déjà dans l’organisation de la poste et des chemins de fer la préfiguration de la société communiste : une machine à dresser les hommes pour en faire des hommes nouveaux et leur faire servir la vision qu’il croyait « scientifique » de l’Histoire.
Pour Jünger, Himmler n’est pas un cas à part, il est le symptôme d’un système : « Quand la neige est tombée tout un long hiver, la patte d’un lièvre suffit à faire débouler l’avalanche » p.65. L’hiver est ici le progrès de l’abstraction, de la technique et de la technocratie, du dressage, de la bureaucratie et de la robotisation progressive des hommes. Leur transformation en conformistes démocratiques tous égaux et se surveillant les uns les autres, ou en fonctionnaires soumis aux règlements édictés par l’élite cooptée qui gouverne. Hitler fut le démiurge de cette tendance historique : « Il absorbait des forces tirées de l’imprécis, les concentrait et les réfléchissait comme un miroir concave ; c’était un attrapeur de rêves » p.246. Après… une fois le loup au pouvoir, la machine en place enclenche ses rouages. « Le premier viol du tabou entraîne tous les autres. Il est probable qu’on a vu de telles choses dans nos équarisseries. D’abord la dégradation par le mot, puis par l’acte. Là où le libéralisme atteint ses extrêmes limites, il ouvre la porte aux assassins » p.299. Il faut entendre ici « libéralisme » au sens de permissivité, le libéralisme politique originel avant d’être économique comme aujourd’hui.
Le 22 septembre 1945, Jünger règle définitivement leur compte aux nazis, qu’il n’a jamais soutenus, dans une belle envolée : « Etrangers aux langues anciennes, aux mythes grecs, au droit romain, à la Bible et à l’éthique chrétienne, aux moralistes français et à la métaphysique allemande, à la poésie du monde entier. Nains quant à la vie véritable, Goliath de la technique – et, pour cette raison, gigantesques dans la critique, dans la destruction, la mission qui leur est impartie, sans qu’ils en sachent rien. D’une clarté et d’une précision peu communes dans tous les rapports mécaniques, déjetés, dégénérés, déconcertés sitôt qu’il s’agit de beauté et d’amour. Titans borgnes, esprits des ténèbres, négateurs et ennemis de toutes les forces créatrices – eux qui pourraient additionner leurs efforts pendant des millions d’années sans qu’il en reste une œuvre dont le poids égale celui d’un brin d’herbe, d’un grain de froment, d’une aile de moustique. Ignorants du poème, du vin, du rêve, des jeux, et désespérément englués dans les hérésies de cuistres arrogants » p.172. Telle est la plus belle charge que j’ai rencontrée contre les prétentions du nazisme (ou d’ailleurs du communisme) durant mes lectures. L’auteur chante un hymne à l’homme libre, héritier fécond de ses cultures anciennes, créateur parce qu’apte au rêve et qui laisse la technique à sa place d’outil, venant après ce qui est vivant : le poème, le vin, le rêve, les jeux…
Ce qui le pousse à écrire, à la date du 8 mai 1945 : « La vigne, le long de la maison, pousse des jeunes tiges gonflées de sève ; le feuillage, l’explosion de vie, révèlent déjà une robustesse dionysiaque » p.40. Un jour de défaite où l’armistice fut justement signé, décrire ainsi la vie à ras de terre, c’est garder l’espoir en la force vitale, présente en l’homme comme dans les plantes. Jünger touche ici au religieux dans une sorte de panthéisme de type stoïcien ou bouddhiste où l’hypothèse de Dieu n’est pas nécessaire. Chaque être vivant est une part de l’énergie qui meut l’univers. « Le stoïcisme, sous sa forme la meilleure, dans l’espace absolu, vide de dieux, et dans l’intelligence de son harmonie », dit-il p.127. Un accord qu’il perçoit dans les grands bois : « La forêt est un grand symbole de mort. Lors de telles promenades, des souvenirs très anciens se réveillent toujours, des thèmes de l’iconographie celtique : attente, curiosité, ferveur religieuse, tristesse, nostalgie peut-être. Ce n’est plus le vent qui court au-dessus des cimes. Tous les appels des oiseaux deviennent savoir, complicité, présage » p.151. L’humain se sent « relié », non plus seul mais englobé, intubé d’énergie comme un fœtus dans un ventre. Il est en harmonie naturelle avec la nature. « Et il y a une consolation dans l’assurance qu’un jour on se détachera de la matière pour se fondre dans le rayon qui appartient tout entier à la sphère du soleil, de l’amour. Tant je comprends, et de plus en plus j’adhère à ce que Ernstel m’a dit, naguère, dans l’une de nos promenades : que souvent l’on peut à peine attendre ce moment ». Et il a ce trait d’humour sublime, comme une intuition : « Dans ces années, j’ai vu trop rarement le garçon, malgré ma qualité de père, et pourtant, si je l’ai amené à proximité de ces mystères, l’acier a frappé le silex » p.194.
Le vivant l’organique, sera toujours humainement supérieur au modèle, au concept. Parce qu’il garde irréductiblement son mystère, sans lequel il ne serait point vivant. « Le noyau du darwinisme, c’est la théorie de la construction. Il lui manque la vue de ce qu’il y a, dans les plantes, de tout à fait étranger à l’économie, d’irrationnel, de gaspillage princier, le débordement du superflu qui traduit des intentions bien plus importantes que celles du simple prolongement de la vie et de la concurrence » p.66. Par exemple, « d’où peut bien venir la grande consolation, le don que nous trouvons dans les fleurs ? J’y ai songé. Tout d’abord, elle est certainement tellurique et érotique puisque les fleurs sont les organes nuptiaux, les pousses amoureuses de la terre maternelle. Les noces des fleurs sont parfaites, et même la suprême splendeur des accouplements animaux ne l’égale pas. Il semble que les lois cosmiques se dévoilent dans leur pureté native, voire paradisiaque. (…) Leur silence est si profond, si convaincant, si symbolique ! (…) Où frôle-t-on aussi clairement la possibilité, l’existence de mondes supérieurs au nôtre ? C’est un nectar divin, le vin de l’éternelle jeunesse, qui resplendit dans ces calices » p.15. Et sur un fossile : « L’univers est vivant. S’y ajoute la conscience d’une unité supérieure qui nous lie à cet être, le sentiment vague que nous sommes un dans l’inétendu » p.47.
Pour rester dans ce courant du grand tout, pour obéir à la vie et faire mouvoir les énergies dont nous sommes une part, il faut observer la vie autour de soi, percevoir l’unité qui s’en dégage, se fondre en elle. Il faut rester en harmonie avec le monde. Or, « en tant que technicien, qu’être vivant d’abstraction intellectuelle, l’homme est inévitablement ennemi et exploiteur de l’homme, de la nature et de la culture. Il lui faut donc protéger contre lui-même son humanité » p.159. Une éthique écologique et humaniste à laquelle je souscris. Les vieux peuples, d’ailleurs, ne s’y trompaient pas, dans leur sagesse : « on dit qu’en construisant des temples, les tibétains évitent la symétrie, croyant qu’elle attire les démons. (…) L’une des tendances de la vie consiste à se soustraire, la liberté croissant aux contraintes de la symétrie, comme nous le voyons en examinant l’arbre généalogique des animaux, et dans l’art. La technique, au contraire, de par son essence même, à produire des formes, non seulement symétriques, mais superposables, et devrait par conséquent, si l’on en croit les tibétains, tracer de véritables pistes d’atterrissage pour les démons » p.129.
De même, se méfier de « la raideur, l’artifice, la Haute école à l’espagnole dans tout ce qui relève du caractère », qui est la marque de Stendhal. Le danger, « on le voit chez Nietzsche et chez les stendhaliens à tous crins comme Léautaud. Montherlant, lui aussi, en porte visiblement les marques » p.229. Il faut être souple et naturel, comme la vie le montre.
Ce dernier tome du Journal écrit pendant la guerre est un grand essai à la Montaigne. Une sagesse bien vivante s’y peut goûter.
Les pages citées sont celles de l’édition Livre de poche 1980 épuisée
Ernst Jünger, La cabane dans la vigne, Journal 1945-48, Christian Bourgois 2014, 503 pages, €10.00
Ernst Jünger, Journaux de guerre, coffret 2 volumes, Gallimard Pléiade 2008, 2396 pages, €120.00


















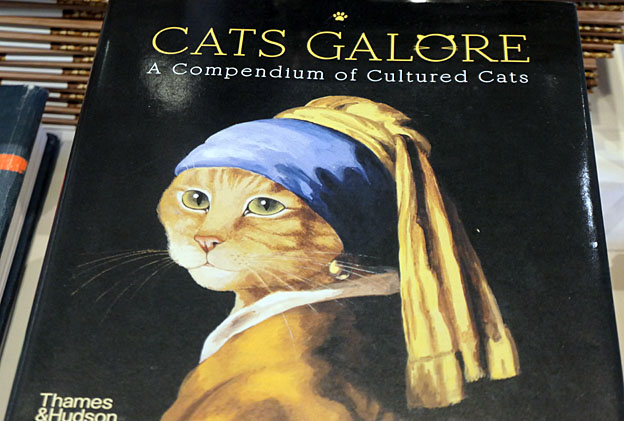






































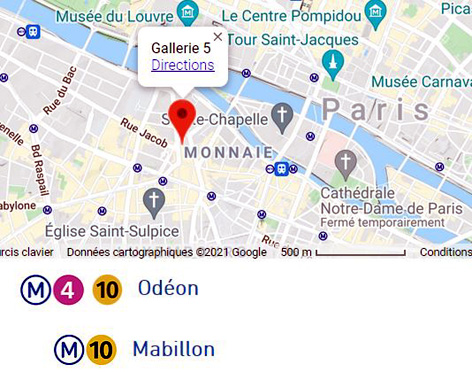




























































































































Commentaires récents