L’auteur rompt avec le naturalisme de ses précédents romans : plus de putes populacières, de mariages arrangés dans le médiocre ni de vieux garçons amollis dans le célibat. Il aborde le symbolisme avec un nouveau personnage : l’aristocrate décadent au raffinement épuisé, l’esthète réfractaire.
Des Esseintes, avec son nom précieux de fleur rare, a consumé sa jeunesse en frasques sensuelles de toutes sortes : avec les filles, le jeu, la gastronomie, le théâtre. Il est désormais repu, fatigué, détraqué. Il est atteint de la maladie de sa génération, le nervosisme, l’exacerbation des nerfs que l’auteur qualifie, selon les médicastres du temps, de « névrose ». Freud lui donnera un autre sens mais l’essentiel s’y trouve : l’inconscient agit sur le corps et le Pessimisme fin de siècle, théorisé par Schopenhauer à ce moment, n’aboutit qu’à la dépression mentale, à l’acédie affective et au délabrement physique. Un Schopenhauer étrangement proche de L’imitation de Jésus-Christ traduite par Lamennais en 1844, « la résignation avec la panacée future en moins », écrira Huysmans à Zola. Car la vie est désespérante pour qui n’a pas l’énergie suffisante. Des enfants ? Surtout pas ! « C’était de la gourme, des coliques et des fièvres, des rougeoles et des gifles dès le premier âge ; des coups de bottes et des travaux abêtissants vers les treize ans ; des duperies de femmes, des maladies et des cocuages dès l’âge d’homme ; c’était aussi, vers le déclin, des infirmités et des agonies, dans un dépôt de mendicité ou dans un hospice » p.670. De quoi se flinguer – ou se convertir pour se consoler dans l’imagination d’un autre monde possible.
Réalisant sa fortune en terres, notre aristocrate encore jeune est devenu misanthrope. « Il flairait une sottise si invétérée, une telle exécration pour ses idées à lui, un tel mépris pour la littérature, pour l’art, pour tout ce qu’il adorait, implantés, ancrés dans ces étroits cerveaux de négociants, exclusivement préoccupés de filouteries et d’argent et seulement accessibles à cette basse distraction des esprits médiocres, la politique, qu’il rentrait en rage chez lui et se verrouillait avec ses livres » p.558 Pléiade. Il investit dans une maison isolée à Fontenay-aux-Roses qu’il fait aménager selon ses plans. Tout doit être artifice pour éloigner « les nerfs » de la réalité trop crue. L’énergie vitale éthérée et vacillante du personnage ne peut supporter le vrai, le charnel, le réel. Il lui faut l’illusion de l’art, les préparations de la science, la cuisine prédigérée du « sustenteur » (ancêtre de la cocotte-minute), les supports littéraires et graphiques idoines à l’imagination, pour daigner vivre. Même le voyage à Londres s’arrête rue de Rivoli : le dépaysement imaginaire suffit à combler l’envie d’ailleurs.
Le soleil est donc tenu au-dehors comme la pluie, la lumière filtrée par un aquarium où composer des symphonies de nuances à l’aide de colorants. Il est vrai que le temps des pluies ne fait pas envie au déprimé chronique : « Sous le ciel bas, dans l’air mou, les murs des maisons ont des sueurs noires et leurs soupiraux fétident ; la dégoûtation de l’existence s’accentue et le spleen écrase ; les semailles d’ordures que chacun a dans l’âme éclosent ; des besoins de sales ribotes agitent les gens austères et, dans le cerveau des gens considérés, des désirs de forçat vont naître » p.633. De même l’orgue aux parfums permet d’ajuster l’odeur de la pièce aux états d’âme, tout comme la cave à liqueur contente le palais par des assemblages rares et les fleurs rares les bizarreries de la nature. Il n’est jusqu’à la bibliothèque qui ne soit sélectionnée, choisie et ordonnée selon les penchants intellectuels.
Dans cette thébaïde, des Esseintes vit reclus et solitaire, servi par un couple de vieux domestiques qui l’ont connu enfant, chargé des courses, de la cuisine et du ménage. Huysmans aurait pris pour modèle Robert de Montesquiou, croqué ultérieurement par Proust, lui aussi féru de chambre fermée où tout réel est banni, mais Montesquiou est fantasmé par l’imaginaire et le produit des Esseintes ne lui ressemble pas, qui apparaît plutôt comme un Werther névrosé, un précurseur de Dorian Gray, a-t-on dit.
S’ensuivent des chapitres entiers d’inventaires, très documentés avec les mots choisis, mais un brin fastidieux. Tout y passe du décor précieux, frisant le ridicule : les meubles, les souvenirs d’enfance, les livres en latin, l’agencement des pièces, les gravures et tableaux, les pierres précieuses, la religion, les fleurs, les maitresses, les parfums, la littérature contemporaine, la musique… C’est lassant à la lecture, même si l’on y trouve quelques pépites. Ainsi l’auteur préfère-t-il, parmi les auteurs de son siècle, Baudelaire, Villon, d’Aubigné, Bossuet, Pascal, Lacordaire, Goncourt, Verlaine, Poe, Corbière, Mallarmé et évidemment Zola son mentor.
Côté sexe, c’est plus ambigu. Des Esseintes est « à rebours » de tout le monde, donc plutôt porté à l’inversion. Deux épisodes avec de jeunes garçons sont saupoudrés comme en passant. Le premier, « un galopin d’environ 16 ans, un enfant pâle et futé, tentant de même qu’une fille » p.592 Il lui demande du feu et des Esseintes lui paie une pute, voulant l’accoutumer au plaisir et au luxe pour, en le privant quelques semaines plus tard, en faire un assassin. Déjà sadique, mais parfois tenté, comme souvent les catholiques, par « les anges » : « la religion avait aussi remué l’illégitime idéal des voluptés » remarque-t-il p.624. Le second, « un tout jeune homme », « échappé du collège ». « Du hasard de cette rencontre, était née une défiante amitié qui se prolongea durant des mois », dit l’auteur, elliptique p.624. Car il n’aime pas le sexe et il se contente des gravures de Callot ou des excentricités de Sade pour suggérer davantage. Ou se décentre chez Pétrone, l’auteur du Satyricon, qu’il prise fort avec sa description des mœurs de son époque, « la menue existence du peuple, ses épisodes, des bestialités, ses ruts » p.561. Mais c’est encore dans la Bible qu’il connait de troubles joies sensuelles avec Salomé qui danse nue devant le Tétrarque, couverte de pierreries qui pendouillent et dont le frottement fait ériger ses seins. Gustave Moreau la peint en « déité symbolique de l’indestructible Luxure, la déesse de l’immortelle Hystérie, la Beauté maudite » p.581.
C’est un roman somptueux, baroque et décadent qui fait date, constituant la rupture de l’auteur avec le naturalisme de Zola et l’ouvrant à la conversion catholique, huit ans plus tard. Tous ses romans ultérieurs sortent d’A rebours ; tous les thèmes y seront approfondis et développés. Fantaisie documentée, des Esseintes campe un type d’énervé devenu trop sensible, une « hérédité datant du règne de Henri III » p.624. L’histoire d’un détraqué fin de siècle, pessimiste sans Dieu qui finira par retrouver les bras de Maman selon la dernière phrase du roman : « Seigneur, prenez pitié du chrétien qui doute, de l’incrédule qui voudrait croire, du forçat de la vie qui s’embarque seul, dans la nuit, sous un firmament que n’éclairent plus les consolants fanaux du vieil espoir » p.714.
Joris-Karl Huysmans, A rebours, 1884, Folio Gallimard 1977, 430 pages, €8.50
Huysmans, Romans et Nouvelles, Gallimard Pléiade 2019, 1856 pages, €73.00


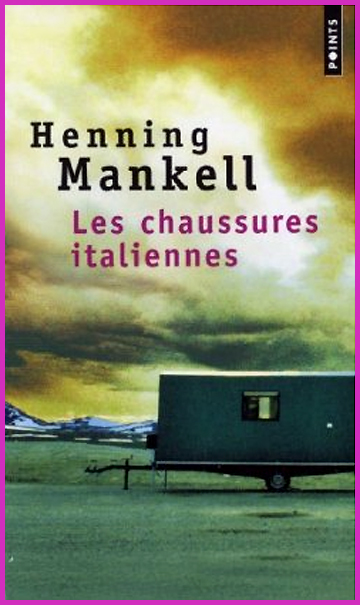

Commentaires récents