Un taxi poussif, une vieille Toyota affichant 70 000 km au compteur mais ne dépassant pas les 40 km/h dans de grands craquements de vitesses, nous permet de rejoindre l’hôtel Vajra dans Katmandou pour 30 roupies. La douche chaude est bienfaisante. À 18h30 nous avons rendez-vous avec Tara devant l’hôtel Annapurna pour assister au spectacle d’une heure de l’Everest Cultural Society, un groupe pour touristes qui présente des danses népalaises et des saynètes de cirque comme la danse du yack (avec une grosse bête en peluche) et la danse du paon, ou encore le médecin-sorcier avaleur de feu et roulant des yeux blancs. Vingt-quatre danses et scènes diverses se déroulent dans une salle de patronage, devant des touristes qui mitraillent au flash et font ronronner leurs caméscopes. Les autres du groupe ont trouvé le spectacle « nul », moi j’ai été séduit par la fraîcheur populaire de certaines danses et par le professionnalisme des danseurs. Bien sûr, j’ai été agacé par les touristes à photos et l’aspect commercial de l’ensemble, mais bien qu’édulcoré et aseptisé, il reste quelque chose dans ce spectacle de l’intention initiale et de l’expression naturelle du corps.
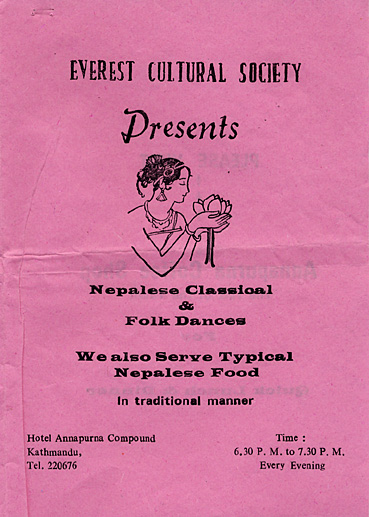
Le dîner a lieu dans « le meilleur restaurant de Katmandou » selon Tara, le Gahare Kabab, juste à côté de l’hôtel. Il existe aussi un très bon restaurant népalais, nous dit encore Tara, le Sunkosi, un peu plus loin dans l’avenue chic qui mène au Palais royal. Nous prenons un cocktail « Annapurna » à la vodka, Cointreau, jus de citron et blanc d’œuf battu. Une invention locale peu goûteuse. En revanche le tandoori de poulet est délicieux, même s’il est emprunté à la cuisine indienne. Il est accompagné de riz parfumé et d’épinards. En dessert, un truc spongieux et écœurant de sucre, le gulab jamun indien qui est une sorte de fromage. Je préfère la glace indienne aux amandes, couverte de gingembre râpé. Avec la chaleur du restaurant, et certains antécédents médicaux, Françoise a un malaise et Elle officie. La situation s’améliore et nous retournons par les rues sombres et presque désertes où l’on se demande toujours sur quoi l’on marche.

Le lever a lieu à sept heure trente pour conduire certains à l’aéroport. Nous sommes cinq à nous être inscrits pour un survol de la chaîne de l’Everest en Twin Otter, pour 95$. Las ! nous attendrons deux heures pour rien. Le vol est annulé pour mauvaise visibilité. Remboursés, nous rejoignons les autres au rendez-vous fixé devant l’hôtel Annapurna, ce qui est commode parce qu’il est facile à trouver et que tout le monde connaît. Dominique a trouvé un livre pour le cadeau de Tara, « l’Art du Népal » dans les collections du musée de Los Angeles. C’est une bonne idée, les collections américaines sont loin et elle ne les a peut-être jamais vues. Cela nous fait 70 roupies chacun.

Puis nous nous séparons pour voir la ville. Elle, Christine, Françoise et moi allons vers Durban Square et Hanuman Place pour sa dizaine de temples et son stupa dans lequel l’arbre vivace a crevé le toit. Cette description de Muriel Cerf dans son livre, L’Antivoyage, m’avait frappé. Elle est tout un symbole de vivacité dans la pauvreté. Au Népal, tout un peuple fait craquer les vieilleries et contraint la terre de sa force vitale. Il y a foule.

Se mêlent les cris des vendeurs de légumes, les sonnettes des vélos, les tut-tut électriques des motos, les piaillements des gosses très débraillés. Poussière, odeur d’essence mal raffinée, rance des lampes à beurre qui brûlent en offrande, suri des ordures qui pourrissent au soleil.

Je suis un peu saoulé de ce monde grouillant, exigeant beaucoup des sens, où le pittoresque se noie dans la masse. La capitale est trop vaste, les monuments trop serrés et trop crasseux, les avenues trop poussiéreuses et trop remplies de foule. Nous nous sentions plus à l’aise dans les bourgades de campagne, ou dans les petites villes de la vallée, Bodnath, Bhaktapur, ou même Patan. À Katmandou, Freak Street mériterait de s’appeler aujourd’hui Frippes Street tant les boutiques de vêtements, de souvenirs, de restauration pour touristes, encombrent les devantures ; elle s’appelle en fait Jhochen Tole pour les Népalais. Nous prenons un riz aux légumes et curry à l’Oasis, repéré par Elle dans le Guide du Routard. Comme souvent dans ces lieux notés par la bible du touriste moyen, il n’y a que des touristes. Un italien et son ami, un peu « de la jaquette » comme le dit Christine, frétillent et nous parlent en anglais. Une américaine au minois pékinois, chapeau tibétain d’uniforme sur la tête, parle un peu français. Il semble être d’usage d’aborder tout le monde, à la hippie, quand on est touriste à Katmandou.

Nous revenons vers l’hôtel dans la lumière dorée de fin d’après-midi. Nous terminons le périple par le grand temple de Swayambunath. De jolis yeux nous regardent depuis le stupa doré, mais il y a trop de mendiants professionnels et de stands de bimbeloterie à mon goût.

Invités ce dernier soir « chez » Tara Boum, nous voici à 19h au rond-point en face du Palais Royal. Un « frère » de Tara – le vrai – nous accueille, l’artiste qui peint et qui expose et à qui Elle a acheté deux toiles ce matin, pour deux fois deux cents dollars. Il nous conduit à une petite maison de trois pièces presque en face du palais : le royaume népalais de Tara. Whisky, bière, Coca, Fanta, préparent le gosier pour le riz-curry-poulet traditionnel cuisiné par Ram, comme pendant le trek. Il nous sert avec son visage de play-boy chinois et sa gentillesse naturelle. Sont présents aussi trois « frères », les plus drôles (le plus jeune est gras comme un Ganesh) – ainsi que Louza, le jeune aide-cuisinier qui danse si bien et qui avoue enfin ce soir n’avoir guère que quinze ans. Louza, en népalais signifie quelque chose comme « zut ». Ce n’est pas le nom du garçon mais son surnom, acquis un jour d’inattention. Il danse toujours aussi bien et c’est un plaisir esthétique de le voir évoluer, maître de son corps qui, de trapu, devient léger, possédé par le rythme, mu avec une grâce qu’il n’a pas dans la vie courante. Danse aussi un porteur, « un joli » selon Christine, le « torse triangulaire » comme elle les aime.
Michel a trouvé « un copain » cet après-midi et est invité. Il nous quitte dans la soirée pour rejoindre son jeune vendeur. Christine soupçonne quelques mœurs non conformes, mais Michel est naturellement liant et aime rencontrer les gens nouveaux ; je crois qu’il en a aussi un peu marre du groupe après deux semaines, ce qui peut se comprendre avec toutes ces femmes…
Nous revenons à l’hôtel dans les rues noires après cette belle soirée d’adieu.

Nous nous levons à 7h30… pour rien. L’avion, prévu à 11h, ne part pas avant 21h30 en raison de « problèmes techniques » ! La RNAC ne possède que trois avions qui font la rotation avec l’extérieur. Celui qui vient de rentrer est en panne de radio. Mais cela, nous ne le saurons pas avant… 15h ! Aussi, nous faisons nos adieux à Tara, Cham, Ram, Lama, Git et les autres. Tara a amené Rahula, son petit garçon de trois ans tout timide devant ces gens qu’il ne connaît pas. Il sera beau. Un bus nous emmène gratuitement jusqu’à un grand hôtel de luxe, le Saaltee Obernoi, à l’ouest de la Vishnu mati. Le self-déjeuner est superbe.

Depuis le lever jusqu’à l’atterrissage à Paris s’écoulent 31 heures. L’avion part effectivement à 21h30 – il ne devait pas arriver à Francfort, sa destination, entre 1h et 6h du matin puisque Francfort est fermé pour le confort des riverains. Après avoir discuté des membres du groupe et de « sociogrammes » avec Michel, nous faisons escale à Dubaï. Selon Michel, ce groupe a trois « leaders » ; il y a ensuite les satellites, puis les marginaux. Michel se place en « intermédiaire » entre les sous-groupes. Il aime à jouer ce rôle étant, selon ses dires, assez « mouton de panurge », d’accord avec tout le monde pour avoir la paix. Mais ce schématisme groupal, issu des instituts de formation de l’Éducation nationale, me laisse dubitatif. C’est plaquer une grille toute faite sur des relations mouvantes et éphémères. Et son pouvoir explicatif est faible. Elle et Christine ne cessent elles aussi de discuter sur le groupe, comme des vautours fascinés par la charogne. Elles critiquent Annie trop pomponnée, Sylvie trop fade, Michel opportuniste, Christophe coincé, Lily « moi je », et ainsi de suite. Je ne sais ce qu’elles disent de moi derrière mon dos ! Un groupe trop parisien, la nouveauté du circuit et les éternelles grèves de courrier des années 1980 ayant empêché la province de recevoir à temps le catalogue. Un prof et une ex-instit dignes représentants de la gent enseignante et – comme toujours – insupportables : ils savent tout et parlent tout le temps. Un niveau d’effort trop faible, la marche facile attire n’importe qui et surtout les vieux qui se croient sportifs quand le voyage est lointain et cher.

J’avais 30 ans de moins alors et me sentais trop materné par l’organisation, omniprésente : quatre sherpas plus Tara, plus les cuisiniers et les porteurs, soit vingt népalais pour dix marcheurs. Avec cela, l’eau chaude le matin, la tasse de thé au réveil, les tentes toutes montées, le serre-file dans les marches… Je n’étais pas venu pour retrouver le Club Med. Malgré cela, les gens, le paysage, Tara… Le Népal est un beau pays. J’y reviendrai.
Fin du voyage
Ce circuit de randonnée facile de Terres d’aventure existe toujours, même s’il ne part pas cette année en raison du tremblement de terre.






































































































































































































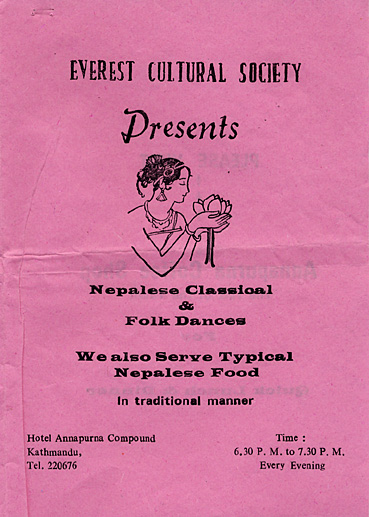









Commentaires récents