La nuit fut bonne, fatigue aidant ; le réveil a lieu plus tôt, à 6h30, pour partir gravir nos 1000 m de dénivelée avant la chaleur. Le petit-déjeuner est pris à l’hôtel avant d’aller remplir les bouteilles à la source. Elle est si fréquentée par les locaux qu’un arrêté du maire conseille aux habitants de ne pas exagérer ! Dans le petit matin, les vieux qui viennent s’approvisionner en bidons de Chianti de trois litres, s’exclament : cinghali ! Les sangliers ont en effet foui les bordures en pierres des vignes pour tenter de manger les raisins. Mais la clôture a tenu.
Une lente montée commence dans la vallée par un sentier mieux aménagé qu’hier. Nous allons le long du torrent presque à sec, parmi les châtaigniers et les chênes lièges. Dans le sous-bois, nous voyons un bouquetin qui fuit sans se presser. Dans un fourré, au passage à gué du ru où ne subsiste qu’un peu de boue, nous avons entendu les sangliers ; ils se cachent mais ne sont pas très sauvages. Ils ont été dérangés de leur bauge.
La montée se fait plus roide dans le maquis, sur le flanc sud-est du torrent, avant de déboucher sur la crête vers 650 m.
Nous la prenons alors vers le nord-est pour aborder les abords du mont Capanne, 1018 m, qui est notre destination.
Le chaos de roches et un peu casse-pattes, mais le clou est un dôme de dalles en via ferrata. Les grandes chutes de granit pentues sont plantées de pitons soutenant un câble métallique auquel se tenir à mesure qu’on grimpe.
Rien de vertigineux, tout juste de l’aérien ; rien de technique, tout juste du fatigant. Car se tenir au câble et grimper les jambes, répartir en équilibre le poids du corps, ne va pas sans effort.
Quand il pleut, le tout doit être glissant et mieux vaut ne pas s’y avancer. Mais la journée est belle, à peine voilée.
Nous atteignons le sommet du mont Capanne, parmi les touristes en nombre venus par téléphérique de l’autre côté. Nous allons jusque sous les antennes pour faire « la » photo de groupe, comme tout le monde.
Nous pique-niquons au bord de l’aire pour hélicoptère, devant quelques Allemands avec gosses qui s’empressent de redescendre avant la fermeture prandiale de la télécabine de 13h30 à 14h30. Un petit blond florentin et sa sœur ne tiennent pas en place ; je ne parviens pas à les capturer sur numérique. Ils jouent avec moi sans le vouloir car je les reverrai en fin d’après-midi, en bas du téléphérique, aussi insaisissables, jusqu’à leur voiture garée en bord de route, qui indiquent qu’ils habitent Florence. Un petit Allemand est tendre avec son père plutôt enveloppé mais ne tient pas plus en place, lacets défaits et démarche sautillante ; il souffre en outre de trachéite de ne pas se couvrir – un vrai gavroche le nez au vent. Un couple de vieux au style californien, en maillot de bain, cuivrés, cheveux longs tenus par un bandana, le corps flasque, ont le genre à avoir eu 20 ans en 1968 et de n’avoir jamais quitté l’époque. Ils sont à la fois laids par leur apparence de septuagénaires et ridicules par leur affichage de jeunesse perpétuelle flétrie.
Nous étions huit à monter ce matin, les six autres sont venus tranquillement par la télécabine – en apportant le pique-nique collectif. Ils ont pris le bus de 10h40 et nous ont rejoints alors que nous arrivions au sommet. De loin, nous apercevons la Corse.
Les descendeurs partent avec Denis car le sentier est long (près de 2 h) et pénible (ravagé par les baskets de touristes). J’ai décidé de prendre la télécabine pour descendre, ce que les Italiens appellent cabinovia – le funiculaire. Il vous dévale 644 m de dénivelée en une quinzaine de minutes, comportant 59 cabines où l’on peut tenir jusqu’à trois. Mais en général, un grimpeur et son sac à dos suffisent pour emplir la cage métallique ouverte sur le vide, qui ressemble fort à une cage à oiseau en métal peint en jaune d’œuf. Un couple avec enfant, un adulte et deux enfants, ou encore trois copains sans sac et assez jeunes, donc minces, peuvent tenir en une fois.
La descente seule coûte 12 €, la montée et la redescente 18€. Nous sommes cinq à opter pour le téléphérique et nous prenons un pot au bar-restaurant du départ. Un moment, les nuages montent et il pleut un peu, mais cela ne dure pas. Ceux qui descendent n’ont rien pris.
Dans le couloir du téléphérique, le sol est jonché de chapeaux et casquettes imprudemment gardées sur la tête alors qu’il y a toujours du vent. Quelques canettes et bouteilles aussi. Les gens qui montent présentent toutes les attitudes : désinvoltes au point de se retourner (ce qui fait tanguer la cabine), agrippés des deux mains aux barreaux, assis dans le fond plus grillagé, embrassés sans rien voir, serrant dans ses bras un enfant… Le téléphérique a son point d’arrivée près du village de Marciana.
La route de liaison passe sous le village de Marciana, étagé en hauteur. Seuls les cafés et glaciers se trouvent à proximité, l’intérieur du village est vide malgré sa forteresse, son musée, ses églises. Nous n’avons que trois-quarts d’heure avant le bus prévu à 16h07 et nous parcourons quelques rues ; malheureusement elles montent et nous renonçons vite, la journée a été assez rude comme cela. Nous visitons l’église Santa Croce au plafond peint à fresques avant d’aller prendre un granité citron (2 € le verre moyen) en attendant les autres.
Ils ne tardent pas à arriver et nous occupons à nous quatorze la moitié du bus. Il met 45 mn pour rejoindre Pomonte par la côte. Le ciel est gris, la plage quasi vide et il fait lourd. Le bus nous ramène vers 17h20 et nous pouvons jeter un œil dans l’église de Pomonte qui est ouverte. Un vitrail moderne derrière le chœur est de bel effet au soleil couchant.
Dans la cour familiale de notre chambre d’hôte, trois enfants jouent à Batman avec les déguisements de rigueur. Il y a Giacomo, le fils de la maison, 8 ans, sa petite sœur Rita déguisée en princesse, 6 ans, et un copain, William, 9 ans. Il s’agit du petit blond costaud que j’ai vu hier à la plage plonger du rocher. Je l’ai reconnu à ses cheveux très blonds, à ses yeux bleu clair, mais surtout à sa médaille de cou, un soleil en ronde bosse d’acier poli. Une fille dans les 11 ou 12 ans, Paola, vient aussi jouer un moment, mais ne s’attarde pas. Ils sont bruyants et pleins de vie, je n’ai pas envie de lire et je les écoute, allongé sur mon lit après la douche. Ils articulent bien l’italien – du pur toscan – même si je ne comprends pas tout. William a la voix rauque ; il paraît un petit dur sans cesse à s’exercer, bon copain plein d’initiative et sans peur.
Nous nous donnons rendez-vous pour l’apéritif au café en face d’hier, afin de ne pas faire de jaloux parmi les commerçants, dit Denis. Les boissons sont les mêmes mais le service est moins bon et les antipasti plus réduits ; les patrons sont anciens. L’ado solaire d’hier soir repasse depuis la plage, toujours torse nu mais les cheveux plaqués par le bain. Peu de monde revient comme lui de la mer. Il enfile une ruelle sur le côté d’une boutique juste après l’église.
Le restaurant de l’hôtel est le même qu’hier, avec Simone en patronne à petite robe noire, que nous avons vue en maillot de bain cet après-midi avec les enfants. Spaghettis aux fruits de mer, pavé de poisson et des fruits, le tout accompagné d’un vin blanc toscan de l’année. Le poisson serait du tchernia, « qui ressemble à du saint-pierre ? » dis-je à Denis (à cause de l’animateur de télé). Les convives du restaurant d’hier et d’avant-hier logent à l’hôtel et nous les revoyons souvent. J’ai remarqué un ado carré et sa sœur, dans les 13 et 11 ans, émouvants à observer. Lui responsable, elle discrète, tous deux jouant un jeu social face à leurs deux parents.






























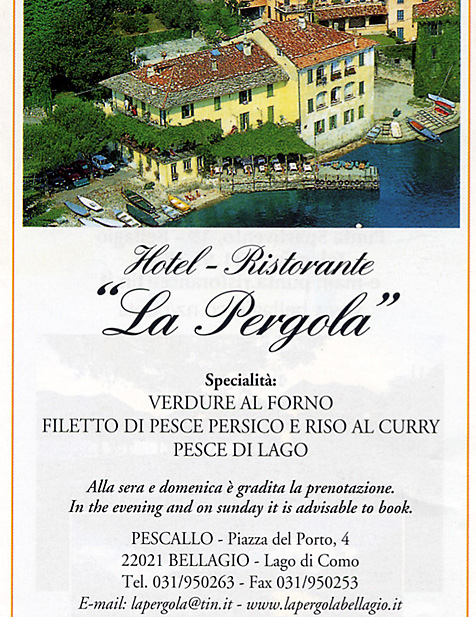











































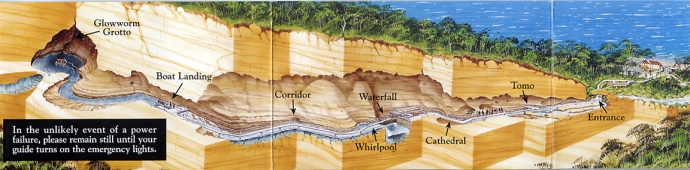
Commentaires récents