La gauche libertaire est l’une des 4 gauches définies avec brio par Jacques Julliard mais c’est la plus visible – et c’est contre elle que je m’élève parce qu’elle qui occupe les médias en boucle (intellos, experts autoproclamés, universitaires qui ont fait 68, etc.) Il ne s’agit pas de Manuel Valls, de Pierre Joxe ni de certains autres, mais de la constellation des « conseillers » et autres intellos « de gauche » bobo, ultra-parisiens (rapport Tuot sur « la société inclusive », préconisations Terra Nova sur les nouvelles majorités électorales, etc.).
Les dessinateurs de Charlie (et l’économiste) étaient de la génération d’avant, antiautoritaires (antigaullistes et antisoviétiques) dans la lignée de la Commune de Paris, sans être vraiment anarchistes (ils se déclaraient pour le droit).
Ce qui m’agace dans les assauts « d’émotion » et de « vertu républicaine » de la gauche intello-médiatique impériale à la télé, à la radio, dans les journaux est cette posture « d’indignation »… sans aucune conséquence pratique. « Ah non, pas interdire le voile ! Ah non, pas publier de statistiques ethniques ! Ah non, pas de classes de niveaux, tous pareils ! Ah non, il ne s’agit pas de guerre ! Ah non, l’islam n’est pas une religion à dérive totalitaire ! »
« Islam violent ? You dare ! » : IMAGE CENSUREE en juin 2019 A LA DEMANDE DES AUTORITES PAKISTANAISES


C’est la même posture du déni que la gauche sous Jospin à propos de la délinquance et du « sentiment » d’insécurité. On a vu ce que les électeurs de base en ont pensé le 21 avril 2002…
Les spécialistes de l’islam savent bien expliquer la distinction entre foi et politique, entre islam et dérives wahhabite puis intégriste, puis terroriste. Mais les intellos ne le font pas, soucieux avant tout d’éviter « l’amalgame », la « stigmatisation » et autres dénis de réalité : ils parlent sans savoir, comme d’habitude, se précipitant pour occuper la première place à l’audimat de l’indignation.

Pourquoi ne constituent-ils pas CONCRETEMENT un Comité de vigilance des intellectuels comme la gauche en 1934 après les émeutes nationalistes du 6 février contre les parlementaires ? C’est ce sur quoi je m’interrogeais dans ma note d’avant-hier. Ce serait un laboratoire de réflexion, une force de propositions trans-partisane, traduisant dans les faits cette « unité » qu’ils revendiquent – tout en restant jusqu’ici dans leur fauteuil confortable.
Il s’agirait de réfléchir aux failles de la société française :
- l’immigration fantasmée : or elle est « incontrôlée légalement » (90% de ceux qui entrent chaque année le font parce qu’ils en ont le DROIT par mariage, regroupement familial, asile politique accordé ; 100% des minorités visibles nées en France SONT français, qu’on le veuille ou non) – doit-on changer le droit ? dénoncer les traités internationaux signés ? les renégocier ? invoquer une exception ? – ou les accepter tels quels, mais sans alors accuser sans nuances « l’immigration » ;
- la faillite scolaire : l’enseignement resté figé aux années 60, pédagogo, élitiste, matheux, méprisant, inadapté aux nouvelles populations (tous jeunes confondus) et aux nouvelles communications. « J’ai voulu, au travers de mon parcours, raconter que la fermeté à l’égard de ces jeunes est une marque de respect ; la complaisance une forme de mépris » écrit par exemple Zohra Bitan, banlieusarde d’origine et ex-PS. Distinguer la foi de la mauvaise Foi, apprendre à penser soi-même, à travailler avec les autres, à s’exprimer avec des mots (et pas en manipulant des items linguistiques !), apprendre les règles de la vie en société…
- la faillite du « vivre ensemble » : violé à la fois par les partis extrémistes de droite ET de gauche (à qui on laisse dire à peu près n’importe quoi) et par le gouvernement socialiste bobo (qui braque les sentiments des gens moyens et des croyants par « le mariage » gai ou le vote « des étrangers », toutes revendications communautaristes bien loin de l’Unité nationale hypocritement revendiquée). Les intellos ne cessent de critiquer, saper et déconstruire la culture occidentale, les associations communautaristes ne cessent de culpabiliser la France entière en rappelant sans cesse les croisades, la colonisation, la Shoah… alors que c’est aujourd’hui qui compte le plus : les pouvoirs autoritaires en Arabie Saoudite, en Syrie, en Algérie, etc., la corruption et le clanisme des élites politiques des pays émergents notamment africains et proche-orientaux, l’attitude d’Israël au mépris de l’ONU depuis des décennies, les petites Shoah en Bosnie, au Rwanda, au Soudan, en Palestine, en Irak qu’on laisse faire comme si de rien n’était. Comment se sentir « français » dans cette culture du mépris et de la honte permanente ? Françoise Sironi, psychanalyste et psychologue du Magazine de la rédaction de France-Culture hier, a pointé la « fragilité personnelle » des terroristes, leur « métissage » entre deux cultures, leur absence de certitudes sur ce qu’ils sont ou ceux qui peuvent les reconnaître. Le multicuturel ne fonctionne QUE lorsqu’on possède déjà une culture; on peut alors s’ouvrir aux autres cultures. Mais lorsque l’on n’est pas sûr de soi, reconnu nulle part, sans modèle de construction pour sa personnalité, le multiple en soi fait se perdre ; la tentation rigoriste des « sectes » ou des religions totalitaires est alors une tentation de facilité : « on » vous dit ce qu’il faut penser et comment il faut vivre. Le communisme a été l’une de ces « religions », il y a deux générations; c’est aujourd’hui l’islamisme radical. La liberté fait peur, il faut être armé pour être libre. Quand on ne l’est pas en soi-même et qu’on se sent impuissant, on utilise un substitut : une kalachnikov.
- la faillite de l’emploi : la lutte « contre le chômage » (qui touche particulièrement les jeunes et particulièrement les banlieues) invoquée comme une « priorité » alors que François Hollande pratique l’exact INVERSE : hausse générale des impôts, taxe à 75% symbolique, injures aux entrepreneurs et aux « riches », menaces (verbales) aux étrangers investissant en France (surtout pas d’amendes comme les États-Unis le font !). Comment le chômage pourrait-il reculer, étouffé par les réglementations, les taxes en cascade, l’état d’esprit anti-croissance (écolo), anti-entreprises (gauche du PS), anti-richesse (PDG Mélenchon), anti-réusssite (vieille austérité catho reprise par les jansénistes socialistes à la Martine Aubry) ? Pour la gauche, la seule « réussite » sociale ne passe que par le service d’État (la polémique anti-Macron sur les milliardaires en est l’exemple plus récent) : serait-ce « déroger » d’être entrepreneur, comme sous l’Ancien régime ?
- la faillite républicaine enfin : qui bâtit des lois mal ficelées, inapplicables (sur le voile…), qui fait du tortillage de cul lorsqu’il s’agit de l’appliquer (le survol « interdit » des drones au-dessus des centrales nucléaires : pourquoi ne pas les détruire sans sommation ? Il n’y a personne dedans et c’est clairement dit et répété : c’est interdit – haram en arabe) ; qui gère la délinquance par le seul répressif, tout le monde pareil, au risque de radicaliser les jeunes en prison – sans leur donner un modèle alternatif ; qui émet des incantations à « l’union nationale » tout en s’empressant aussitôt d’exclure tel ou tel (fatwa Hidalgo et consorts) sous prétexte qu’ils ne seraient pas « républicains » : c’est quoi être républicain en république ? Obéir aux lois et respecter les institutions ? Alors tous les partis légalement autorisés SONT républicains – ou alors le mot ne veut plus rien dire : la gauche intello adore « déconstruire » et embrouiller le sens commun afin de se poser en seule interprète du Bien… Faillite républicaine manifeste chez François Hollande, qui invoque l’unité dans un discours essoufflé dont il a le secret – tout en laissant son parti dire le contraire et appeler à manifester chacun sous sa pancarte : PS, PDG, écolosLV, CGT, etc. L’identité, ce serait mal à droite mais « vertueux » à gauche ? On mesure combien un Hollande n’arrive pas à la cheville d’un de Gaulle, d’un Mitterrand, ni même d’un Chirac (Allah sait combien je le considère peu, pourtant). Lui-Président apparaît comme président-croupion, technocrate à langue de bois toujours dans la synthèse horizontale sans rien de la hauteur d’arbitre au-dessus des partis requise par la fonction – encore moins l’incarnation de « la France ».

Ce sont ces faillites qui fragmentent la France en autant d’égoïsmes communautaires, chacun replié sur ses petits « droits ». Dans ces interstices, les daechistes veulent frapper comme les fascistes hier, pour accentuer les fractures et monter les communautés les unes contre les autres. Ils sont aidés en cela par les suiveurs du « pas de vagues », « mieux vaut la paix », « ils ont été trop loin » et autre état d’esprit de collaboration pétainiste à l’œuvre dans toutes la société française. Et dont Houellebecq a rendu la texture dans une fiction récente – dont je reparlerai.

Cela dans une tendance mondiale au national-quelque chose : national-islamisme daechiste, pakistanais ou turc, national-judaïsme de la droite israélienne, national-‘socialisme’ de l’extrême gauche française, national-étatisme de l’extrême droite française, du pouvoir algérien et du Poutine russe, national-jacobinisme de la majorité socialiste, national-affairisme américain, national-communisme chinois, et ainsi de suite. Qu’y a-t-il dans l’islam qui facilite la tentation totalitaire ? Est-ce différent des autres religions ? L’exigence théocratique réclame-t-elle un État appelé califat pour les croyants de l’Oumma ? L’histoire est-elle autre ? Est-ce un simple « retard » de développement (théorie un peu ancienne et passablement condescendante) ?
Le danger radical est donc l’épuration ethnique. Je me souviens d’avoir été interloqué lorsque mon directeur de thèse, alors professeur associé à Paris 1, ministre plénipotentiaire et conseiller spécial du ministre des Affaires étrangères Claude Cheysson à l’époque (donc de gauche socialiste bon teint), m’avait dit que « finalement, la meilleure solution en ex-Yougoslavie serait la partition ethnique, comme les Turcs l’ont faits aux Grecs en 1920 »… Avait-il tort ? Pas sûr, rien n’est jamais tout blanc ni tout noir, ce serait trop simple.

Le chacun chez soi ne conduit pas forcément à la guerre, mais limite l’épanouissement. Désolé d’être brutal, mais rester entre soi rend con. Chacun peut le constater dans les milieux très bourgeois (pour faire plaisir à la gauche) ou chez les islamistes sectaires (pour faire plaisir à la droite). C’est la même chose pour les nations : est-ce par hasard si les nations les plus ouvertes sur le monde, dans l’histoire, ont été les plus grandes et les plus prospères ? Rome, Venise, Amsterdam, Londres, New York – aujourd’hui Singapour ou Rio.
En cas de guerre ouverte (Turquie des années 20, Allemagne des années 30, ex-Yougoslavie des années 90, Russie et Syrie 2014), l’exil des « allogènes » est peut-être la solution d’urgence. Mais certes pas une solution à long terme.
Car, à long terme, le nomadisme est historique – depuis les premiers hominidés sortis d’Afrique, avant nos ancêtres directs partis du Proche-Orient vers 200 000 ans. Le mélange fortifie – à condition qu’il soit dosé. Comme le poison ou l’ingrédient de cocktail, tout est question de posologie : trop d’eau dans le whisky (ou de lait dans le thé) rend le breuvage insipide ou écœurant ; un peu d’eau ou de lait avive les saveurs, enrichit les arômes, permet d’explorer de nouvelles sensations. L’immigration est donc à la fois une chance et un danger.
Ce que je reproche à la gauche est de nier les problèmes posés par l’accueil « sans frontières » ; ce que je reproche à la droite est de nier la réalité des traités signés (souvent par des gouvernements de droite) sur le « droit » à immigrer. Il faudrait donc en débattre, mettre des chiffres fiables sur la table, sérier les problèmes posés, mieux répartir les lieux d’accueil, avoir enfin une véritable politique du logement (et pas à la Duflot !), réaffirmer clairement les droits et les devoirs, à commencer par la neutralité laïque (ce qui veut dire aussi, surtout à gauche, faire taire les ayatollahs de la laïcité militante).

Quant à « déchoir de nationalité française » les retours de Syrie, d’Irak ou autres lieux djihadistes, c’est irréaliste : un slogan populiste qui ne tient aucun compte du droit actuel. Car si vous êtes « né » français, vous ne pouvez être déchu ; seuls les doubles-nationaux peuvent l’être s’ils se comportent comme les nationaux du pays étranger dont ils sont AUSSI ressortissant. On ne peut devenir arbitrairement apatride. Ou bien l’on change le droit (et les traités internationaux que la France a volontairement signés), ou bien il s’agit de proposer des solutions applicables, comme le rétablissement de l’autorisation de sortie de territoire pour les mineurs, l’obligation de visa pour se rendre en Turquie ou la consultation par les services antiterroristes des listes de passagers d’avion dans l’UE (refusé jusqu’ici parce que portant atteinte aux libertés publiques).

Nous sommes un régime démocratique (et pas poutinien), nous devons donc suivre les règles démocratiques. Ce qui n’exclut pas la force : inutile de « rétablir la peine de mort » par exemple, autre slogan simpliste (aux effets secondaires jamais évoqués…) : nous sommes en guerre parce que les daechistes déclarent la guerre et portent des armes de guerre ; la police ou les services spécialisés doivent avoir contre eux un comportement d’état de guerre, ce qui signifie tuer s’ils sont directement menacés – ou plus généralement « neutraliser » si déférer à la justice est possible. Ce qui est socialement plus pédagogique.

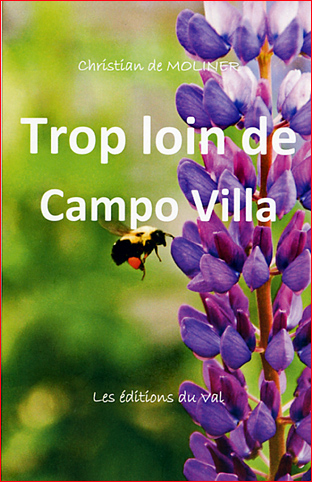
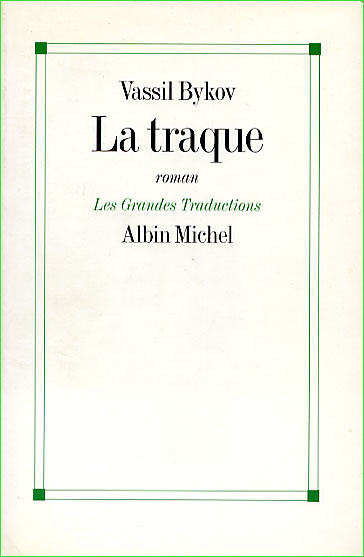
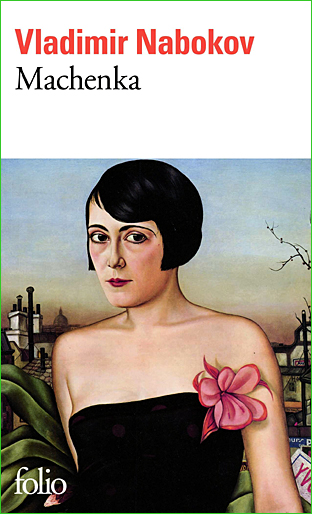
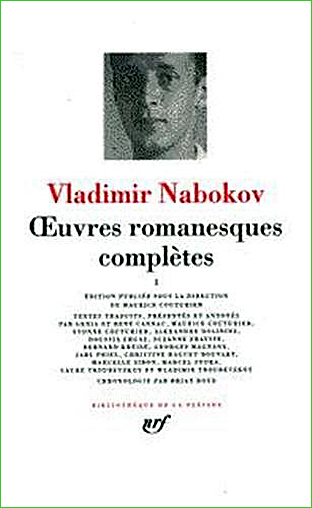








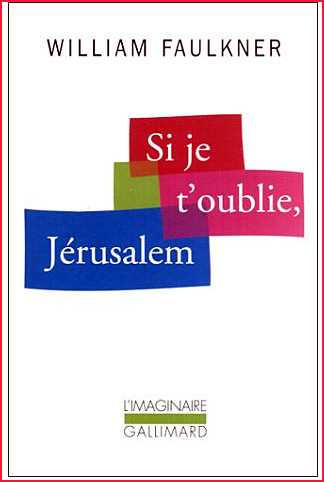

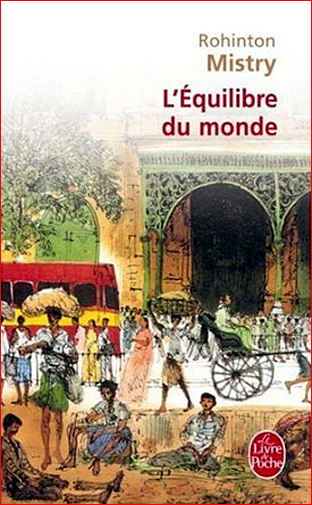














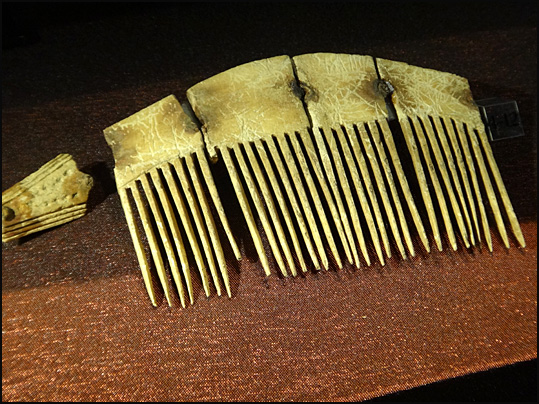



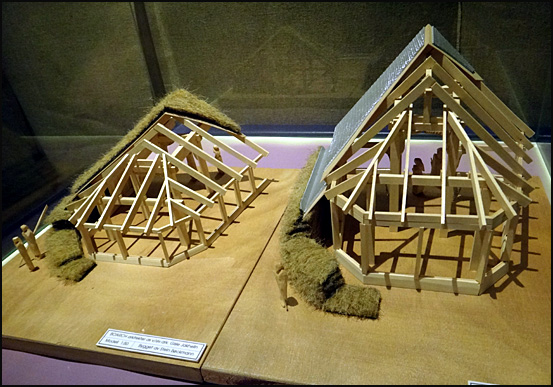












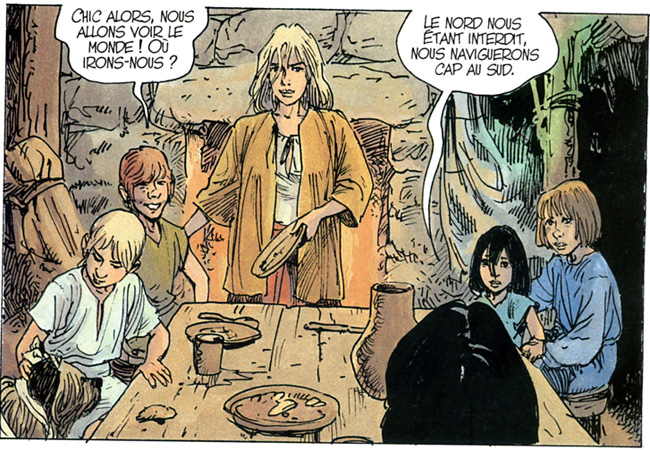
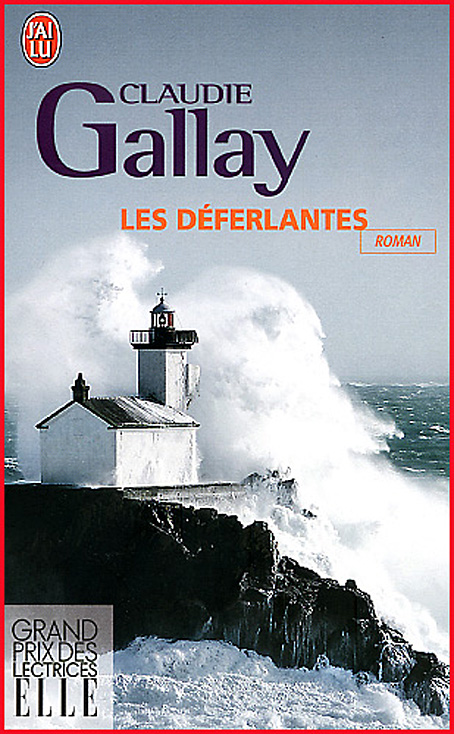




Commentaires récents