Longtemps je me suis accoutumé à Montaigne. Dès la classe de quatrième déjà, où nous étudions ses textes en cours de français, j’aimais son tempérament convivial gascon adepte du quant à soi critique. Certes, comme il le prévoyait en son temps, sa langue est un obstacle, elle n’a pas passé les siècles et le français tend plus du parler du nord que de celui du sud. Mais notre époque permet de lire Montaigne en français d’aujourd’hui – que nul ne s’en prive !
Arlette Jouanna est spécialiste du XVIe siècle français, le siècle des guerres de religion et de Michel Eyquem de Montaigne. Elle brasse d’une vaste érudition les multiples documents, manuscrits, lettres, comptes-rendus « secrets » du Parlement de Bordeaux, témoignages du temps, archives publiques, qui permettent d’établir à peu près la vie du philosophe. Elle récuse certaines idées reçues sur son « scepticisme », son incroyance, ses origines vaguement juives. Montaigne n’est rien de ces étiquettes hâtivement plaquées pour passer à autre chose. L’auteur rappelle p.232 que, si l’Eglise catholique n’a que peu objecté à la parution des Essais, elle a agi de façon toute politique mais d’une effarante niaiserie spirituelle et intellectuelle en mettant à l’Index tout Montaigne de 1676 à 1966 ! Soit un siècle après la parution des Essais – mais pour trois siècles.
Montaigne est un homme, et il prend conscience de soi ; il invite tous ses lecteurs à faire de même. Il n’est pas donneur de leçon ni auteur de maximes à afficher sur les murs de sa chambre mais un accoucheur des âmes comme Socrate qu’il prisait fort. Il veut faire réfléchir, engager le dialogue, inciter à penser par soi-même : « les Essais sont une incitation à converser avec leur auteur » p.353. Lui s’observe et s’observe en son milieu ; il tire des leçons des autres et de lui-même, de ses amis, des puissants dont il dépend, de ses amours, des auteurs des livres qu’il lit. Il a accumulé près de mille volumes dans sa bibliothèque, qu’il appelle encore « librairie » comme les anglais en ont conservé l’usage depuis Guillaume. Principalement des antiques, grecs et romains, mais aussi des contemporains qui font réflexions de théologie ou de politique. Chacun peut garder sa liberté tout en consentant aux conditionnements de sa famille et de son milieu comme à la « longue accoutumance » aux lois, dès lors considérées comme « naturelles » : il suffit d’instaurer une distance critique et de les apprécier en raison. Il est nécessaire, en son logis ou profession, de « se réserver une arrière-boutique toute nôtre, en laquelle nous établissons notre vraie liberté et principale retraite et solitude » p.129.
C’est que l’époque est radicale, la France connait huit guerres civiles successives car déchirée entre catholiques intransigeants allant jusqu’au coup d’Etat par l’assassinat du ministre Coligny puis du roi Henri III, et protestants qui se nomment chrétiens « réformés » et qui veulent la libre expression et la liberté de culte. Mission impossible dans un royaume encore féodal où un peuple requiert un roi, une foi. Montaigne, justement, s’y emploie, partant de la réflexion de son ami La Boétie, trop tôt disparu, que l’obéissance fait le pouvoir, pas l’inverse. Or, qui a des certitudes, religieuses ou politiques, a en même temps le désir irrépressible de les imposer, y compris par la violence. Montaigne prône de passer de l’allégeance à un homme à l’allégeance à un principe supérieur, « la cause générale et juste ». Ce qui reste actuel en politique où une fidélité au « grand homme » (de Gaulle, Mitterrand, Sarkozy, Macron) dérive trop souvent vers le pire au détriment de l’intérêt général.
Pour Montaigne, « Le sage doit au-dedans retirer son âme de la presse, et la tenir en liberté et puissance de juger librement des choses ; mais, quant au dehors, il doit suivre entièrement les façons et les formes reçues » p.13. Car juger en critique ne signifie pas s’opposer à toute force. Contrairement aux néo-platoniciens de son temps (qui subsistent chez nos hégéliens ambiants), Montaigne ne croit pas que l’on change une société par décret ; à l’inverse, les coutumes doivent être limées avec le temps. Le libéralisme français des Lumières sortira tout droit de ce penser-là.
Il est toujours actuel, Montaigne malgré sa langue archaïque : « L’explication vient sans doute de ce que, comme nous aujourd’hui, il a connu des temps incertains, difficiles, marqués par l’ébranlement des croyances, la perte des repères, la remise en cause des structures politiques, la violence des haines partisanes ; comme nous encore, il percevait mal vers quel avenir les risques omniprésents entraînaient son pays » p.16. Il « s’essaie » à y penser et nous convie à faire de même pour notre temps.
Réserve envers les séducteurs politiques et religieux, ouverture à l’étonnement, modération de conduite sont ses principes de vie, bien utiles en temps d’incertitudes. Avec le mouvement, pour ne pas s’enkyster : « j’entreprends seulement de me branler pendant que le branle me plaît » p.214. Rappelons aux vierges effarouchées de garde que branler signifie bouger en français archaïque. D’où les voyages que fit Montaigne en Allemagne, en Italie, à Paris, à Rouen… Comme moi, il en jubile, heureux des découvertes et surprises, toutes matières à réflexion.
« Car l’essentiel est bien là », écrit la biographe : « se mettre au service de la vie et en apprécier toutes les jouissances, tant intellectuelles que corporelles. Sans cette exigence fondamentale, la liberté perdrait tout son sens » p.314. Ce pourquoi Montaigne détaille ce qu’il mange et boit, ce qu’il aime, comment il va à la selle et combien il désire baiser même en âge avancé. C’est que la bonne harmonie du corps, du cœur et de l’esprit est nécessaire à la sagesse car qui ne se conduit pas soi, comment pourrait-il s’offrir en exemple aux autres ?
L’essentiel est de faire fonctionner son esprit comme fonctionne son cœur ou son corps. Il y a une jubilation à baiser ou à goûter des mets, une joie à admirer et à aimer, une exaltation à penser. L’élan est autant dans la réflexion que dans le désir ou la volonté. C’est là réellement vivre et s’éprouver vivant, dans cette « puissance » en acte comme aurait dit Nietzsche. Nul besoin d’accomplir de grands exploits ou des actes mémorables, la vie la plus banale peut devenir un chef-d’œuvre, si elle est en pleine conscience de soi.
Michel de Montaigne s’est éteint le 13 septembre 1592 et cette biographie soignée lui rend un hommage mérité.
Arlette Jouanna, Montaigne, 2017, Biographies NRF Gallimard, 459 pages, €24.50 e-book Kindle €17.99
Montaigne, Les Essais, collection Bouquins Laffont 2019, 1184 pages, préface de Michel Onfray, €32.00

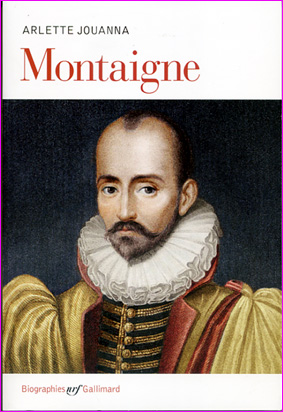






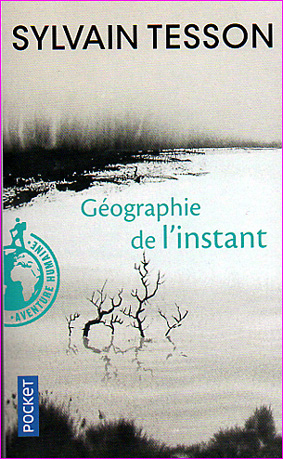




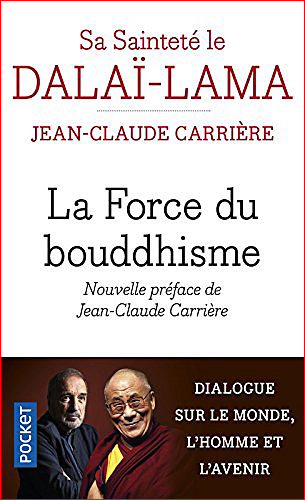

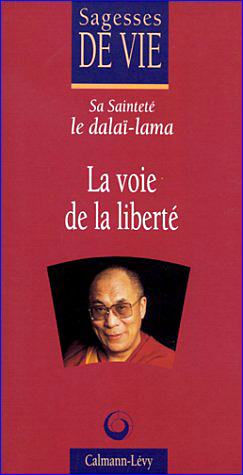
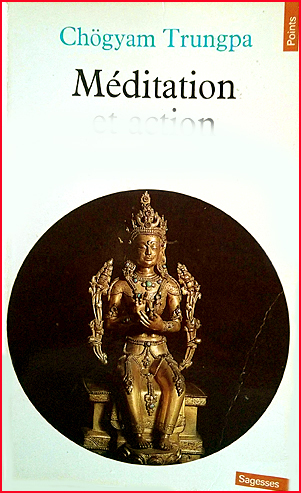
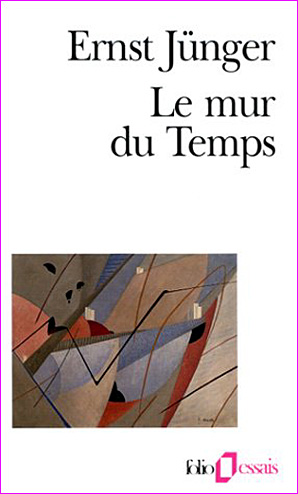











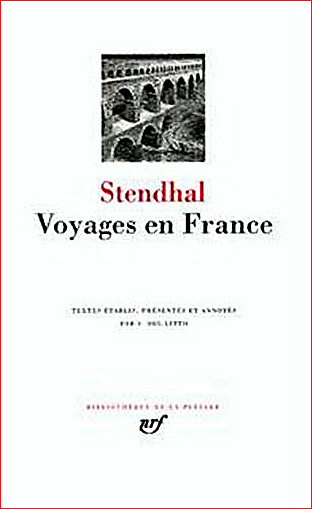

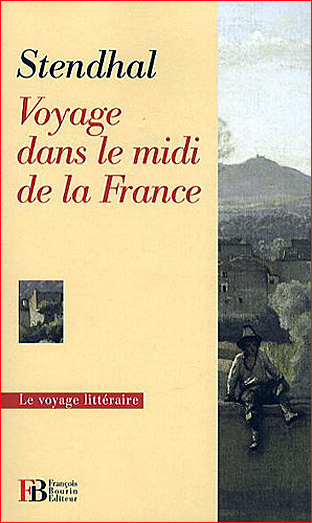
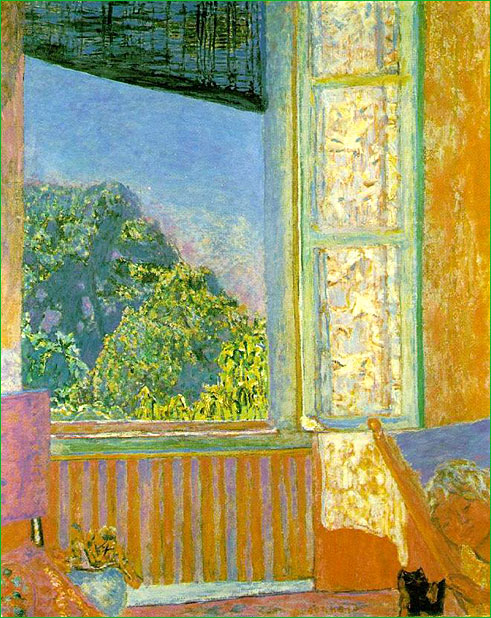


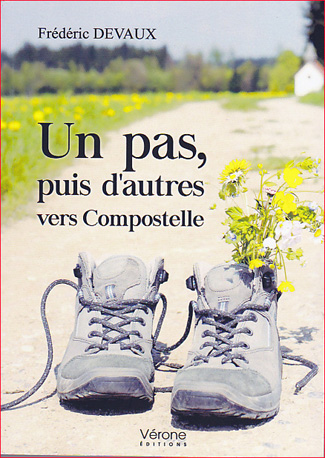



















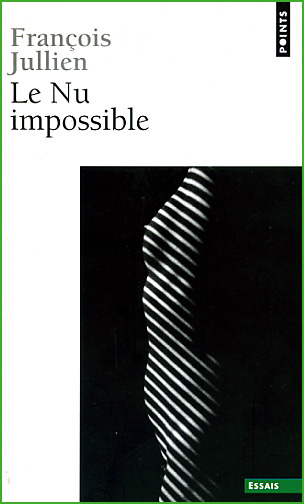




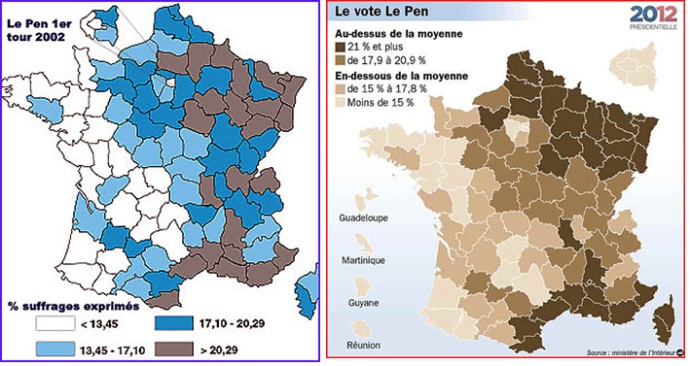





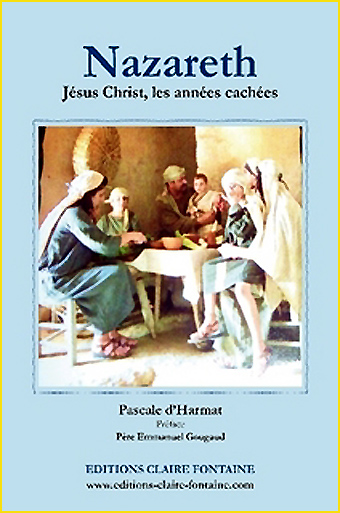










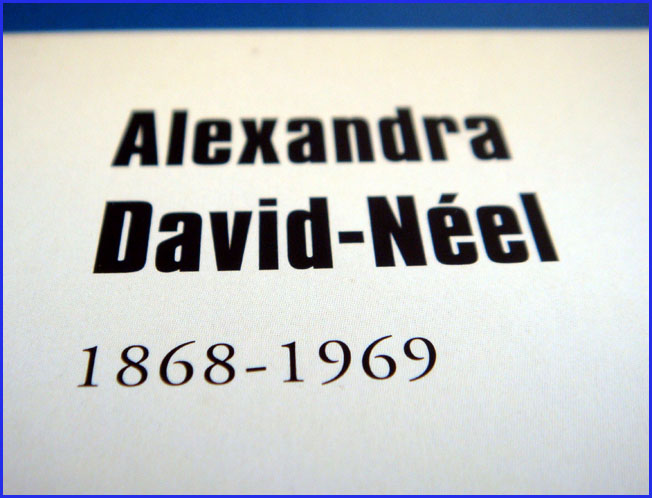
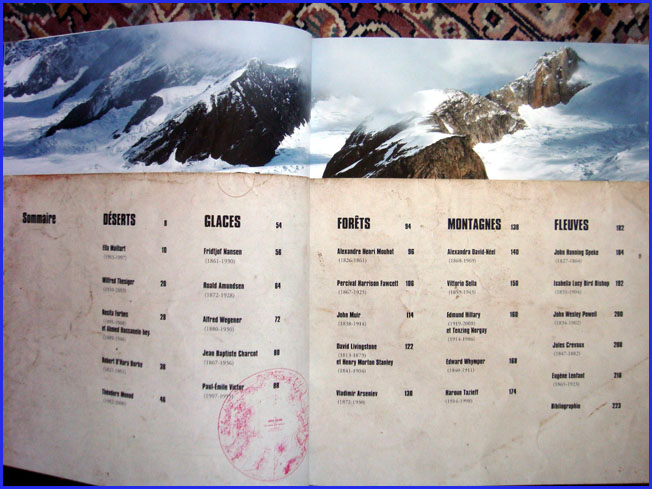

Commentaires récents