
Bernard Bester, dit Lenteric, a écrit de superbes thrillers dans les années 1980 et 90 qui se lisent ou se relisent (c’est mon cas) encore aujourd’hui. Ils sont d’ailleurs toujours édités, en Livre de poche ou en format Kindle. L’étonnant avec cet auteur est qu’il a anticipé l’avenir, cette époque où nous vivons désormais. Il y a 35 ans, peu s’inquiétaient de l’IA, « l’intelligence » artificielle, car les ordinateurs n’étaient pas encore assez puissants et un joueur d’échecs parvenait à les battre. Lenteric, s’en est inquiété. Le socle de ce roman intermédiaire entre le policier et la science-fiction est l’IA.
Cette puissance technologique fait évidemment envie aux maîtres du monde, ces richissimes milliardaires texans du pétrole – qui ont dégorgé du Trump il y a quelques années pour faire coïncider la politique avec leurs intérêts. Et ils sont prêts à recommencer. D’où l’intérêt de ce thriller français d’anticipation aujourd’hui.
Juliette Langston-Bell est jeune, sexy et sans scrupules. Selon l’auteur, elle est « une véritable chienne, qui traverse le monde prête à déchiqueter de ses crocs le moindre obstacle » p.325. Elle a fondé Brain, une entreprise de captation des connaissances des cerveaux les plus aiguisés de la planète. Il s’agit de mettre leur savoir en machine pour créer des systèmes-experts (ancien nom – plus juste – de l’IA). Cela pour la meilleure efficacité économique évidemment, mais qui n’est que le prétexte à amasser encore plus d’argent pour avoir encore plus de puissance. Aller droit au but est louable et économise des ressources en main d’œuvre, en capital et en matières, mais ce capitalisme réel est le masque de la bonne vieille soif de pouvoir, d’argent et de sexe – dans cet ordre.
Tout est permis aux richissimes, puisqu’ils sont capables de tout acheter, y compris les consciences et jusqu’à la loi même. Les compagnies pétrolières ont leur propre police, leurs propres intérêts, leurs propres centres de recherches.
Mais il y a pire : les plus riches et les plus avides de puissance parmi les dirigeants (et les dirigeantes) aspirent à se libérer encore plus de toutes les contraintes. Ils veulent faire ce qu’ils veulent, au mépris des lois, règlements et déontologies des États. Au mépris de l’humain même.
Ce qui commence comme une compétition économique pour obtenir d’un géologue géophysicien expert la mise en machine de son savoir, devient un totalitarisme personnel. Le français Stewart est un séduisant trentenaire grand, fin et musclé, à l’intelligence déconcertante. Juliette est instrumentalisée pour prendre dans ses filets Stewart, mais il résiste. Il préfère lui aussi la liberté. Son entreprise de prospection indépendante est alors attaquée sans merci par un groupe de mercenaires sur ordre des cartels pétroliers ; le matériel est détruit et son adjoint et ami tué. Stewart se résigne donc à accepter la proposition de Juliette, en attendant de se venger.
La réalisation du système-expert avec ses connaissances et son expérience, le savoir-faire du Japonais Ishiguro en informatique prêt à inventer l’ordinateur interactif de 5ème génération, et la cogniticienne Juliette qui servira à l’interface homme-machine, est un travail d’équipe. Mais des intérêts plus puissants sont à l’œuvre. Tous trois sont enlevés par ceux qui tirent les ficelles et veulent les faire travailler pour eux comme des esclaves, dans un centre fermé, isolé de tout au fin fond du Chili. L’impitoyable Juliette, qui a eu la bêtise d’utiliser un radio-téléphone (ni le net ni le smartphone n’existaient en 1991), a été repérée et la famille innocente qui l’hébergeait est massacrée sans merci, enfants compris.
L’utopie de la science conduit à vendre son âme. Le camp de travail pour scientifiques qui veulent s’affranchir des Droits de l’Homme comme de toute déontologie est financé par les cartels… pétroliers – véritable mafia hors des lois et des États. Le professeur Dessambert qui le dirige a d’ailleurs d’autres projets que le minable système-expert pour trouver du pétrole : il veut carrément extraire les cerveaux pour les faire travailler hors corps (comme on dit hors sol) avec l’ordinateur. Il aura ainsi, croit-il, le meilleur du calcul machine avec le meilleur de l’intuition humaine.
On le voit, le transhumanisme des libertariens américains peut aboutir à de tels délires si aucun contre-pouvoir ne le contrecarre. C’est aussi le mérite de Lenteric, en cette fin des années 1980, de montrer tout cru ce mirage des méthodes et des mœurs américaines sur les cerveaux européens colonisés. Les petit-bourgeois arrivés au pouvoir en 1981 avec Mitterrand, qui ont submergé d’un coup l’ancienne génération politique en France, ont épousé cet égoïsme arriviste à un point jusqu’ici jamais connu (d’où les « affaires » multipliées). Le prétexte du « socialisme » a servi de paravent idéologique à cette soif de pouvoir, d’argent et de sexe qui ont déferlé sur la France à ce moment. « Un monde sans autre loi que celle du plus fort. Le plus fort, le plus malin, le plus riche… Le plus riche parce que le plus fort ou le plus malin. Tant pis pour les autres, les faibles, les pusillanimes, les pauvres, les mal nés » p.264. On inventera pour eux le clientélisme d’État, l’assistance sociale payée par la dette…
Le héros qu’est au fond Stewart, le non-américain, le géologue en phase avec la terre, l’homme à qui on ne la fait pas, notamment les femelles trop aguicheuses, se tirera seul de ce bourbier. Avec un gamin désormais orphelin, un cobaye de laboratoire chilien de 10 ans prénommé Jacinto, le nom espagnol de Hyacinthe, l’enfant préféré d’Apollon dont le cri de lamentation « AI » est l’anagramme de l’IA. Le centre de concentration sera détruit par l’un des siens, en répandant une épidémie tirée du génie génétique en laboratoire afin de faire du fric sur le vaccin antidote. Comme quoi Lenteric, une fois de plus, reste en plein dans l’actualité.
Bernard Lenteric, Vol avec effraction douce, 1991, Livre de poche 2002, 382 pages, €6,29 e-book Kindle €6,49
Bernard Lenteric déjà chroniqué sur ce blog





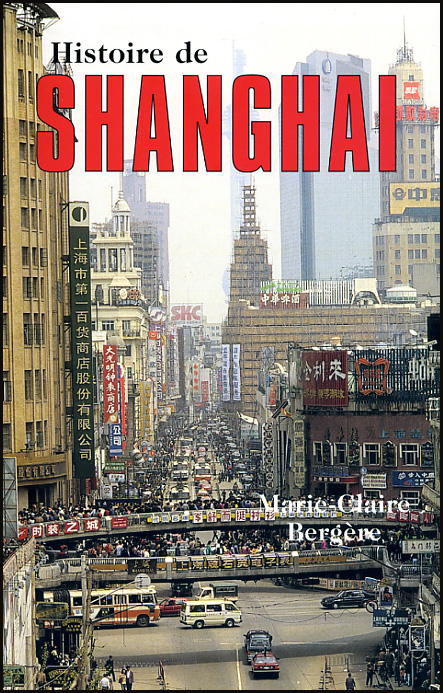
Commentaires récents