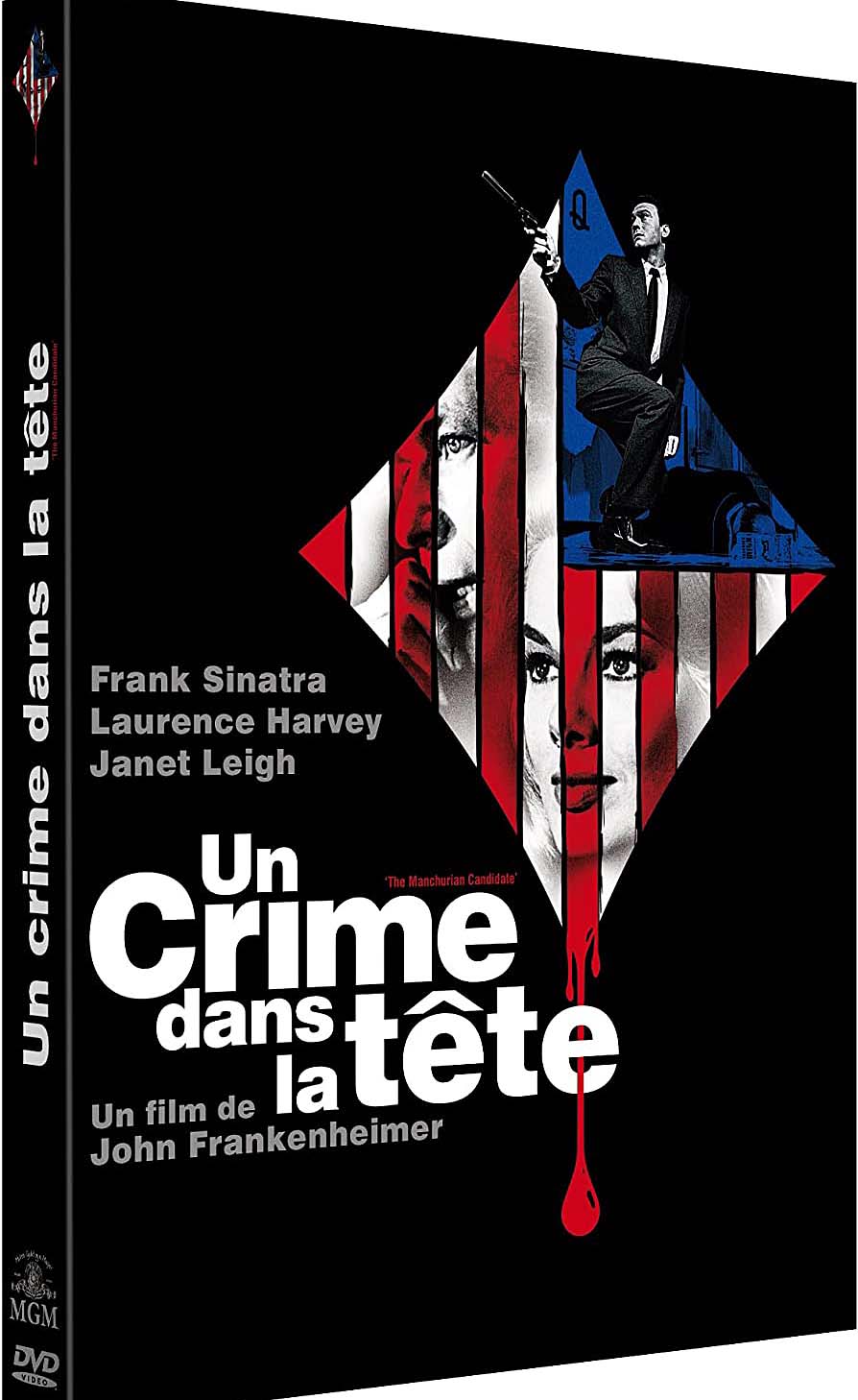
Pas facile d’être un héros… Raymond Shaw (Laurence Harvey) est un sergent de l’armée américaine en Corée en 1952. Il combat les communistes chinois et russes qui voudraient envahir le pays. Sous les ordres de son capitaine de compagnie Bennett Marco (Frank Sinatra), sa patrouille s’avance en reconnaissance vers les lignes ennemies mais, selon l’indigène traducteur qui les conduit, un marécage les empêche de marcher selon la procédure et ils doivent s’avancer en colonne. Ce qui leur est fatal : une compagnie les assomme et les enlève.

Elle ne les tue pas mais les conditionne selon les principes de Pavlov, le savant soviétique du réflexe conditionné. Additionné ici d’hypnose et de pas mal de psychologie sur les névroses (pourtant science juive donc « bourgeoise » selon les sbires moscovites), les soldats sont reconditionnés comme on le dit d’un produit de masse. Leurs cerveaux sont « lavés » et leurs souvenirs réimplantés. Une scène désopilante désoriente un temps le spectateur avant qu’il comprenne : une grosse botaniste chiante parle à une assemblée de bourgeoises emperlousées coiffées de chapeaux à fleurs tandis que le groupe de soldats américains, assis derrière elle s’ennuient à mourir. On ne sait pas ce qu’ils font là mais on ne tarde pas à le comprendre. La grosse est un épais communiste de Moscou, membre du Politburo, qui étale sa science devant un parterre de militaires chinois, coréens du nord, castristes et évidemment soviétiques. Il se vante d’avoir lessivé les cerveaux et d’avoir implanté un programme de tueur dans celui de Raymond Shaw. A titre d’exemple, il lui donne l’ordre d’étrangler l’un de ses hommes qu’il déteste le moins – ce qu’il fait – puis de tirer une balle dans la tête du plus jeune, la mascotte du groupe – ce qui est accompli sans un battement de cil.


Mais pour que l’arme fonctionne, il faut que Shaw rentre aux États-Unis, que ses hommes chantent ses louanges et que son capitaine le propose pour une décoration. Ce qui est fait : chacun se voit implanter son rôle et le groupe resurgit indemne trois jours plus tard dans les rangs américains. Le sergent Shaw est crédité d’avoir sauvé neuf hommes malgré la perte de deux autres au combat. Il est accueilli par plusieurs généraux au garde à vous à sa descente d’avion, puis par le président des États-Unis qui lui remet la médaille d’honneur, plus haute distinction militaire du pays. Sa mère ne manque pas de s’ingérer dans ce succès pour vanter les mérites de son sénateur Iselin de second mari, beau-père de Raymond. Celui-ci, un con fini paranoïaque du style MacCarthy dont le rentre-dedans ressemble au style de Trump, brigue la candidature du parti Républicain aux prochaines présidentielles. Pour cela il dénonce les communistes infiltrés dans l’armée et jusqu’au sénat, citant des chiffres fantaisistes, jamais les mêmes, mais qui font impression. Comme quoi les histrions des fake news à la Donald ne sont pas une nouveauté aux États-Unis, déjà les années soixante les connaissaient bien ; ils étaient même élus !

Le machiavélique de la chose est que tout le monde manipule tout le monde dans ce thriller politique. Le sénateur Iselin (James Gregory) est une marionnette aux mains de sa femme (Angela Lansbury), laquelle se révélera agent de Moscou et manipulée comme telle, et qui manipule elle-même son fils Raymond rentré de guerre, lequel est manipulé par son conditionnement pavlovien mais aussi par son ancien béguin d’avant-guerre, la blonde Jocelyn (Leslie Parrish), fille du sénateur de l’État voisin (John McGiver), qui l’a sauvé en slip d’une morsure de serpent. Le complot est d’assassiner le candidat républicain en pleine convention afin qu’Iselin, second de la liste, soit choisi par défaut et devienne le nouveau président des États-Unis. Il instaurera un pouvoir fort, voire dictatorial (comme Trump a tenté de le faire). Une fois le pouvoir bien assuré, les liens avec Moscou permettront au communisme de l’emporter dans le monde, au moins aux deux Grands de gouverner de concert (ce que Trump a été tenté de faire, si l’on en croit ses liens affairistes avec les poutiniens).

La mère Iselin demande donc à Moscou de lui envoyer un tueur. Elle ne sait pas qu’il s’agit de son propre fils et, lorsqu’elle le découvre, jure de se venger. Mais les soviétiques ont déjà fait assassiner à Shaw son patron, un grand journaliste libéral, puis le sénateur Jordan qui savait des secrets sur Iselin, et sa fille Jocelyn dans la foulée parce qu’elle était accourue. Tout cela sans le savoir, conditionné par une réussite au jeu de carte où la dame de carreau sert de déclencheur et un coup de téléphone lui désigne la cible. Sans dévoiler la fin, lui aussi se vengera, à sa façon.

Mais les gens ne sont pas des machines que l’on programme comme des robots. Même implantés, les souvenirs se superposent aux souvenirs gravés en mémoire, qui restent dans l’inconscient. Il suffit de peu de choses pour les faire ressurgir : un cauchemar où la désinhibition du conscient parle, une scène qui déclenche l’ouverture d’un compartiment fermé de la mémoire, un déconditionnement à base des cartes mêmes. C’est ce que va entreprendre le capitaine Marco, devenu commandant, tourmenté par un cauchemar récurrent où il voit Shaw tuer deux hommes du groupe devant une assemblées de gras communistes. Mis en congé maladie pour malaises et manque de sommeil, il se rend à New York pour voir Shaw et lui en parler. Il se croit l’objet de fantasmes culpabilisants avant de s’apercevoir que le soldat Allen Melvin de sa section revenue des lignes nord-coréennes, qui a écrit à Shaw son héros (implanté), fait le même cauchemar. Il trouve en outre engagé comme domestique chez lui le traître nord-coréen qui a fourvoyé volontairement la patrouille dans les bras de l’ennemi. Pour le commandant, il y a donc anguille sous roche.

Aidé du FBI et de la CIA, il va donc examiner la situation, observer le comportement parfois aberrant de Shaw et tenter de le déprogrammer une fois découvert le pouvoir de la dame de carreau sur son cerveau. Il utilise un vieux truc de magicien : le jeu composé d’une seule carte, rien que des dames de carreau. Raymond Shaw est donc « retourné » dans le bon sens et feindra d’obéir aveuglément aux ordres tout en les accomplissant à sa sauce jusqu’au final.

Un bon thriller en noir et blanc tiré d’un roman de Richard Condon, The Manchurian Candidate, sorti en 1959. Certes, Richard Condon n’est pas Truman Capote mais son histoire se tient, tout à fait dans le style scientiste et paranoïaque de ces années de guerre froide qui culmineront avec la crises des missiles de Cuba, l’assassinat du président Kennedy, puis la guerre du Vietnam. Les services secrets tenteront à l’époque des expériences de manipulation psychologique à base de conditionnement et de drogues, infiltrant des espions qui se feront retourner, parfois en agents triples. Tout cela pour pas grand-chose, tant c’est l’économie qui mène la puissance – ce que prouveront l’effondrement du bloc soviétique et son contre-exemple jusqu’ici réussi : l’essor de la puissance chinoise.
DVD Un crime dans la tête (The Manchurian Candidate), John Frankenheimer, 1962, avec Frank Sinatra, Laurence Harvey, Janet Leigh, Angela Lansbury, Henry Silva, Riminiéditions 2018, 2h01, €7.45 blu-Ray €12.00



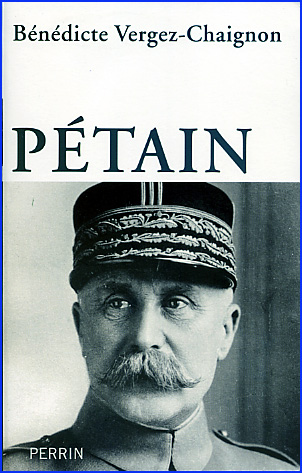
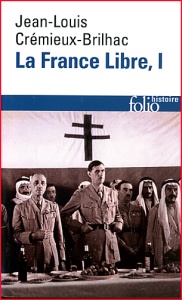











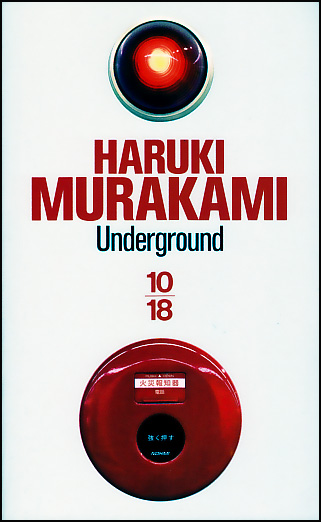





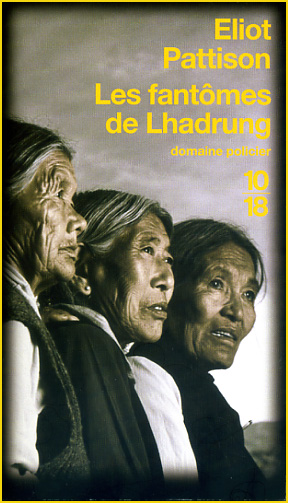










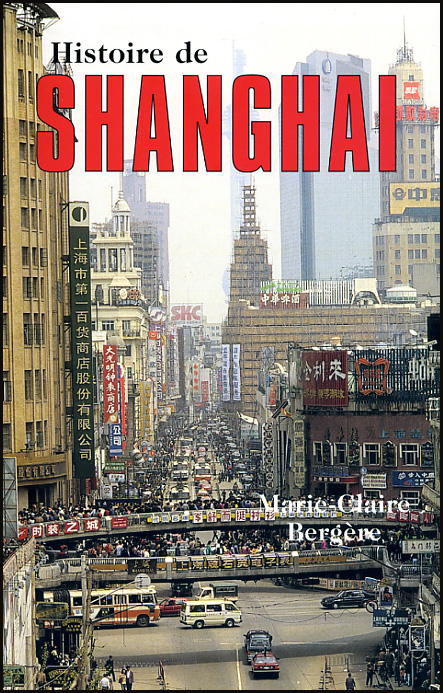















Commentaires récents