Pour Karl Marx, la religion est l’opium du peuple. Raymond Aron se demande, en 1955, quel est l’opium des intellectuels. Sa réponse, à l’époque, est évidente : le marxisme, bien-sûr ! Bien avant le cannabis et l’héroïne des babas cool façon 1968 ou le droitdelhommisme des bobos années 1990. L’opium qui monte aujourd’hui serait-il l’écologisme, mâtiné d’Apocalypse et d’austérité chrétienne monastique ?
Toute ma génération est tombée dans le marxisme étant petit et certains (dont je suis) en ont été immunisés à jamais. D’autres non. Les reconnaissables de cette espèce sont la gauche extrême balançant entre syndicalisme de coups et dictature du prolétariat. Les plus pervers ont inhibé tout changement au parti Socialiste, freinant des quatre fers dès qu’il s’est agi de réformisme mais condamnés à l’impuissance publique et rêvant de finir leur vie en couchant avec la Révolution. Au fond, comme le dit Aron, « dire non à tout, c’est finalement tout accepter » (III,7). Avis aux Gilles et Jeanne qui croient rejouer 1848… et qui accoucheront peut-être de Napoléon avec la bénédiction et les algorithmes de Poutine.
Le marxisme n’est pas la pensée de Marx. Il en est la caricature amplifiée et déformée, tordue par le bismarckisme botté des partis allemands, puis par l’activisme pragmatique de Lénine, enfin par le Parti-Église de Staline qui est resté longtemps le modèle du parti Communiste français avant de se réfugier dans les hautes sphères de l’intellocratie platonicienne à la Badiou. Il faut mesurer combien cette pensée « totale » a pu séduire les petits intellos – et combien elle leur manque aujourd’hui qu’ils sont réduits à faire des ronds sur un point en braillant, sans articuler leurs revendications fiscalo-anarchistes. La pensée communiste avait pour ambition de brasser toute la société, le social expliqué par l’économique, lui-même induisant la politique, donc une philosophie. Raymond Aron écrit : « Marx réalisa la synthèse géniale de la métaphysique hégélienne de l’histoire, de l’interprétation jacobine de la révolution, de la théorie pessimiste de l’économie de marché développée par les auteurs anglais » (Conclusion).
Le marxisme a offert aux laïcs déchristianisés une alternative au christianisme : appliquer les Evangiles dans ce monde en reprenant l’eschatologie biblique sans l’Eglise. Aron : « La société sans classes qui comportera progrès social sans révolution politique ressemble au royaume de mille ans, rêvé par les millénaristes. Le malheur du prolétariat prouve la vocation et le parti communiste devient l’Eglise à laquelle s’opposent les bourgeois-païens qui se refusent à entendre la bonne nouvelle, et les socialistes-juifs qui n’ont pas reconnu la Révolution dont ils avaient eux-mêmes, pendant tant d’années, annoncé l’approche » (III,9). Rares sont les intellos qui ont lu l’œuvre, largement inachevée, contradictoire, publiée par fragments jusque dans les années 1920. La pensée de Marx est complexe, sans cesse en mouvement. Figer « le » marxisme est un contresens. Marx est en premier lieu critique, ce qui ne donne jamais de fin à ses analyses. En faire le gourou d’une nouvelle religion du XXe siècle nie ce qu’il a voulu.
Mais le besoin de croire est aussi fort chez les intellos que chez les primaires. Il suffit que le Dogme soit cohérent, décortiqué en petits comités d’initiés privilégiés, réaffirmé en congrès et utilisable pour manipuler les foules – et voilà que l’intello se sent reconnu, grand prêtre du Savoir, médiateur de l’universel. Dès lors, l’analyse économique dérape dans le Complot (en témoigne le directeur de l’Humanité en faillite qui accuse… les autres et pas son positionnement), les techniques d’efficacité capitalistiques deviennent le Grrrand Kâââpitâââl arrogant et dominateur – d’ailleurs américain, plutôt banquier, et surtout juif (Government Sachs). On en arrive à la Trilatérale, ce club d’initiés Maîtres du monde, dont Israël serait le fer de lance pour dominer le pétrole (arabe) – même les attentats contre le musée juif de Bruxelles seraient l’œuvre du Mossad !…
Toute religion peut délirer en paranoïa via le bouc émissaire. Le marxisme dévoyé en communisme de parti est sorti de la critique pour agir comme une religion. Ce que disait déjà Aron il y a plus de soixante ans : « On fait des Etats-Unis l’incarnation de ce que l’on déteste et l’on concentre ensuite, sur cette réalité symbolique, la haine démesurée que chacun accumule au fond de lui-même en une époque de catastrophes » (III,7). Marx n’est lu que comme une Bible sans exégèse, ses phrases parfois sibyllines faisant l’objet de Commentaires comme le Coran, les intégristes remontant aux seuls écrits de jeunesse qui éclaireraient tout le reste. Sans parler des brouillons Apocryphes et des Ecrits inter-testamentaires d’Engels ou de Lénine. Les gloses sont infinies, au détriment de la pensée critique de Karl Marx lui-même. Raymond Aron : « Les communistes, qui se veulent athées en toute quiétude d’âme, sont animés par une foi : ils ne visent pas seulement à organiser raisonnablement l’exploitation des ressources naturelles et la vie en commun, ils aspirent à la maîtrise sur les forces cosmiques et les sociétés, afin de résoudre le mystère de l’histoire et de détourner de la méditation sur la transcendance une humanité satisfaite d’elle-même » (I,3). L’écologisme, par contagion marxiste de ses prêtres, a parfois ces tendances…
Fort heureusement, la gauche ne se confond pas avec le marxisme ; elle peut utiliser la critique de Marx sans sombrer dans le totalitarisme de Lénine et de ses épigones. Raymond Aron définit la gauche par « trois idées (…) : liberté contre l’arbitraire des pouvoirs et pour la sécurité des personnes ; organisation afin de substituer, à l’ordre spontané de la tradition ou à l’anarchie des initiatives individuelles, un ordre rationnel ; égalité contre les privilèges de la naissance et de la richesse » (I,1). Qui ne souscrirait (sauf des gilets jaunes) ?
Mais il pointe la dérive : « La gauche organisatrice devient plus ou moins autoritaire, parce que les gouvernements libres agissent lentement et sont freinés par la résistance des intérêts ou des préjugés, nationale, sinon nationaliste, parce que seul l’Etat est capable de réaliser son programme, parfois impérialiste, parce que les planificateurs aspirent à disposer d’espaces et de ressources immenses » (I,1). C’est pourquoi « La gauche libérale se dresse contre le socialisme, parce qu’elle ne peut pas ne pas constater le gonflement de l’Etat et le retour à l’arbitraire, cette fois bureaucratique et anonyme. » (I,1) Marx traduit par l’autoritarisme du XXe siècle rejoint volontiers les autres totalitarismes dans le concret des gens. Raymond Aron : « On se demande par instants si le mythe de la Révolution ne rejoint pas finalement le culte fasciste de la violence » (I,2). Ce ne sont pas les ex-Mao mettant qui adulent Castro et Chavez qui nous contrediront – ni les porteurs d’uniformes jaunes minés par les militants lepénistes.
Inutile d’être choqué, Aron précise plus loin : « L’idolâtre de l’histoire, assuré d’agir en vue du seul avenir qui vaille, ne voit et ne veut voir dans l’autre qu’un ennemi à éliminer, méprisable en tant que tel, incapable de vouloir le bien ou de le reconnaître » (II,6). Qui est croyant, quelle que soit sa religion, est persuadé détenir la seule Vérité. Ceux qui doutent ou qui contestent sont donc des ignorants, des déviants, des malades. On peut les rééduquer, on doit les empêcher de nuire, voir les haïr et les éliminer. L’Inquisition ne fut pas le triste privilège du seul catholicisme espagnol et les excommunications frappent toujours à gauche, comme chez les écolos quand on ose mettre en doute la doxa climatique, ou chez les gilets qui haïssent tous ceux qui parlent mieux et plus fort que les leurs…
Certes, ce pavé Aron de 1955 en trois parties (1/ mythes politiques de la gauche, de la révolution et du prolétariat ; 2/ Idolâtrie de l’histoire et 3/ Aliénation des intellectuels) évoque des questions désormais passées, celles d’une époque portée au fanatisme après la lutte contre le nazisme. Mais l’analyse rigoureuse et sensée résiste à la ringardise. La méthode est applicable aujourd’hui : la sociologie des intellos demeure plus que jamais et la critique de la croyance est éternelle.
Raymond Aron, L’opium des intellectuels, 1955, Fayard Pluriel 2010, 352 pages, €10.20 e-book Kindle €10.99


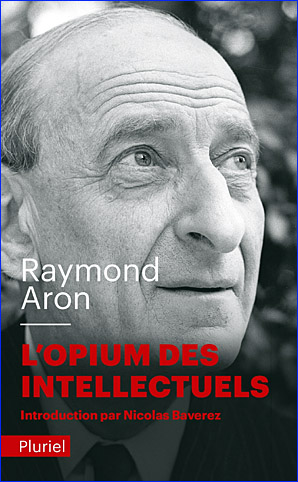
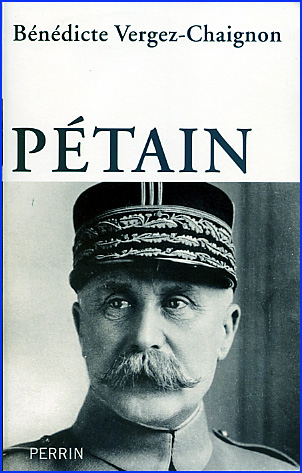



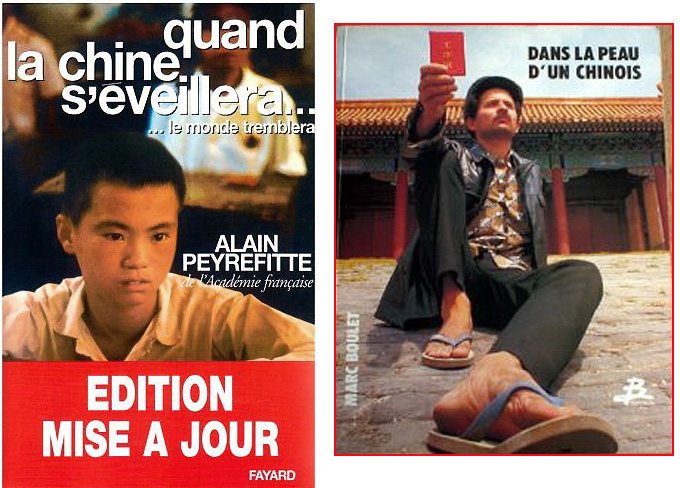






Commentaires récents