
Nell est une jeune femme belle et intelligente, comme il se doit pour les lectrices de MHC. Elle est orpheline depuis que ses parents sont morts dans un accident de voiture mais a été élevée par son grand-père, député de New York durant cinquante ans sans interruption. Bien que n’ayant pas besoin de travailler Nell écrit des chroniques dans un grand journal de la côte est. Elle s’est mariée très vite à Adam, un architecte bien fait de sa personne et avec un sourire irrésistible, comme il se doit pour les lectrices de MHC.
Mais voilà… Si tout commence dans le rose, le noir surgit brutalement. Sur les incitations pressantes de son grand-père, Nell va se décider à briguer le poste de député que celui-ci a lâché ; elle sera soutenue par le parti. Mais pas par son mari, Adam a en effet une étrange réticence à laisser aller sa femme aux élections. Les médias vont naturellement enquêter et scruter les moindres détails de la vie de Nell et d’Adam : y aurait-il une quelconque tache à dissimuler ? Ou n’est-ce que le souci bien légitime d’un mari qui ne veut pas que son épouse soit accaparée par la politique au point d’en oublier le foyer, et les éventuels enfants qu’ils voulaient ?
Une fois le décor planté, les personnages campés, la question principale posée, l’histoire peut commencer. Mary Higgings Clark a du métier et compose méthodiquement ses intrigues. Ses chapitres sont découpés comme dans les séries télé, prenant chaque personnage à un moment et faisant avancer l’histoire par ses facettes individuelles. Il y a Nell, Adam, le grand-père Mac, la grand-tante Gert férue de parapsychologie, la médium Bonnie, Jimmy le chef de chantier et son épouse Lisa, Jed Kaplan et sa mère qui a vendu un vieil immeuble sans l’en avertir, Lang le banquier qui finance la promotion du terrain, un petit garçon et son père. On peut se perdre au début dans les personnages, mais c’est la rançon de celles ou ceux qui ne lisent que trois pages à la fois. Les autres suivront le fil sans problème, vite captivés par les différents caractères.
Jed est aigri de voir le vieil immeuble inhabité en plein New York que sa mère possédait vendu par elle pour une bouchée de pain – son héritage – sans son avis ; mais Jed était parti en Australie pour échapper à une accusation de trafic de drogue et il en est revenu parce qu’il a replongé là-bas. Adam possède désormais l’immeuble, attenant à la parcelle de terrain que Lang a acquis pour en faire un centre commercial, résidentiel et de bureaux, avec une grande tour d’architecte. Adam veut donc négocier la vente de son terrain contre l’architecture du projet, ce qui lui permettra de se lancer en grand. Mais il semble que Lang ait d’autres vues…
La réunion convoquée par Adam sur son yacht ancré dans le port de New York, son seul luxe, doit réunir Lang, le constructeur Sam, le chef de chantier Jimmy, Winifred la secrète secrétaire d’Adam bien au fait des pratiques de l’immobilier, et lui-même. Mais Lang prévient au dernier moment qu’il ne pourra pas venir, il a embouti un camion avec sa voiture et doit aller à l’hôpital. Lorsque le bateau quitte le quai, il explose. Aucun survivant, deux corps déchiquetés repêchés, deux disparus : Adam et Winifred. Mais le sac à main de la secrétaire récupéré, à peine roussi. Dedans, une petite clé de coffre bancaire, sans indication.
Nell est effondrée, elle s’était disputée avec son mari juste avant qu’il ne parte, ayant oublié sa mallette et son blazer, que sa secrétaire est venue chercher sur sa demande peu après. Sauf que ce n’est pas le bon blazer, il y en avait deux identiques. L’enquête commence. Les suspects : Jed qui en voulait à Adam, Lang qui voulait ce terrain mais pas l’architecte, Jimmy peut-être, longtemps au chômage et pas très clair depuis. Ou d’autres. D’autant qu’un petit garçon de 8 ans, de retour d’une visite à la statue de la Liberté, a vu le bateau exploser et, comme il est hypermétrope, a distingué nettement « un serpent » qui plongeait en même temps dans les flots. Il fait des cauchemars depuis et sa mère l’emmène voir une psychologue qui le fait dessiner. Et « le serpent » s’affine au fil de la mémoire. Les flics sont très intéressés de savoir ce qu’il est vraiment.
Sa grand-tante Gert persuade Nell d’aller voir la médium, qui a reçu un message confus d’Adam depuis l’au-delà. Mac est sceptique mais Nell réceptive, ayant connu une expérience de ce genre avec sa grand-mère lorsqu’elle est morte (une caresse dans la nuit) et avec ses parents lorsqu’elle était prise dans un contre-courant marin et a manqué de se noyer. En fait, Nell est une fausse sceptique, sa raison doute mais elle veut y croire. Elle se sent coupable de s’être disputée avec Adam avant sa disparition et veut connaître la vérité – pour elle-même et pour sa carrière. En bonne Yankee s’adressant à des Yankees, MHC n’oublie jamais l’égoïsme fonceur de ses personnages fétiches. Et Bonnie la bluffe ; « Adam » depuis l’au-delà conseille à Nell de se méfier de Lang.
Mais que veut Lang ? Qui est Bonnie ? Et qui était vraiment Adam ? D’où vient l’argent de la fidèle Winifred, qui lui permet de financer une maison de retraite chère à sa vieille mère acariâtre ? Et pourquoi est-elle allée la voir religieusement tous les jeudis soir ? Nell va enquêter, aidée de Mac, Bonnie va la troubler, la mère de Winifred lui inoculer des doutes. Et puis… le drame évidemment. Mais Nell trouvera l’amour à nouveau en la personne d’un médecin pédiatre, orphelin comme elle, qui recherche sa mère devenue SDF.
Une intrigue convenue, dans les normes exigées des lectrices de MHC, mais qui est bien composée et au suspense soigneusement découpé. Bien qu’évoluant dans les milieux huppés de New York – sa ville, son milieu – ce qui peut agacer par moment, on ne s’ennuie pas. Un bon cru de vacances que j’ai relu avec plaisir.
Mary Higgings Clark, Avant de te dire adieu (Before I say Goodby), 2000, Livre de poche 2001, 439 pages, €9,20, e-book Kindle €7,99












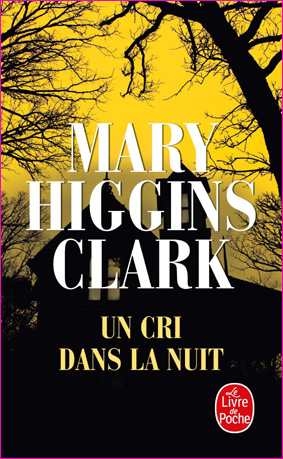

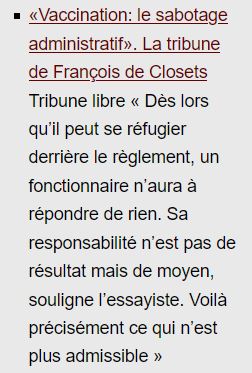








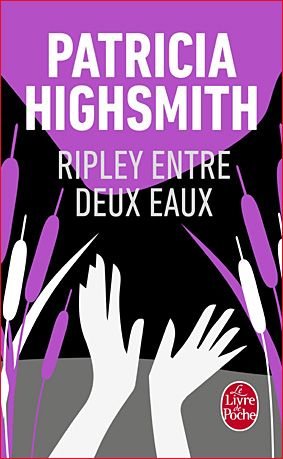
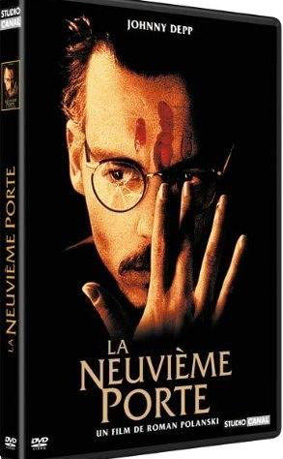
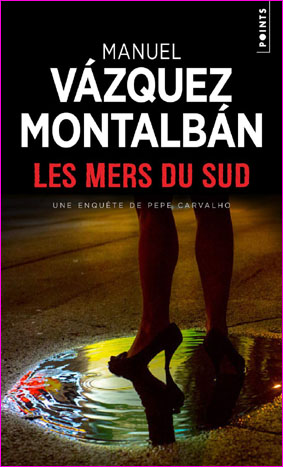






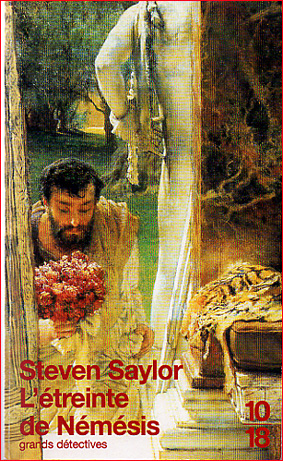

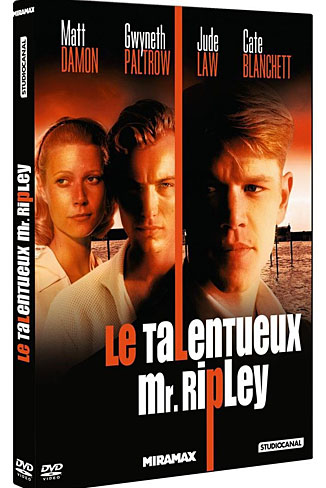





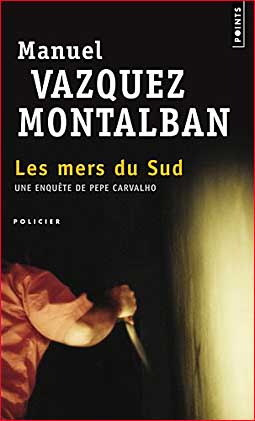
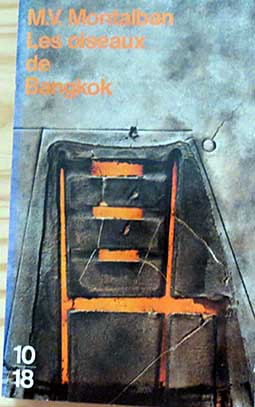
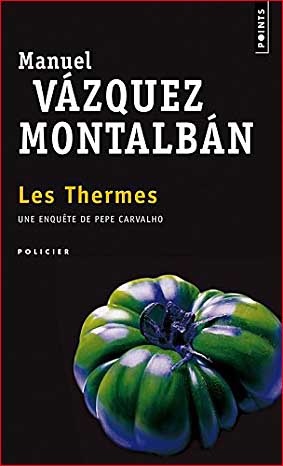
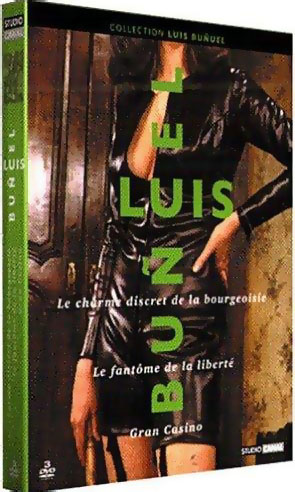





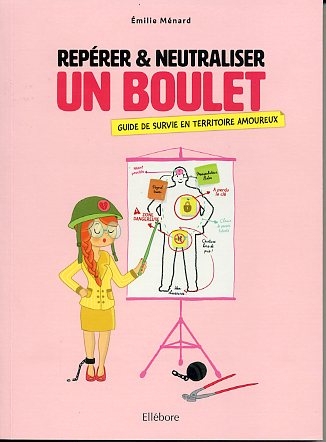





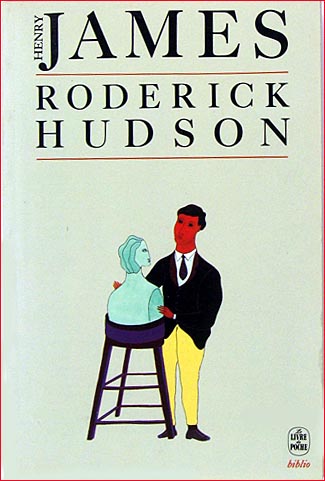






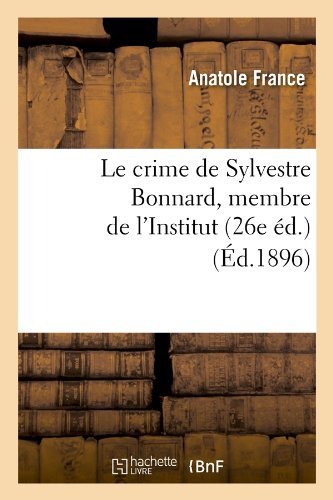








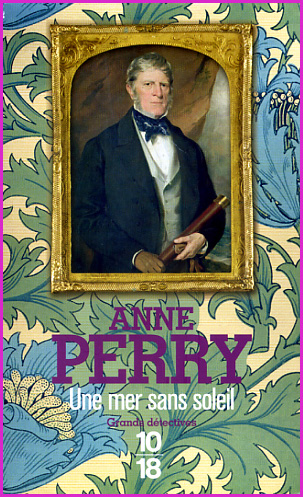
Commentaires récents