
L’amour, la mort, la quête éperdue de vérité, l’absolu du romantisme – voilà un beau roman (comme on n’en fait plus) qui utilise la matière historique pour évoquer l’essentiel. La guerre de 14, vraiment la plus con, « commémorée » comme un moment national par le moins bon des présidents de la Ve République, a été déclenchée par vanité et entretenue par bêtise. Elle a soumis des hommes quatre ans durant à la merde des tranchées, sans avancer ni reculer, se faisant hacher de façon industrielle par les obus ou par les offensives ratées de généraux. Quoi d’étonnant à ce que « le peuple », qui se révolte déjà pour une hausse du prix de l’essence ou l’allongement progressif de l’âge de la retraite, se soit mutiné ?
Car tout commence par l’histoire de cinq soldats qui se tirent ou se font tirer par les Boches une balle dans la main. Blessés, ils seraient envoyés hors du front ; sans la main, incapables de tirer. Sauf que cela ne se passe pas comme ça à l’armée. Pétain est généralissime et décide de faire un exemple. Les soldats doivent être fusillés pour désertion devant l’ennemi, et son ordre est de les jeter attachés entre les lignes pour qu’ils y crèvent lentement, pris entre deux feux, et même trois si l’on compte déjà les avions. Que Pétain soit une ordure, on le savait déjà, mais ce roman révèle un fait vrai de la Grande guerre : le « héros » de Verdun était un minable sadique.
Les cinq hommes jetés aux Boches ne sont pas des lâches et ont fait preuve de courage mais les badernes qui les gouvernent, de Pétain au caporal prévôt, en font des boucs émissaires. Ils sont des traîtres absolus parce qu’ils ont eu un moment de faiblesse, parce qu’ils n’ont pas voulu se planquer comme les autres, ou en faire le minimum comme beaucoup. Pétain ordonne, le tribunal militaire condamne, le président de la République gracie, le commandant du régiment garde sous le coude la grâce durant un jour et demi par vengeance mesquine envers son capitaine de secteur, le caporal chargé de lâcher les hommes entravés dans le no man’s land du secteur surnommé Bingo crépuscule (le lecteur saura pourquoi ce nom bizarre) descend d’une balle dans la nuque celui qui gueule le plus. Français contre Français, à vous dégoûter d’être Français.
Kléber dit l’Eskimo parce qu’il a vécu dans le Grand nord est menuisier ; son ami Benjamin dit Biscotte est très habile de ses mains à travailler le bois et ne peut avoir d’enfant, il a adopté les quatre de sa compagne devenue veuve ; Francis dit Six-Sous (franc x six) est soudeur et communiste idéaliste ; Benoît dit Cet-homme parce qu’il ne dit pas son nom est un enfant trouvé, paysan de Dordogne, aimant une femme dont il a eu un enfant, Baptistin dit Titou ; Ange dit Droit commun est un proxénète de Marseille condamné à la prison pour avoir tué un rival, tombé amoureux à 13 ans de Tina qui en avait 12, laquelle se prostitue et ferait tout pour lui. Tous ont la trentaine. Seul le cinquième des condamnés n’a que 19 ans. Il s’agit de Manech (Jean en basque, qui s’écrit Manex) dit le Bleuet parce qu’il est de la classe 17, la plus jeune. Il est intrépide et généreux jusqu’à ce qu’un copain lui explose en pleine gueule à cause d’un obus. Il en est couvert, il est terrorisé et aura désormais peur de toute explosion. Il est fiancé à Mathilde, tombé amoureux à 14 ans d’une fille de 11 ans handicapée des jambes et à qui il a appris tout nu à nager.
Laissés pour compte liés et sans armes devant l’ennemi, le sort des cinq est vite scellé. Si la tranchée d’en face, outrée de ce traitement, ne tire pas de suite et attend des ordres de l’arrière, c’est un avion allemand qui passe et les mitraille (avant d’être descendu à la grenade par l’un d’eux, qui a trouvé l’engin entre les lignes). L’un sera tué par un caporal français, dans la nuque par « le coup du boucher », les autres par les obus de la bataille qui reprend. La relève survient le jour d’après par des Canadiens ; ils voient trois corps, relèvent les plaques d’identité et enterrent sommairement les cadavres en attendant. Les cinq hommes sont réputés « tués à l’ennemi » et l’administration militaire avise les familles par lettre.
Mais deux ne veulent pas le croire : Tina qui connaît son Ange et a correspondu avec lui par lettres codées ; et Mathilde, enferrée dans son déni et qui, d’une famille riche des Landes, fera tout pour retrouver la piste des derniers moments et de leur suite. C’est cette enquête passionnante qui passionne, le roman est pour cela bien monté. Tina veut se venger des bourreaux qui ont jeté son homme et va les descendre un par un jusqu’au dernier ; elle ne passe pas par « la justice » mais on la comprend, elle sera rattrapée par ses actes mais gardera la tête haute d’Antigone face à Créon. Mathilde qui peint des fleurs d’espoir et expose prend des notes qu’elle garde avec les lettres dans un coffret. Elle écrit, passe une annonce dans les journaux de Poilus et dans L’Illustration, se renseigne auprès des militaires via l’avocat de son père qui connaît quelqu’un qui…, engage un détective privé, Germain Pire dont l’entreprise s’appelle Pire que la fouine. De fil en aiguille, de renseignements épars en pistes recoupées, elle découvrira la vérité. Une histoire de bottes est révélatrice, un caporal parlera de deux blessés venus du secteur au poste sanitaire, mais il ne faut pas en dire plus.
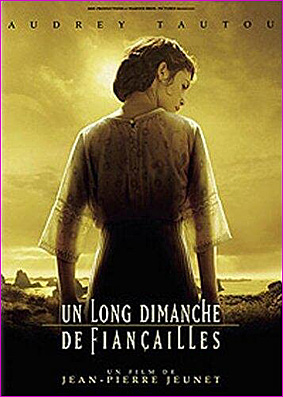
C’est une histoire d’amour entre adolescents devenus adultes par la guerre, mais les personnages secondaires sont tout aussi attachants : le sergent Esperanza qui a eu ordre malgré lui de convoyer les condamnés au secteur désigné et qui renseignera Mathilde sur les derniers moments avant de crever de la grippe espagnole ; l’orphelin Célestin Poux, dit la Terreur des armées par sa débrouille et son sens du « rab » qui racontera ce qu’il a vu et entendu sur place et alentour car il bougeait beaucoup ; le capitaine Favourier, chef du secteur, qui avait en horreur cette mission et traitait son colonel de vrai con qui se défile ; Sylvain qui assiste Mathilde dans sa villa de Cap-Breton (dans les Landes) et la conduit sur les lieux qu’elle veut voir ; Pierre-Marie Rouvière l’avocat admiratif de l’obstination et de la précision de Mathilde.
Malgré la guerre, l’amour surnage et se révèle le plus fort. Pas besoin d’en dire plus. Un film avec Audrey Tautou en Mathilde et Gaspard Ulliel en Manech a été tiré du livre, en modifiant certains lieux et le déroulement de l’histoire ; il peut être vu en complément mais le livre est premier, le plus prenant.
Prix Interallié 1991
Sébastien Japrisot, Un long dimanche de fiançailles, 1991, Folio 19993, 375 pages, €9,20, e-book Kindle €8,99
DVD Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet, 2004, avec Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, Tchéky Karyo, Chantal Neuwirth, Dominique Bettenfeld, Clovis Cornillac, Warner Bros 2005, 2h08, €7,67




























































































































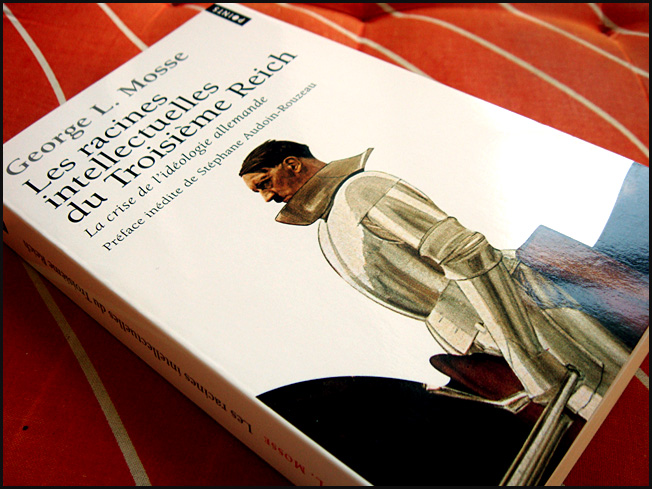

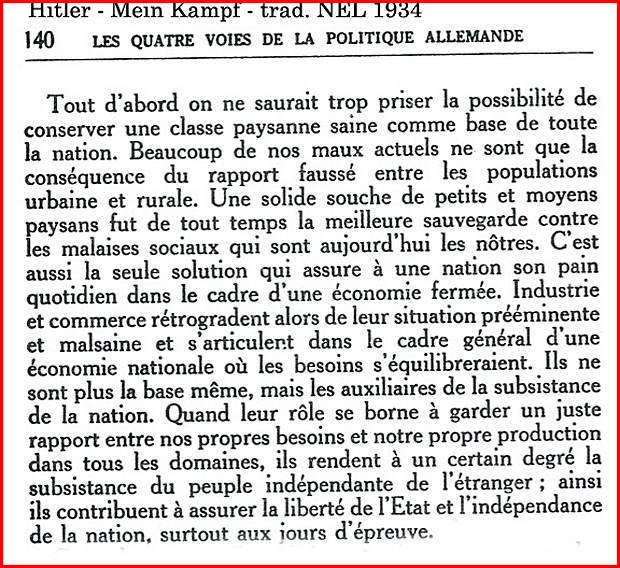
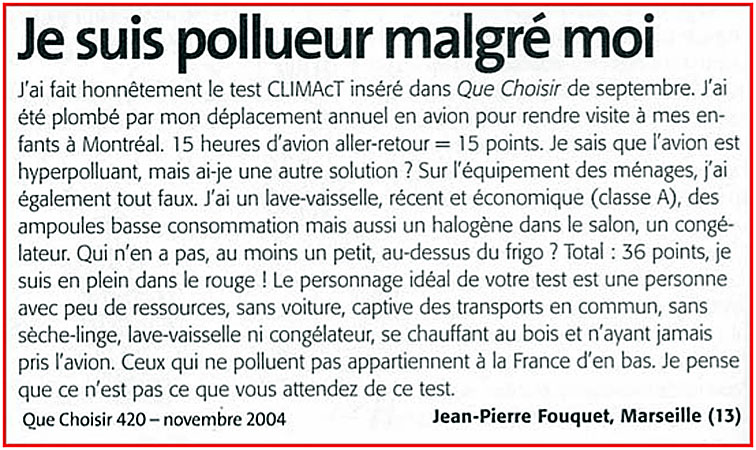

Commentaires récents