Pour Roland Barthes, en cette année 1970 où l’Occident est probablement au sommet de sa puissance avant les différentes crises du pétrole, le Japon n’est pas un pays à décrire mais une situation d’écriture. Il est miroir de soi pour révéler notre image, pas un sens pour le Japon.
Il s’agit d’ébranler sa personne pour renverser d’anciennes lectures, d’opérer une secousse du sens comme un événement zen qui fait vaciller la connaissance et opère un vide de parole. « L’Orient m’est indifférent, il fournit simplement une réserve de traits dont la mise en batterie, le jeu inventé, me permettent de flatter l’idée d’un système symbolique inouï, entièrement dépris du nôtre » p.7. Il s’agit de se regarder, mais depuis l’ailleurs.
En langue japonaise, la prolifération des suffixes fonctionnels, la complexité des termes joints, font que le sujet avance au travers de précautions, de reprises et d’insistances qui diluent la personne. Barthes met en rapport la langue et l’architecture des villes : au Japon le centre est vide, évaporé, interdit ou indifférent. C’est la gare, le palais de l’empereur, la cité interdite. Quant au corps japonais, il existe, se déploie, agit, se donne, mais sans hystérie ni narcissisme comme en Occident. Ce n’est pas la voix seulement qui communique, « c’est tout le corps (les yeux, le sourire, la mèche, le geste, le vêtement) qui entretient avec vous une sorte de babil auquel la parfaite domination des codes ôte tout caractère régressif infantile » p.18. Pas de centre mais un champ de forces, pas de « je » mais un « on ». Les Occidentaux donnent des signes d’assurance gonflée ; les Japonais font des signes de simple façon de passer. L’indifférence et l’indépendance du geste ne renvoient pas à l’affirmation du moi mais seulement à un mode graphique d’exister.
Le repas est un cadre (plateau) où les objets sont une composition picturale, un ordre vivant, destinés à être défaits et refaits selon le rythme de l’alimentation, à la façon d’un graphiste installé devant un jeu de godets. Cuisiner est un jeu qui porte non sur la transformation de la matière première, en général peu cuisinée, mais sur son assemblage mouvant et décoratif. La nourriture semble s’épanouir dans la division : les aliments sont coupés pour les baguettes. L’usage de ces instruments introduit une fantaisie dans la façon de manger, un choix non mécanique. Plus que la fourchette ou le couteau en métal, la baguette est en bois, en laque ou en os, adoucissant le comportement envers la nourriture. Pas une arme qui tranche ou pique mais une pince qui saisit comme les doigts sans brusquer, une habileté douce qui ne violente jamais ce qui se trouve dans l’assiette et retrouve les fissures naturelles de la matière à fragmenter. La nourriture n’est donc pas une proie comme en Occident mais une harmonie, pas une lutte mais un transfert. « La crudité est la divinité tutélaire de la nourriture japonaise » p.30. La cuisine japonaise se fait toujours devant celui qui va manger et la crudité est essentiellement visuelle, renvoyant à la matière et à son toucher sensuel.
Le pachinko, jeu de billes où tout est déterminé par le coup d’envoi, reproduit dans l’ordre mécanique le principe même de la peinture japonaise qui veut que le trait soit tracé d’un seul mouvement sans être corrigé, comme une expression de l’humain tout entier, âme, cœur et corps d’un seul élan.
Si les choses paraissent petites au Japon c’est parce que tout est encadré, non pas par netteté puritaine mais par « supplément hallucinatoire ». Le contour n’est pas fortement tracé mais un espace vide qui rend la chose mate donc, à nos yeux, réduite. Les chambres ont des limites (nattes, lattes, montants) mais les murs glissent, les parois sont fragiles, les meubles escamotables. Le bouquet de fleurs est construit mais pour la circulation de l’air, le volume.
Le bunraku, théâtre de marionnettes japonais, débarrasse de l’acteur. Il ne vise pas à animer une poupée, il est abstraction sensible du corps. Il refuse l’antinomie entre l’animé et l’inanimé, il congédie le concept qui se cache derrière toute animation de la matière et qui suggère l’âme. Avec le bunraku, les sources du théâtre sont exposées dans leur vie même. La parole est mise de côté, l’émotion n’inonde plus la scène, la représentation est soustraite à la contagion de la voix et du geste. Ce qui est mis à la place de la théâtralisation est l’action nécessaire à la production de spectacles, le travail se substitue à l’intériorité. « Il abolit le lieu métaphysique que l’Occident ne peut s’empêcher d’établir entre l’âme et le corps, la cause et l’effet, le moteur et la machine, l’agent et l’acteur, le destin et l’homme, Dieu et la créature : si le manipulateur n’est pas caché, pourquoi, comment voulez en faire un Dieu ? » p.82.
La poésie du haïku suspend le langage, il ne le provoque pas. Le fait se contente d’être là, sans commentaires. « Tout en étant intelligible, le haïku ne veut rien dire, et c’est par cette double condition qu’il semble offert au sens, d’une façon particulièrement disponible, serviable » p.89. Comme la politesse, la forme est vide. Le zen tout entier mène la guerre contre le sens. « Tout le zen, dont le haïkaï n’est que la branche littéraire, apparaît comme une immense pratique destinée à arrêter le langage, à cesser cette sorte de radiophonie intérieure qui émet continuellement en nous » p.97. Si cet état de non langage est une libération c’est que, pour l’expérience bouddhiste, la prolifération des pensées secondes, le bavardage infini des signifiés, apparaissent comme un blocage. Il s’agit d’arrêter la toupie verbale qu’est le symbole et le jeu obsessionnel des substitutions symboliques. Le langage limité du haïku n’est pas pour être concis mais pour agir sur la racine même du sens, pour obtenir que le sens ne devienne pas implicite et ne divague pas dans l’infini des métaphores. « La brièveté du haïku n’est pas formelle ; le haïku n’est pas une pensée riche réduite à une forme brève, mais un événement bref qui trouve d’un coup sa forme juste » p.98. Il est pur comme une note de musique. Il se dit deux fois. La première fois, ce serait attacher un sens à la surprise, plusieurs fois que le sens est à découvrir. Le haïku ne décrit jamais, tout état de la chose est converti en une essence d’apparition. Il est un « réveil devant le fait », une « saisie de la chose comme événement, non comme substance » p.101.
« En Occident, le miroir est un objet essentiellement narcissique : l’homme ne pense le miroir que pour s’y regarder ; mais en Orient, semble-t-il, le miroir est vide ; il est symbole même des symboles (…). Le miroir ne capte que d’autres miroirs, et cette réflexion infinie elle le vide même (qui, on le sait, est la forme) » 104.
Malgré un langage issu de la linguistique et du snobisme des néo-universitaires des années 1970, le livre dit en peu de mots beaucoup sur le Japon. Non sur le pays réel mais sur les préjugés que l’on peut en avoir au miroir de nous-mêmes. Il reste d’actualité pour mieux saisir l’essence de ce pays, qui est resté longtemps le seul pays développé non-occidental.
Roland Barthes, L’empire des signes, 1970, Points essais 2014, 176 pages, €9.00

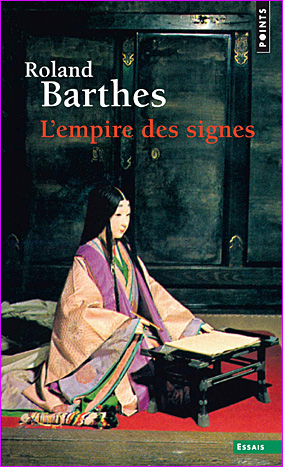


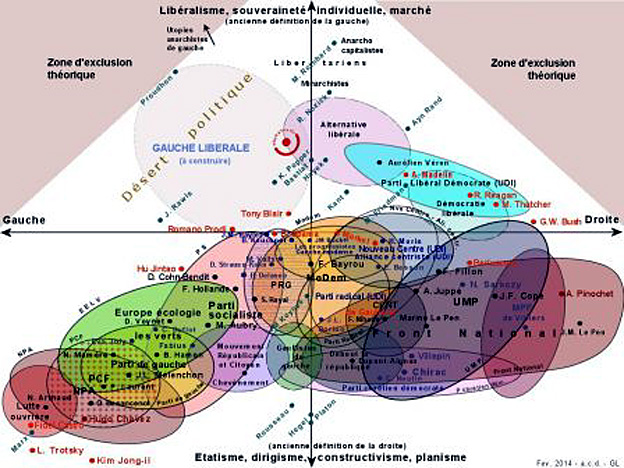





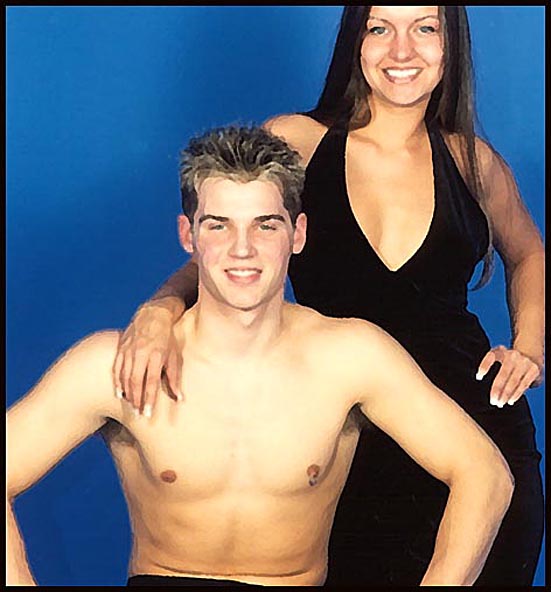

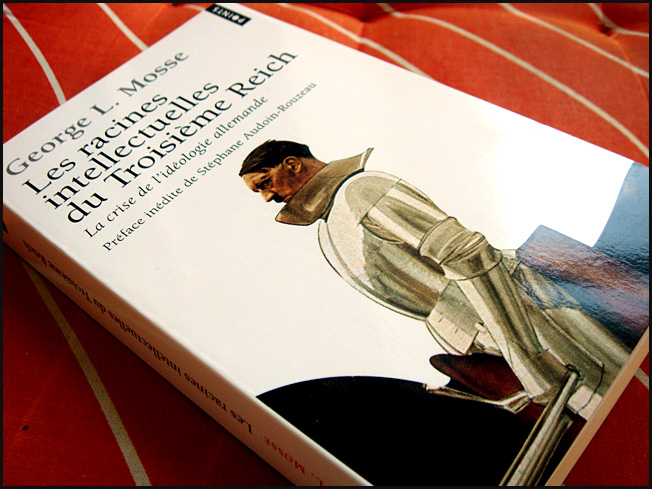

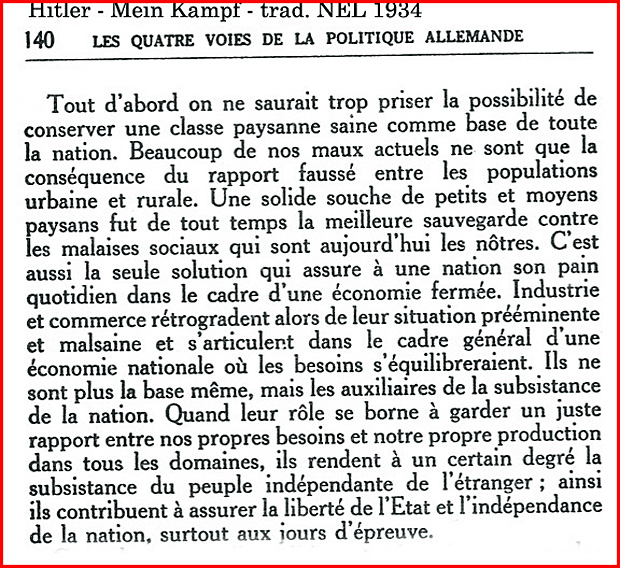
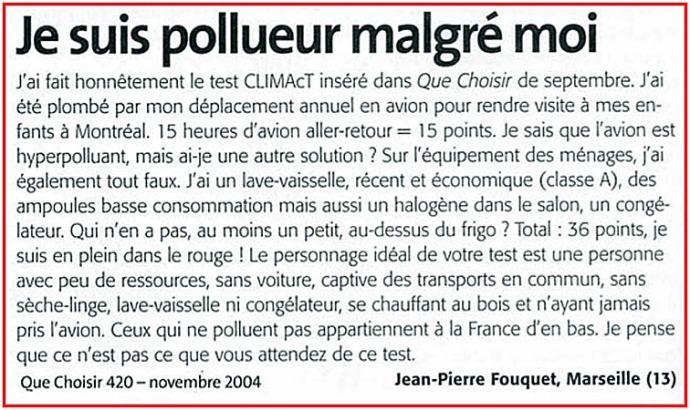

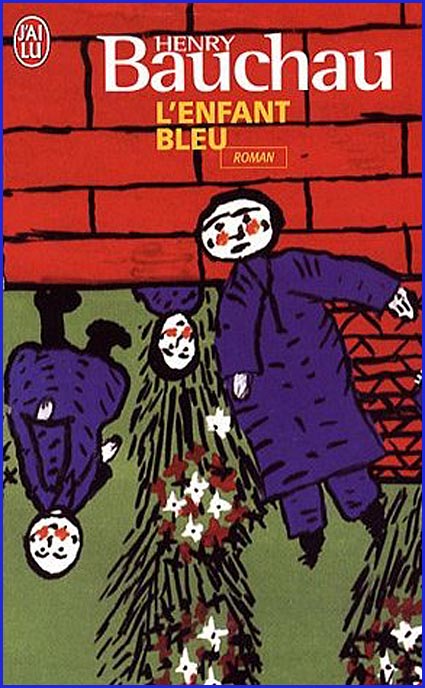
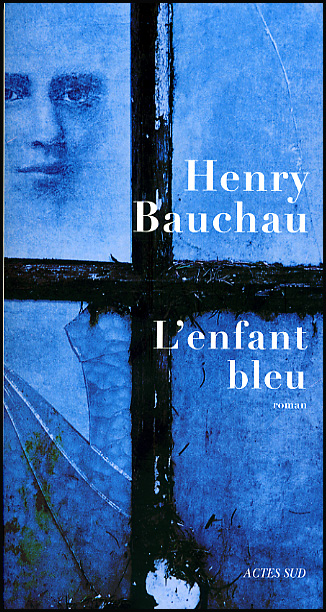
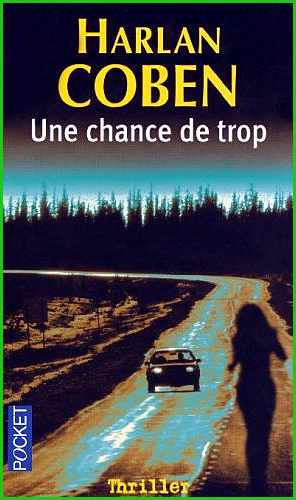


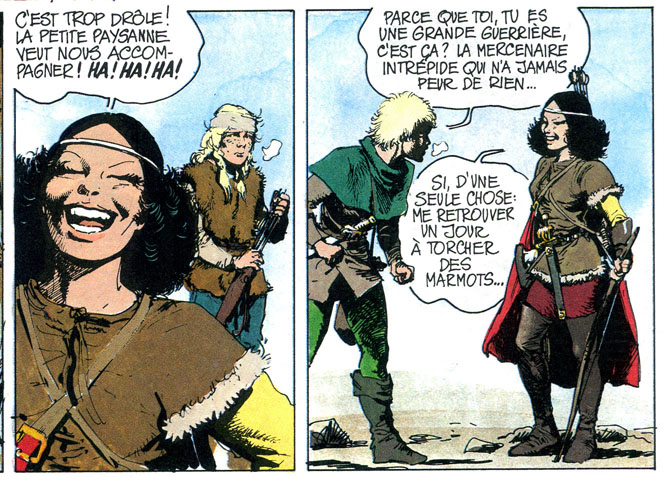


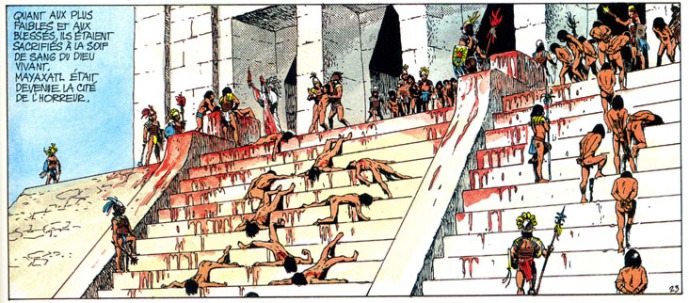

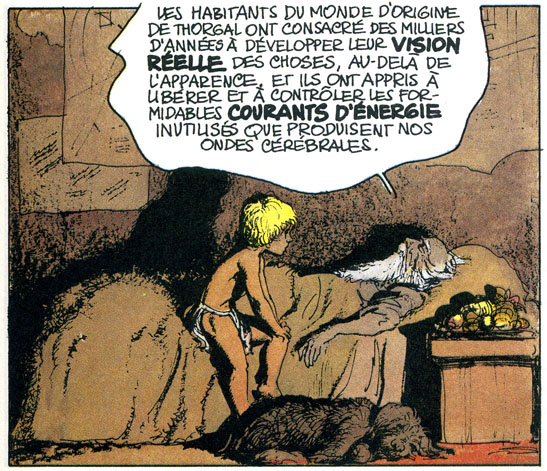
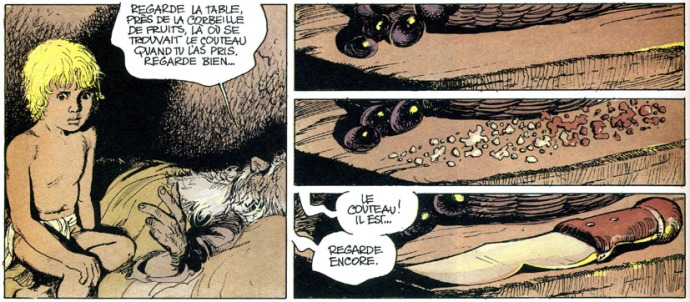



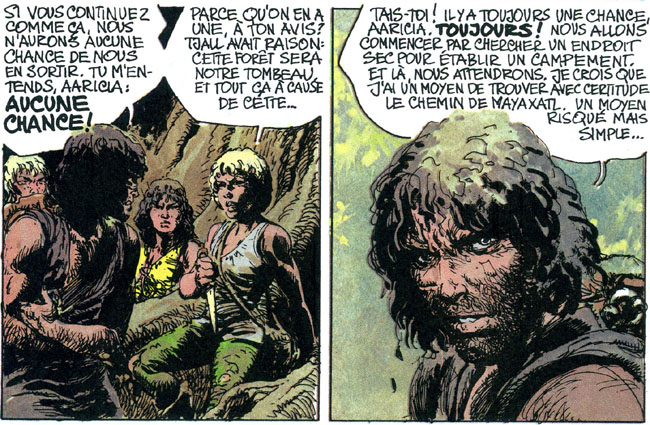
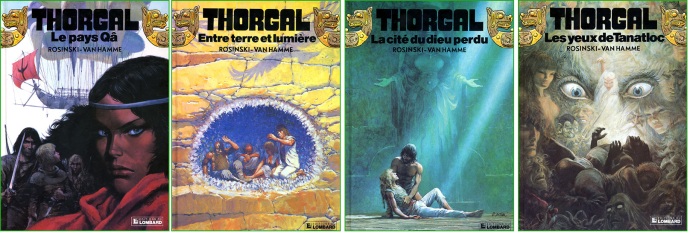
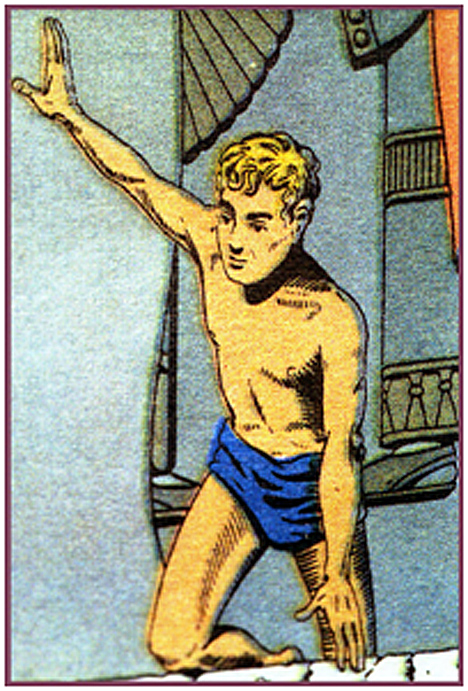
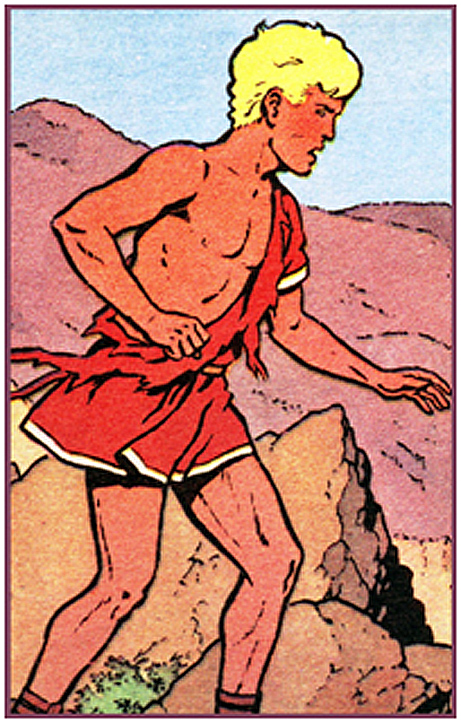

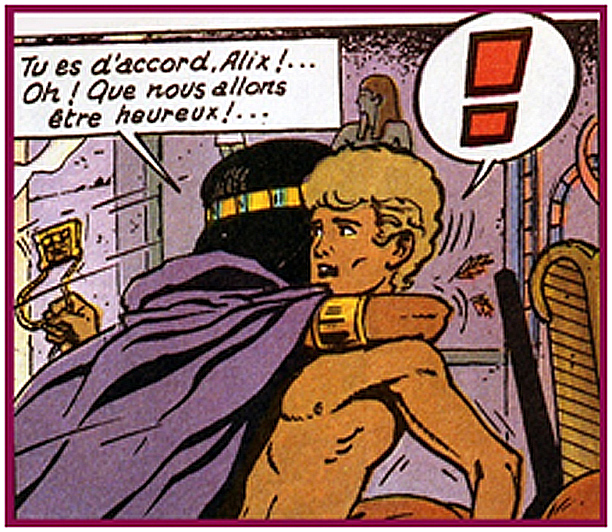
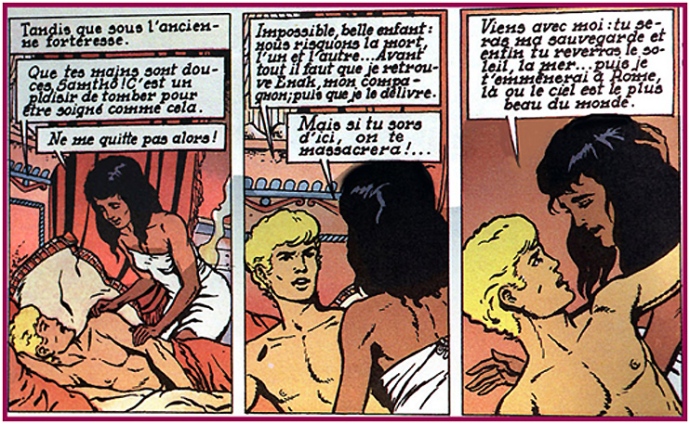
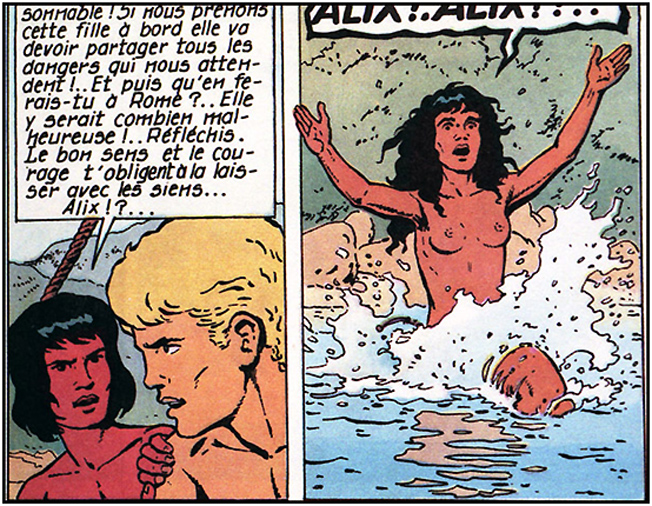
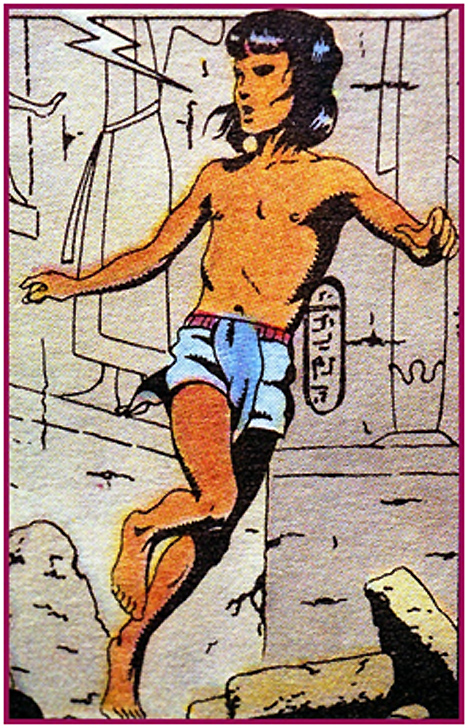


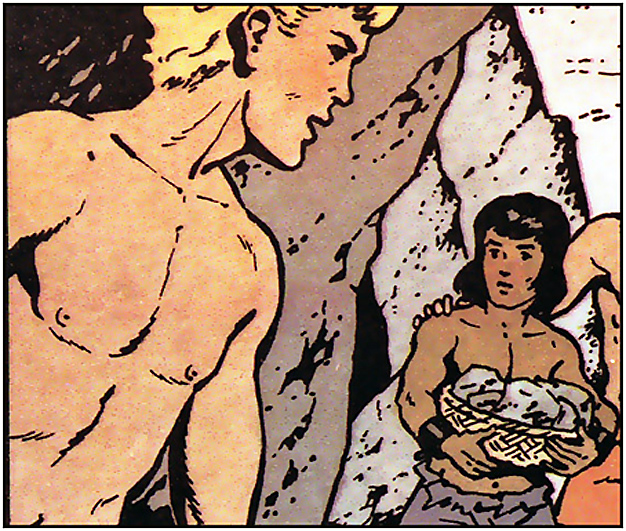
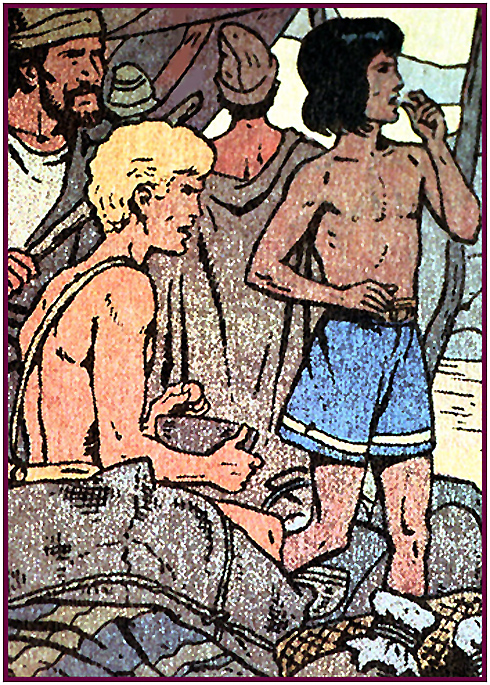
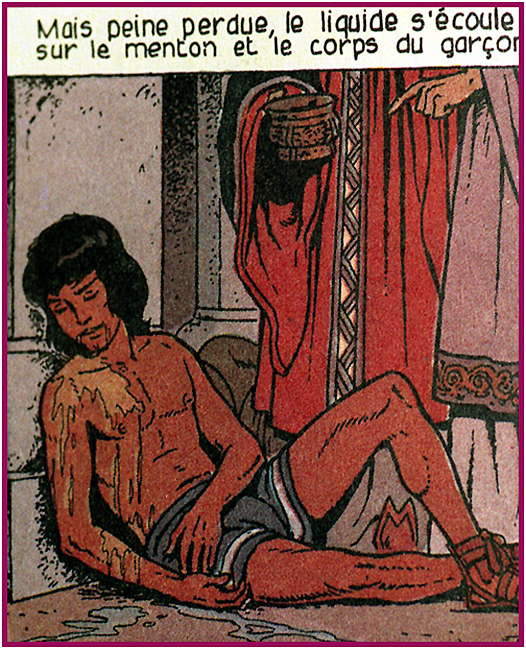

Commentaires récents