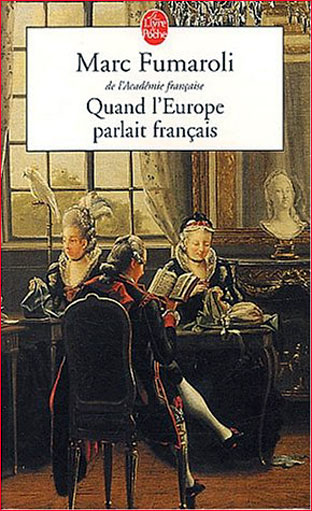
Lorsque la France est optimiste, elle rayonne. Tout le contraire des dernières années, commencées avec la crise du pétrole en 1973 et accentuées par la chute du Mur de Berlin puis le chômage corporatiste. Lorsque la France est vivante, elle s’étend par généreuse nature, « cette disposition à la joie, qu’on appelle les Lumières, et qui fait de ce siècle français l’un des plus optimistes que le monde ait connu », écrit Marc Fumaroli dans ce livre paru en 2001, avant le terrorisme de masse. Cette époque connût « un dégel du sacré, une religion poignante et profonde du bonheur et de l’instant de grâce » p.10.
Comment ? « Autorisant et diffusant la foi des Lumières en des lendemains qui chantent, l’aristocratie française en offrait, par son genre de vie et par la forme de société ouverte dont elle donnait l’exemple, une sorte d’aperçu immédiat et prometteur. La liberté de mœurs du ‘vivre noblement’ semble elle-même inviter à faire des plaisirs et du bonheur l’horizon d’une humanité délivrée de ses chaînes. L’élégance, la politesse et la douceur des manières semblent préfigurer un monde où la liberté de chacun saurait s’accommoder de l’égalité de tous et où la vivacité des passions particulières saurait ne pas troubler la joie d’être ensemble » p.14. Le Français parlé à l’époque est essentiellement un charme de société, « une merveilleuse rhétorique du dialogue » p.16. « La France du 18ème siècle et sa langue étaient irrésistiblement contagieuses et irrésistibles, parce que leur image était celle du peu de bonheur et d’intelligence dont les hommes sont capables au cours de leur bref passage dans la vallée de larmes terrestre » p.18.
Il s’agissait de vivre noblement avec autant d’application que le moine voulait vivre en contemplatif. Ce mode aristocratique, qui vient de la société antique d’Athènes (et revendiqué par Sieyès pour le peuple tout entier), supposait vie oisive et sociabilité urbaine, tout ce que « les 35 heures » ont cherché obscurément à retrouver, peut-être. La pratique des disciplines de l’esprit était d’autant plus haute et plus habile qu’elle était désintéressée, sans cette pesanteur de qui en fait son labeur. Le secret de la réussite était alors d’allier l’art de plaire et la force de gagner. Car une vie sociale dense exige un mode d’être qui reconnaît les autres et évite de les heurter sans raison. « La dissimulation est l’indice général des rapports sociaux : elle est inséparable de la convenance, qui est attention pénétrante à autrui et à ses singularités, autant que protection de soi. La simulation et le mensonge sont des moyens violents, symptômes d’une fêlure d’esprit et d’une faiblesse d’âme » p.195. Si ce diagnostic d’hier est vrai, notre aujourd’hui incivil et brutal a du mouron à se faire.
Les Lumières, au fond, viennent de l’héritage classique : « le degré de civilisation plus douce que représente la France suppose les terrassements et les fondations laissés par Rome. Les formes qu’elle introduit et qu’elle répand sont moins minérales et plus morales. Son intelligence moins architectonique et plus subtilement souple, amie de la diplomatie et du bonheur. Sa langue est moins impérieuse que persuasive et lumineuse. Elle représente un progrès dans le luxe séducteur du cœur et de l’esprit » p.345.

La contrepartie de cette sociabilité extrême est la versatilité. Vifs, curieux, les Français sont aussi sans défense contre les nouveautés et esclaves de la mode. L’aimable désinvolture rend irrésistible en amour comme dans le monde. Mais elle est le résultat d’une éducation exigeante qui ose permettre d’avoir son sentiment de ne le dire qu’à propos, sans hausser le ton et en se gardant de froisser. L’expression orale doit être un bonheur spontané, un feu d’artifice d’épigrammes, jeux de mots, traits piquants, portraits et narrations brèves. L’étude et le travail sont indispensables pour développer l’esprit, mais ne doivent pas se voir, sous peine de tomber dans la pédanterie. L’estime de soi et le soin de son corps sont une hygiène évidente pour fourbir son apparence, mais ne doivent pas devenir le but, sous peine de tomber dans le narcissisme et l’affectation. Tel sont les ingrédients du bonheur d’être ensemble.
L’étude de Marc Fumaroli parle avec saveur de cette époque disparue. Il évoque cet esprit qui est presque perdu. Il brosse les portraits de tous ces étrangers qui, au 18ème siècle, loin de massacrer la langue et d’imposer aux autres leur sabir anglo-français ou arabo-français comme preuve d’identité, écrivaient en français choisi parce que la subtilité, la précision et la souplesse de cette langue apparaissaient comme l’esprit même de la société – ce plaisir d’être ensemble.

Par quoi sommes-nous sortis de ce paradis ?
Par la Révolution d’abord, soucieuse du Bien Public et d’accorder à tous le régime qui permettrait de réaliser le bien-être social. Mais la Révolution s’est dévoyée dans la paranoïa et le mensonge, la Terreur appelant l’homme fort, comme à chaque fois que ressurgit le chaos. L’être de la Révolution s’est égaré dans l’avoir du paysan rêvant devenir bourgeois, et du bourgeois enrichi singeant l’aristocrate, figures décrites avec délice par Balzac. De là date le déclin démographique, économique et moral de la France qui fut la première puissance européenne au 18ème siècle avant d’être exsangue en 1918. L’héritage et le Code Civil l’ont rendu malthusienne, les guerres incessantes par esprit de mission ont saigné sa jeunesse, la centralisation d’État, après la table rase des théoriciens enfiévrés de Sparte, ont gelé l’innovation économique. L’Angleterre nous a devancés dans le commerce et l’industrie ; la Prusse nous a affaiblis de provocations en revanches, à chaque génération depuis Napoléon : Iéna, Sedan, Rethondes, Montoire, marquent les flux et les reflux d’une victoire impossible et d’un acharnement fratricide.
Par la colonisation ensuite, auréolée de bonne conscience missionnaire et humanitaire, mais qui en vint à se dévoyer dans la fatuité et l’autoritarisme. « L’avant-garde » éclairée aimait forcer les « simples » comme les « naturels », les « enfants » ou les « prolétaires » à obéir « pour leur bien » au curé ou au parti, à l’instituteur, adjudant, missionnaire, fonctionnaire ou colon. La République des « hussards noirs » de l’intérieur, en mission éducatrice dans les campagnes, fit bon ménage avec celle des colonisateurs des pays « sauvages » car, au fond, il s’agissait toujours de prêcher un Savoir-mieux-que-tous dont nous nous croyions détenteurs.
Par la guerre de 14 encore, qui bouleversa les relations humaines, « brutalisant » les comportements, dissolvant dans l’absurde massacre industriel le patriotisme, le courage et le sacrifice, ce qui aboutira inévitablement à l’abandon de Munich et à l’impéritie de l’an 40. Tout en faisant sombrer l’idéal socialiste dans un communisme réel de dictature, appliqué en laboratoire au pays des moujiks.

Le sursaut de la Libération et de la reconstruction des Trente Glorieuses se sont heurtés très vite à l’égoïsme optimiste d’une génération comblée qui rejeta tous les carcans, comme André Gide l’apprit à Nathanaël : conventions et morale, slip et soutien-gorge, discipline et contraintes – tout fut balancé par-dessus les moulins dans un gigantesque monôme commencé boulevard Saint-Michel pour finir sur les plages de Bali dans l’union sexuelle de tous avec tous et les fumées de l’oubli. Mais il y avait de la jeunesse, du bonheur et de l’optimisme dans cet éclat d’hier. Le baby-boom s’était épanoui en jets de sperme mais aussi en cent fleurs.
Cet hédonisme s’est brisé sur la crise du pétrole, l’inflation monstre, la déliquescence industrielle, le chômage de masse, l’irruption du SIDA – et l’impéritie des politiques. Ils n’ont pas su, à droite remettre en cause le « modèle » obsolète comme le firent Reagan et Thatcher ; à gauche, renouveler le socialisme en le dépoussiérant des vieux dogmes bismarxiens (Marx revu par Bismarck, selon Attali). Ni fonder durablement une troisième voie, comme le tentèrent Mendès-France, Chaban-Delmas, Raymond Barre, Jacques Delors, Michel Rocard et peut-être Hollande mais trop peu-trop tard, entre hésitations, procrastination et jovialité de « synthèse ».
La jeunesse du boom a vieilli et recherche la sécurité d’État, la sécurité sociale et le maternage des aides. La discipline de la reconstruction et la générosité de la Résistance ont sombré dans l’égoïsme corporatiste des « statuts » et dans l’arrivisme social des autres, qui se réfugient volontiers dans le « ghetto français ». La décolonisation a attiré en revers une population avide de modernité mais qui se sent brutalement lâchée par les idéaux français. Elle revendique, par mimétisme social, des « droits » communautaires, « comme tout le monde ». L’émergence au développement de pays massivement peuplés et industriellement optimistes, en regard du climat qui se réchauffe de façon accélérée avec son lot de tempêtes et d’inondations, remet en cause le credo révolutionnaire de l’homme maître de son destin, de sa production et de la nature.
L’Europe ne parle plus français, car le français n’apparaît plus porteur d’un avenir heureux : un État trop centralisé dans une Europe qui se déconcentre ; un pouvoir trop monarchique dans une Europe majoritairement parlementaire ; une caste dirigeante trop fermée et trop imbue d’elle-même, crispée sur « la dépense publique » et sa contrepartie « prélèvements obligatoires », qui font de la France une exception parmi les pays européens (plus forte intervention d’État par rapport au PIB, plus forts prélèvements, plus forte TVA) ; un « modèle » qui n’en est plus un, manquant d’offrir du travail (plus fort taux de chômage), d’éduquer la jeunesse (un élève de 4ème écrit au niveau du CM2 d’hier), de juger correctement et dans les délais (Outreau), rigidifié sur la « protection », centré sur l’assistance et sur les « droits », déresponsabilisant chacun, sans cesse repentant et flagellant, et distribuant réparations et soutiens « psychologiques » ou pécuniaires à tout va.
La France est un repoussoir en Europe, pas un modèle que l’on a envie d’imiter. Reste « le discours » : là, nous savons toujours faire. Les grandes idées généreuses pour le monde entier gardent un écho 18ème siècle : le recours à l’ONU plutôt que l’usage unilatéral de la force, la lutte mondiale contre le SIDA ou Ebola, la concertation contre le réchauffement climatique, les voies d’un respect pour la nature. Mais est-ce suffisant ?
Nous faudrait-il en revenir à l’Ancien Régime, comme le Japon qui ne l’a jamais quitté, pour connaître à nouveau le bonheur social ? Nous faudrait-il aller vers les autres, notamment vers nos partenaires européens, pour trouver une voie neuve et fraternelle d’aborder le 21ème siècle ? Nous faudrait-il rester sur les idées abstraites d’État-qui-peut-tout et Qui-doit-tout, les seuls « agents » de l’État étant réputés être seuls « neutres » et « objectifs » pour savoir, mieux que tous et au mépris des règles démocratiques, ce qui est bon pour l’intérêt « général » ?
« Qui » parlera encore « français » demain veut dire « qui aura encore envie d’accompagner notre peuple vers l’avenir ? » – c’est cela qui importe, pas les petites phrases.
Marc Fumaroli, Quand l’Europe parlait français, 2001, Livre de poche 2003, 638 pages, €8.10







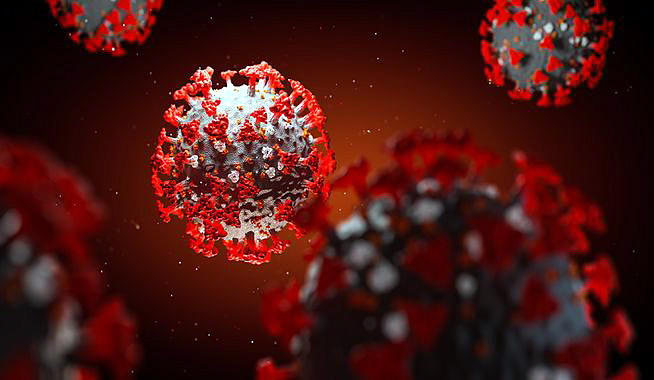







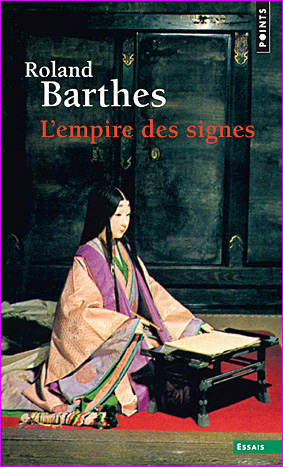

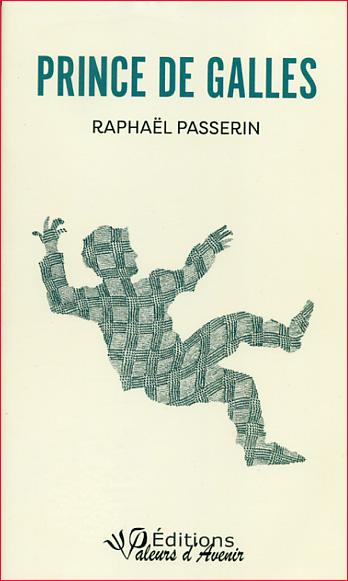

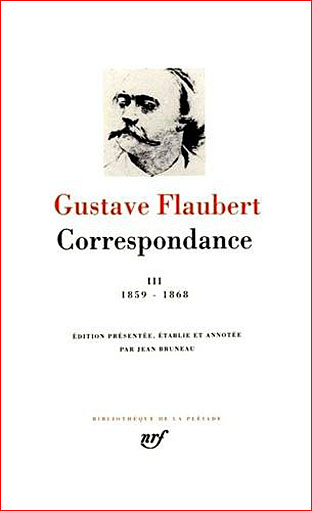
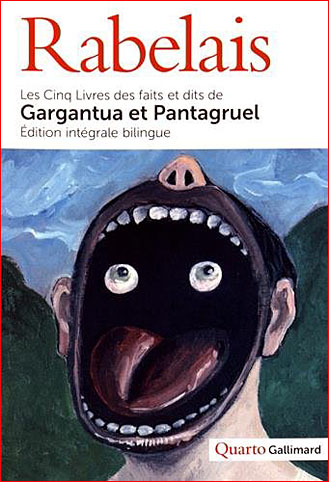
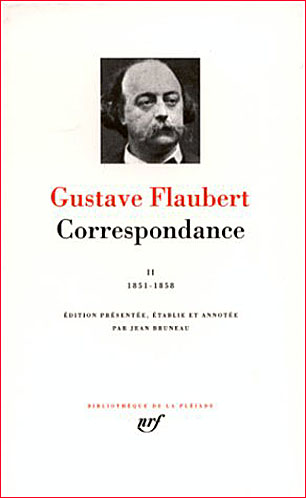

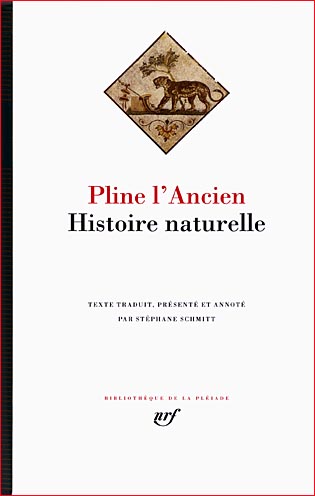





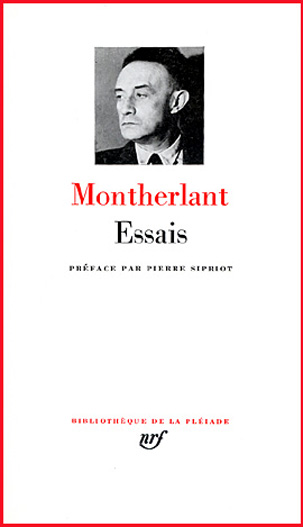











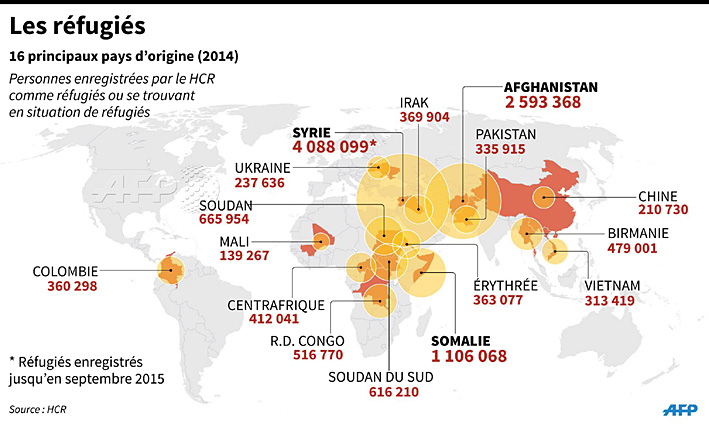

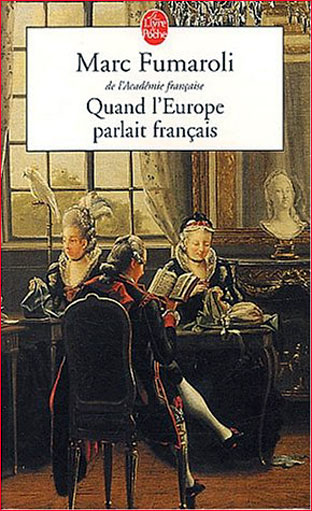



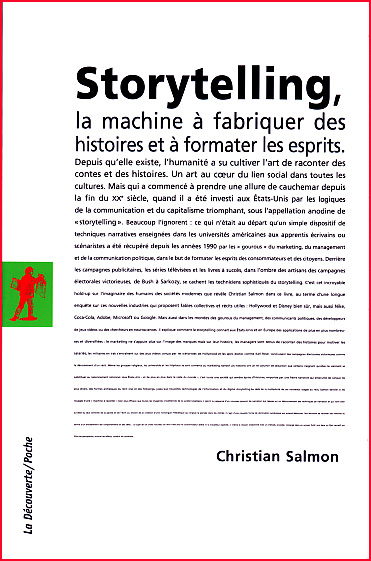


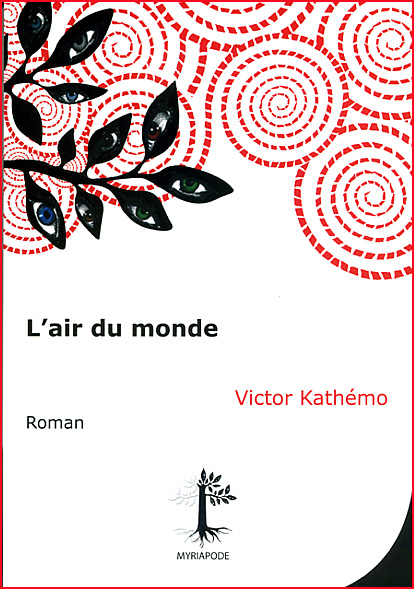















Commentaires récents