Vers 1840, la mode est à la pute : filles, lorettes, grisettes, femmes sans nom et femmes entrete(nues). Isidora en est une, au prénom improbable au féminin (en tout cas diabolique dans la littérature noire). Son vrai nom est Julie, comme une héroïne de Rousseau, mais Isidora sort plutôt du ruisseau. Evidemment belle et espiègle, éprise d’idéal évidemment inaccessible, elle couche pour arriver en croyant trouver l’Hâmour. Fleur flétrie qui n’y paraît pas, c’est alors que le narrateur la cueille au jardin.
Lui, Jacques Laurent, est un précepteur apprenti philosophe qui couche sur le papier des élucubrations « élevées » mais sans aucun intérêt ; il n’a baisé encore aucune femme à 25 ans, une scie de George Sand pour qui la continence, selon les préceptes intéressés de l’Eglise, monte au cerveau et « sublime » les vertus. Nous n’y croyons guère ; c’est plutôt la rancœur et le ranci qui macèrent. Depuis sa fenêtre, il aperçoit la belle en son jardin d’à côté et un hasard de travaux lui permet un jour d’en approcher. L’intermédiaire idéal, Tony, une sorte de Cupidon de l’âge de Figaro (13 ans) qui est jockey chez le comte, porte de lui une lettre où il demande grâce pour un vieux de l’immeuble qui ne peut payer son loyer. Le gamin revient avec un billet de banque en réponse et, de fil en aiguille, fait visiter les fleurs du jardin – dont la plus belle est évidemment Julia.
C’est par un autre hasard, mais sans intermédiaire, qu’il tombe sur un domino qui va au bal de l’Opéra et qui le convie à la protéger d’un importun. C’est Julia déguisée en Isidora, vite démasquée en public par l’un de ses anciens amants. Jacques tombe de haut : la patricienne d’à côté est une grisette entretenue par le comte de S*. Mais Julie lit Rousseau et Jacques le lit aussi ; les deux s’entendent comme philosophes en herbe, d’autant que Jacques effectue une « recherche » sur l’essence de la féminité. Le roman alterne donc un « cahier » philosophique (indigeste) et un « journal » (beaucoup plus vivant) qui tend à prendre le pas dans le texte pour le plus grand plaisir du lecteur.
Car c’est tout une aventure qui se dévoile par à-coup de mystères révélés. Jacques, cheveux blonds, teint de rose, taille élevée, main de marbre et prestance d’athlète, est observateur, réservé et sans ambition. Un modèle de mâle selon George Sand. Il deviendra d’ailleurs le précepteur de Félix, bel enfant affectueux de 7 ans, fils d’une jeune veuve de la haute société… comme par hasard belle-sœur sans le savoir de Julie. Jacques rachètera Isidora en son cœur en accusant par philosophie de pousser la (bonne) société à la prostitution des filles pour le plaisir des mâles riches et parisiens (ce que perpétuent les féministes d’aujourd’hui). Elle, qui couche une nuit avec lui au retour de l’Opéra, se fera épouser in extremis par son comte protecteur lorsqu’il sera à l’article de la mort lors d’un voyage en Italie ; elle l’a soigné avec dévouement. Elle deviendra veuve riche, comtesse respectable puis, dix ans après, mère en adoptant une jeune fille pauvre, Agathe, qu’elle fiancera au fils de sa belle-sœur au grand cœur Alice. Elle se sauvera donc par « la morale », c’est-à-dire la pratique de la « vertu » bourgeoise. C’est aussi irréaliste que candide : il suffirait de vouloir… ou, comme Pascal, prier au cas où pour que Dieu vous reconnaisse.
Trois ans après, les mêmes hôtels parisiens jumeaux montrent Alice et le précepteur Jacques dans l’un, Julie dans l’autre. Dialectique inévitable chez Sand, Jacques reste amoureux de Julie alors qu’Alice, veuve, est amoureuse de lui qui s’occupe comme un père de son fils qui l’adore. Le comte de S* était le frère d’Alice de T*. Cette dernière, femme modèle, s’analyse pour savoir si elle va accepter la courtisane parvenue que tout le reste de sa famille rejette. Elle s’aperçoit alors de l’amour que Jacques voue à Julie, sans que cette dernière y réponde par la même flamme. Elle veut favoriser leur bonheur, au prix d’une « crise nerveuse » qui la laisse sur le carreau plusieurs jours avant de s’effacer (hystérie fort « romantique »). Mais Julie a conscience de l’impossibilité d’aimer (dont la manifestation physique semble être la frigidité), peut-être pour être passée de corps en corps sans jamais pouvoir s’attacher. Elle garde de la catin l’ambition effrénée de séduire tout en déplorant son besoin d’être aimée. Le cœur et le vagin sont séparés et le cerveau fantasme.
La troisième partie, rapportée pour cause d’insuffisante longueur du roman écrit d’abord en feuilleton pour des revues, est faite de pièces mal raboutées sous forme de « lettres d’Italie ». Isidora les envoie à Alice qui semble ne pas répondre, et les longueurs à prétention philosophique n’y sont pas rares et toujours fastidieuses. Julie a dérobé le journal de Jacques et se rend compte qu’il aime Alice sans oser se l’avouer ; elle s’exile donc volontairement pour leur laisser le champ libre.
Dix ans après, Isidora adopte une Agathe de 16 ans afin d’assouvir son besoin d’aimer. Femme, elle est sauvée par les femmes : Alice socialement, Agathe familialement. C’est alors qu’un jeune homme vient se recommander auprès d’elle. Il est, comme toujours chez George, désirable – du moment qu’il est encore trop jeune pour n’être pas dominé par les femmes : « 18 ans au plus, une taille élancée des plus gracieuses, une figure charmante, un air de distinction incomparable, des cheveux noirs abondants, fins et bouclés naturellement, un duvet de pêche sur les joues et des yeux… » p.1138 Pléiade. Il se présente en intermédiaire, comme Tony, le jockey initial. Coup de théâtre ! C’est la partie la plus drôle et la plus captivante de ce roman bancal où la théorie prend trop souvent le pas sur la peinture mais où la psychologie demeure passionnante.
George Sand, Isidora, 1846, Independently published 2019, 164 pages, €7.51
George Sand, Romans tome 1 (Indiana, Lélia, Mauprat, Pauline, Isidora, La mare au diable, François le champi, La petite Fadette), Gallimard Pléiade 2019, 1866 pages, €67.00

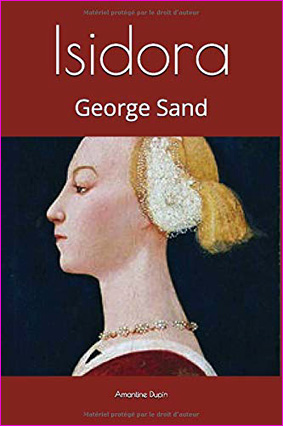


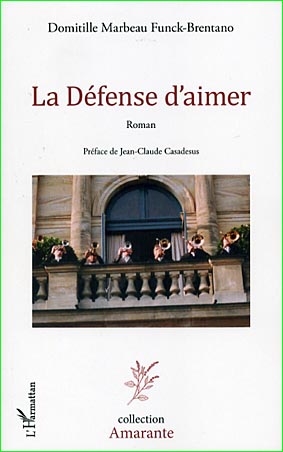

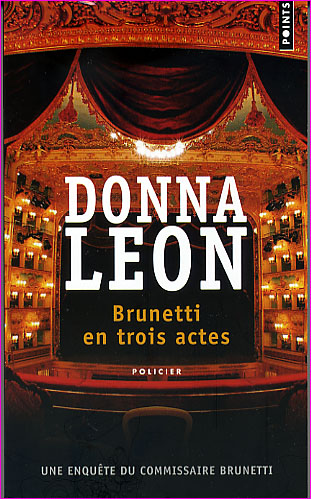

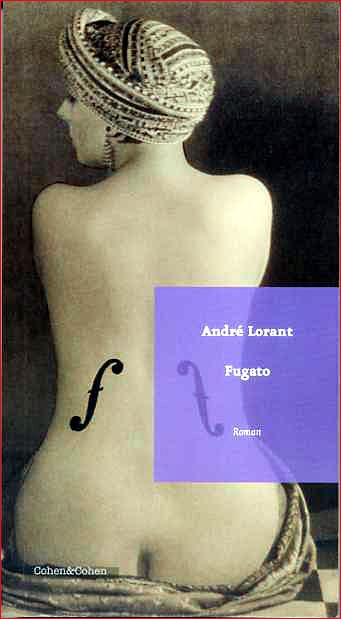
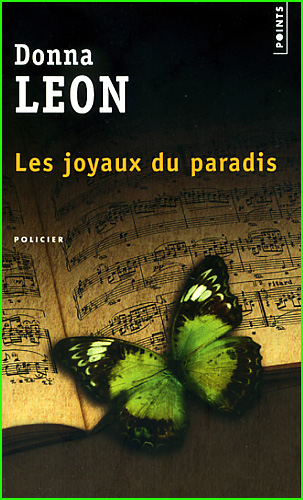













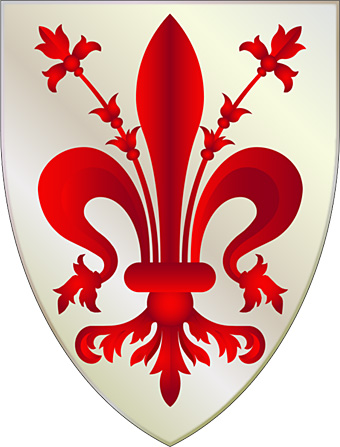
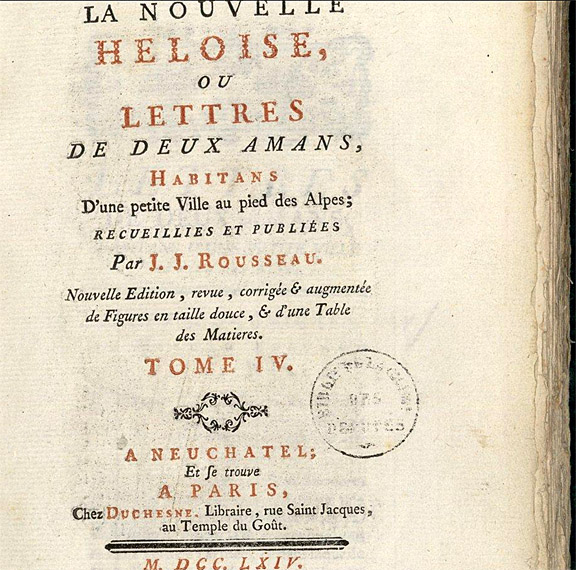

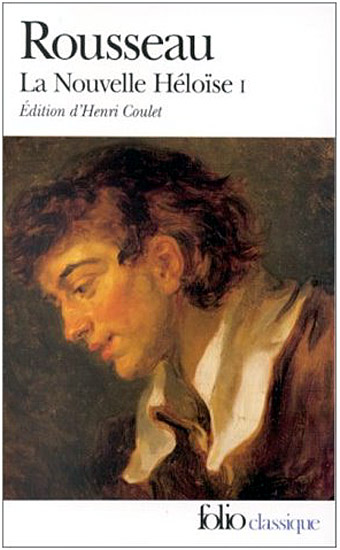
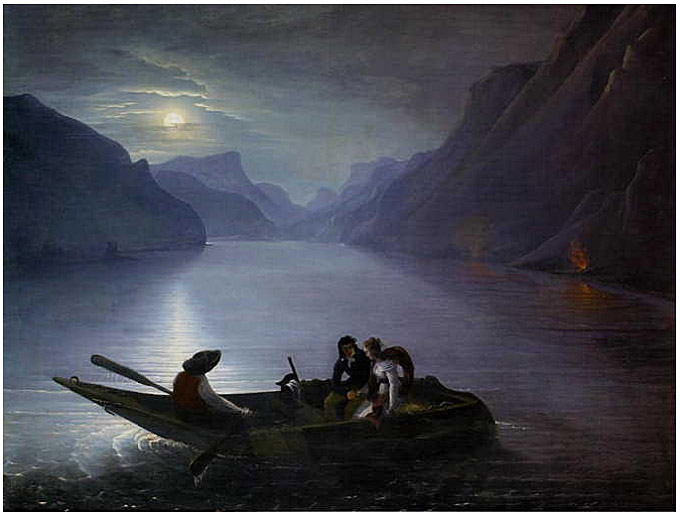


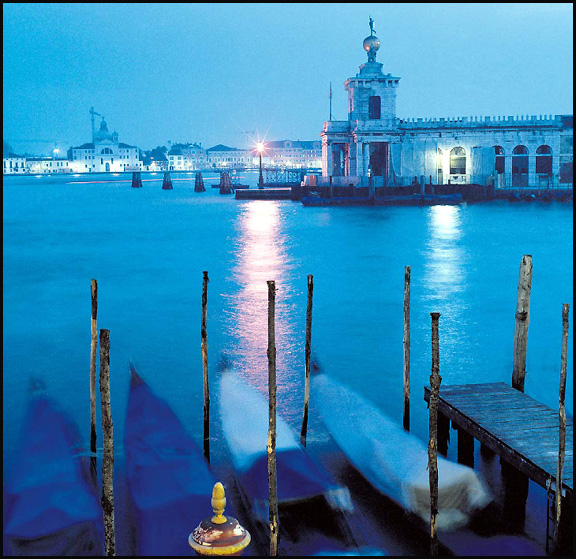




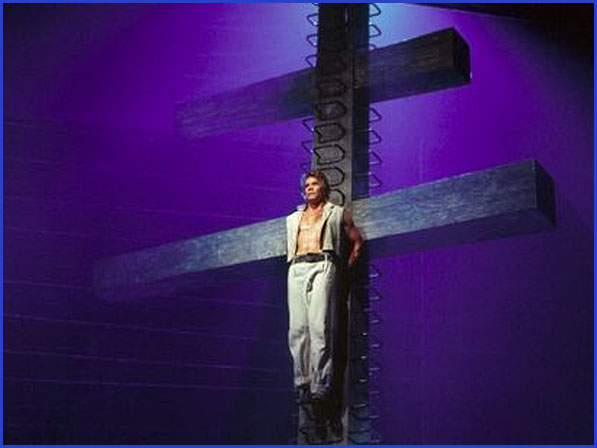











Commentaires récents