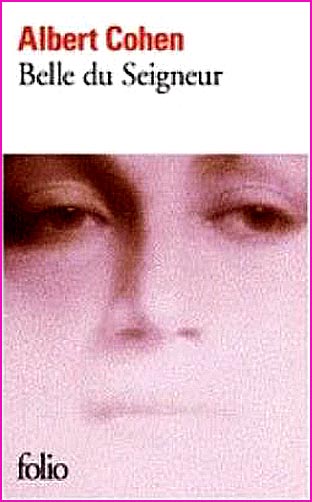
Un gros livre sur l’amour, torrentueux, exubérant, plus de mille pages en petits caractères ; des phrases qui vont, se répètent, s’étirent, se reprennent ; des monologues ininterrompus de quinze pages pleines, sans une virgule ni un point, comme une pensée qui file et saute. Voici un maître ouvrage : monstrueux, truculent et riche.
Ce fleuve de mots raconte une histoire éternelle, celle d’un homme et d’une femme. Ils sont beaux, riches, intelligents, passionnés, ils s’aiment absolument, indiscutablement. Jusqu’à ce que les années, la société, l’usure, les mène à se haïr. La fin est inévitable et comme un soulagement, unique porte au fond de l’impasse.
Albert Cohen écrit tout un roman d’amour pour démontrer que l’amour n’existe pas. Du moins l’amour idéalisé des romantiques, l’Hâmour de Flaubert et celui des midinettes, l’amour qui court encore les chansons et les téléfilms, l’amour ado qui confond le sexuel avec le fusionnel dans une éternité de pâmoison… Albert Cohen dénonce le faux amour, celui qu’on croit le seul.
Dans la société européenne d’entre-deux guerres, dans le milieu bourgeois riche de Genève, parmi les diplomates policés de la Société des Nations, un être ne peut aimer un autre être. Mariages et adultères ne sont pas conséquences de « l’amour » mais des conventions sociales. Une femme n’est amoureuse d’un homme que pour la force physique qu’il incarne, pour sa position dans la société, pour sa fortune. Un homme n’aime une femme que par le prestige qu’il en tire dans les salons, pour son admiration devant sa position, l’aide apportée à son ambition… Et Cohen décrit avec délectation la vie étriquée et mesquine du petit fonctionnaire diplomate, éperdu de prestige et de reconnaissance, n’existant que par sa position dans la hiérarchie et par son opiniâtreté à s’y élever peu à peu. Ce type de mâle existe encore un peu partout, et pas seulement dans les bureaux ou les salles de trading, il n’est que de voir les belles fringues, les belles bagnoles, les belles montres pour en trouver à la pelle aujourd’hui, de ce type d’arrivistes.
Madame Adrien Deume se moque de l’ambition sociale de son mari. Aristocrate non conformiste, elle n’est pas de ce milieu si petit. Solal, sous-secrétaire général à la SDN, n’est pas le fonctionnaire modèle, zélé et méticuleux. Le lecteur pourrait croire que ces deux exceptions peuvent former un couple élu pour vivre un amour débarrassé des contraintes bouffonnes du social ? Il n’en est rien.

Solal, déguisé en vieux juif et déclamant poétiquement son amour, est repoussé avec horreur. Solal, fringant et vigoureux jeune homme, présenté comme sous-secrétaire général, bien qu’ironique et méprisant, est adoré. Ce qu’aime la femme, ce n’est pas l’homme, démontre Albert Cohen – mais c’est sa force brute, sa gorillerie. « Car cette beauté qu’elles veulent toutes, paupières battantes, cette beauté virile qui est haute taille, muscles durs et dents mordeuses, cette beauté qu’est-elle sinon témoignage de jeunesse et de santé, c’est-à-dire de force physique, c’est-à-dire de ce pouvoir de combattre et de nuire qui en est la preuve, et dont le comble, la sanction et l’ultime racine est le pouvoir de tuer, l’antique pouvoir de l’âge de pierre, et c’est ce pouvoir que cherche l’inconscient des délicieuses, croyantes et spiritualistes » p.303. La femme aime en l’homme le tueur. Et la culture, la noblesse, la distinction, les sentiments délicats, ne sont que signes d’appartenance à la classe des puissants, à la caste des tueurs les plus forts. Le féminisme a poussé les garçons depuis une quinzaine d’années à réagir en accentuant leur côté viril, brutal, musclé. L’Hâmour est méprisé, la baise encensée. Tant pis pour le romantisme et la galanterie : un excès engendre son contraire et ces Chiennes de garde qui aboient à toute différence n’ont que le grain qu’elles ont semé, Albert Cohen l’avait montré. Ce pourquoi certaines préfèrent rester entre filles, et les garçons entre eux.
Cet amour hypocrite pour la puissance, à travers les sentiments idéalistes, répugne à Solal. Mais il a besoin (comme beaucoup) de la tendresse des femmes, « cette tendresse qu’elles ne donnent que si elles sont en passion, cette maternité divine des femmes en amour » p.316. Pour avoir cette tendresse, il doit jouer le jeu de gorillerie. Il se montre énergique, arrogant, dominateur – le mâle parfait désiré de ces dames.
Ce qui est intéressant dans cette charge est le matérialisme des sentiments. L’amour est animal, pas éthéré ; avant tout charnel, pas spirituel. La femme recherche la force chez l’homme comme la femelle se soumet au mâle dominant, par instinct de protection pour ses maternités ; l’homme cherche la tendresse d’une compagne, substitut à la mère, qui sera mère des enfants en commun. Moral ou non, politiquement correct ou pas, cela est. Les femmes qui se mettent en couple apprennent à apprécier d’autres qualités moins machistes des hommes, moins immédiatement visibles que la virilité brute des muscles, du système pileux et de la grossièreté cynique. La position d’Albert Cohen sur le sujet apparaît comme une position biblique de haine de la chair, en tant que signe d’appartenance à l’animalité. Elle est réductrice et n’englobe pas tout l’amour entre sexes opposés.
Plus fine est sa critique de l’hypocrisie bourgeoise, de l’ambition du paraître qui empoisonne les êtres jusqu’au narcissisme et à l’arrivisme, de ce prétexte qu’est l’idéalisme étroit à la Bovary. Pas de mariage qui ne soit calcul de fortune ou de représentation, dit-il ; pas de charité si nul n’est au courant ; pas de religion si l’on ne peut s’en faire gloire entre amies du même monde ; pas d’invitations gratuites… Tous les sentiments sont pesés, rabaissés au monnayable, réduits au profit attendu. Là est la véritable satire de l’amour par Cohen, à mon sens, la critique de l’amour bourgeois réduit au cheptel à engendrer et à l’héritage à faire fructifier et transmettre, et non pas sa position sur la force animale.
Ce qui est gênant est que les deux s’entremêlent. Ainsi de l’exemple du chien. « Un chien, pour le séduire, je n’ai pas à me raser de près, ni à être beau, ni à faire le fort, je n’ai qu’à être bon. Il suffira que je tapote son petit crâne et que je lui dise qu’il est un bon chien et moi aussi. Alors, il remuera sa queue, et il m’aimera d’amour avec ses bons yeux, m’aimera même si je suis laid et vieux et pauvre, repoussé par tous, sans papiers d’identité et sans cravate de commandeur, m’aimera même si je suis démuni des 32 petits bouts d’os de gueule, m’aimera, ô merveille, même si je suis tendre et faible d’amour » p.322. L’homme Cohen revendique la sensibilité animale ; il ne veut pas être enfermé dans le machisme, cette image sociale préfabriquée du mâle. Il rejoint la revendication justifiée des féministes de pouvoir être soi, femme énergique ou mâle sensible au rebours des conventions. Ce qu’Albert Cohen voudrait connaître, ce sont les rapports personnels, affectifs, pareils à ceux d’un homme et d’un chien, et non pas les rapports habituels de statut social. Il veut être aimé pour lui, pas pour sa parure ni pour sa position. Mais à mélanger les deux, est-il crédible ?
Je ne souscris pas à son assimilation de la faiblesse à la bonté, ni à l’opposition tranchée qu’il fait de la bonté et de la force. Être « faible d’amour » n’est pas être faible tout court. Avoir besoin de tendresse n’implique nullement que l’on soit esclave – ni de celles qui dispensent la tendresse (mère, épouse, amante, amie, enfant) – ni de ce besoin même, qui n’occulte en rien les autres facultés humaines. La tendresse n’empêche pas la force, ni la puissance la bonté. Au contraire même, l’homme fort déborde de générosité, qui appelle la tendresse en retour. Il faut voir le gros mâle fondre devant son tout petit enfant. Et celui qui a beaucoup vécu, fort de son expérience, est plus disposé à l’indulgence et au relativisme du jugement.

Non, Monsieur Cohen, notre origine animale ne nous rend pas « méchant », et ce n’est pas le regard de Dieu qui nous culpabilise d’être faible de chair, ni les tables de la Loi qui nous dressent moralement. Notre « bonté » ne provient pas plus de la morale que notre « méchanceté » ne vient de la nature. La force, comme la faiblesse, peut être bonne ou mauvaise. Cet amour de la force, que vous avez cru découvrir chez la femme, n’est pas l’amour satanique du destructeur, de la bête de proie, mais l’amour de la plénitude des possibilités humaines.
L’homme « fort » révéré par l’amour des femmes n’est pas la brute tueuse que présente Albert Cohen mais l’homme complet, développé au physique comme au moral, l’homme qui peut tuer, certes, mais qui a de bonnes raisons de le faire et pas une simple envie ou un besoin sadique. Adrien Deume, dans Belle du seigneur, est une machine à ambition. Il n’est au fond pas un « puissant » mais le fantasme de puissance d’un faible qui veut arriver et doit se faire plus macho qu’il ne l’est pour intéresser les femmes. Fort heureusement, ou elles ont bien changé, ou elles ne sont pas toutes comme ça !
Albert Cohen, Belle du seigneur, 1968, Gallimard Pléiade 1986, 1034 pages, €50.35
Albert Cohen, Belle du seigneur, 1968, Coffret Folio 1998, 1109 pages, €11.88

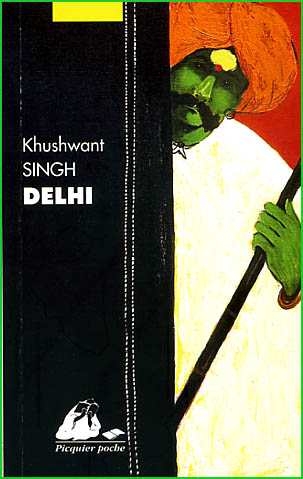
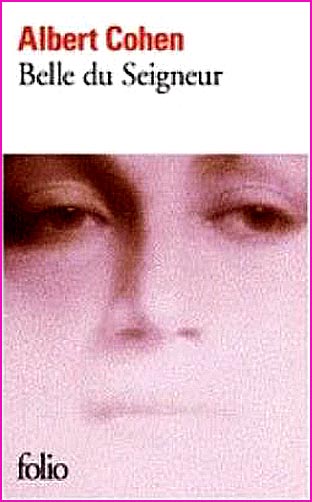













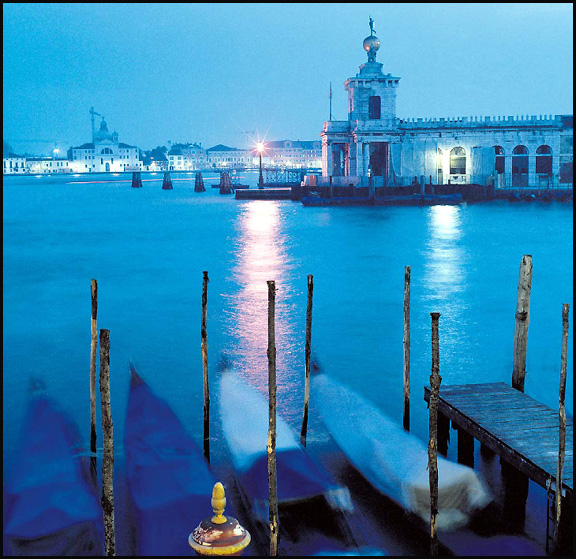

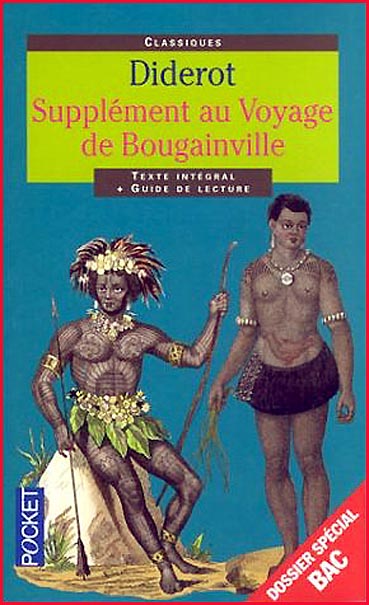

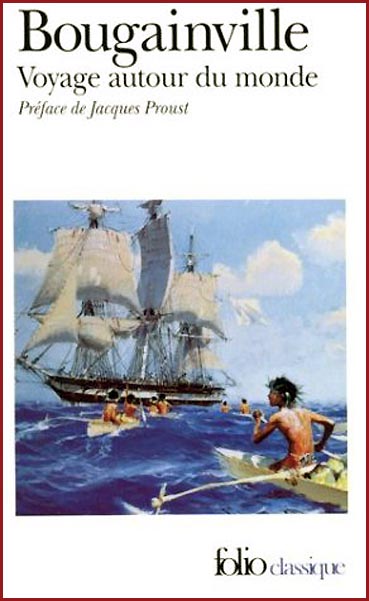
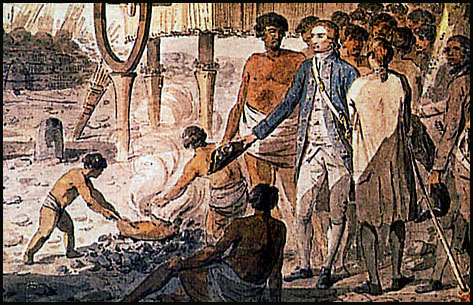

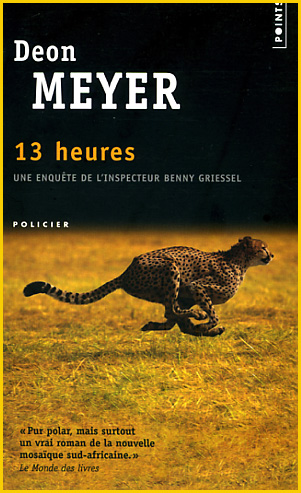

Commentaires récents