
La BD au dessin un peu pâles de Thierry Robin et Fabien Nury adaptée au cinéma avec l’humour anglais : quel régal ! En ces temps de satrapie mafieuse au Kremlin, réviser l’époque du « petit père des peuples » est instructif. Le tyran est aigri, malade, paranoïaque, tout le monde plie devant lui ; tout désagrément se paie par une exécution immédiate ou un stage de torture dans les caves de la Loubianka, avant une déportation mortelle au goulag. Tout est bon pour garder le pouvoir, les honneurs, les datchas – les petites filles pour Béria.
Car le grand Staline a ses âmes damnées, qu’il entretient en concurrence comme Poutine le fait parmi les siens. Béria (Simon Russell Beale) et Khrouchtchev (Steve Buscemi) sont sans conteste les moins bêtes, les moins veules devant Staline. Il aime ça, le tyran, il aime s’entourer – mais pas de trop près. Ses bons plaisirs sont des ordres, des oukases comme au temps des tsars, mais avec sanction mortelle immédiate s’ils ne sont pas assouvis. Ainsi Staline écoutant à Radio Moscou le concerto n°23 de Mozart exige que le directeur de la salle le rappelle « dans exactement 17 mn ». Sauf que l’imbécile sidéré qu’il a eu au bout du fil n’a pas noté l’heure. Quand il le rappelle, tout tremblant et en retard, Staline très sec exige qu’il lui envoie un enregistrement du concert qui vient d’avoir lieu – et illico ! Sauf que l’imbécile n’a rien fait enregistrer et qu’il doit improviser… à la Staline, autrement dit obliger les spectateurs à rester pour éviter l’écho et l’orchestre à recommencer. Quand les notes sont enfin gravées sur un disque 33 tours, les gardes s’en emparent – et notent l’inadmissible délai – tandis que la pianiste (Olga Kurylenko), dont toute la famille a été exécutée par caprice de Staline, glisse un mot dans la pochette.

Ce mot dit qu’elle prie pour que le tyran disparaisse enfin de la surface de la terre et Staline (Adrian Mcloughlin), qui le lit tout seul dans son grand bureau, en rigole avant d’être saisi d’une crise cardiaque qui le laisse hémiplégique : quelqu’un a osé ! Il n’avait plus l’habitude. Il tombe mais personne ne bouge : sans ordre, surtout ne rien faire ! Ne pas attirer l’attention, faire profil bas, ne rien voir ni savoir. Quand la gouvernante apporte le petit déjeuner le lendemain matin, Staline est au plus mal. Il faut appeler un médecin mais Béria n’est pas pressé, il veut être calife à la place du calife et s’empresse d’être le premier sur place pour s’emparer de la clé qui ne quitte jamais la poche de Staline, laquelle ouvre un tiroir dans lequel est une autre clé, celle d’un coffre qui recèle des dossiers. Il fait disparaître le sien avant que les autres membres du Comité central ne fassent irruption à la datcha, certains en pyjamas. Les prolos promus n’ont aucun sens de la dignité.

Les trémolos de deuil sont un jeu d’hypocrites, chacun est bien content de se voir débarrassés du satrape qui les terrorisait. Seul Béria garde la tête sur les épaules, petit et gros, libidineux avec les très (très) jeunes filles, 7 ans, 14 ans, dira-t-on à la fin du film. C’est le malléable Malenkov (Jeffrey Tambor) qui, en vertu des articles du protocole décidé par Staline, prend la présidence du Comité central par intérim, le temps qu’un nouveau Secrétaire général soit désigné. La réunion informelle entre membres aboutit avec un retard dommageable à la décision « collective » de faire appel à un médecin. Sauf que tous les médecins compétents de Moscou ont été envoyés au goulag, sur ordre de Staline qui croyait au complot des blouses blanches (en général juives). Sont donc racolés en catastrophe les retraités et les très jeunes médecins, dénoncés par une virago qui a déjà établi la liste des déportés. Ils concluent, laborieusement et « collectivement » que le grand camarade Staline a fait l’objet d’une attaque cérébrale qui l’a paralysé du côté droit. S’il va s’en sortir ? Euh… ils n’ont pas décidé.

Surviennent la fille et le fils de Staline, la première, Svetlana (Andrea Riseborough) qui n’a aucun rôle politique et craint désormais pour sa vie ; le second, Vassili (Rupert Friend), lieutenant-général par faveur, ivrogne, hystérique et incompétent, qui exigera de faire un discours – heureusement couvert par le sifflement des avions à réaction. Le Comité ne sait pas encore quoi faire de cette famille (l’épouse de Staline et mère des deux enfants s’est suicidée…), ce qui donne l’occasion de quelques scènes cocasses. Staline revit mais ne pousse que quelques borborygmes inarticulés en pointant un doigt, désignant peut-être Khrouchtchev. Puis il meurt définitivement, non sans avoir donné des sœurs froides à tous, dont Béria qui s’est empressé de le féliciter d’être ressuscité après l’avoir traité de gros con quand il le croyait passé.


Béria intrigue pour prendre les rênes du pouvoir en faisant boucler Moscou par sa police politique (en allemand Gestapo), tandis que Khrouchtchev convainc Malenkov de donner le contre-ordre de libérer les trains pour laisser venir à lui tous les petits enfants du Père des peuples de l’Union soviétique – ce qui engendre mille cinq cents morts car la milice aux ordres tire avant d’être débordée. Béria est mis en échec d’autant que le général Joukov (Jason Isaacs), vainqueur de Stalingrad et couvert de médailles et breloques soviétiques, a une dent contre ces faux soldats qui sont la SA de Béria. Il intrigue avec Monsieur K pour faire intervenir l’armée et liquider le MGB qui résiste. Béria veut faire un geste libéral en annulant les arrestations et ordres d’exécution des derniers jours et en amnistiant certains prisonniers – signe du bon plaisir sans aucun droit, mais c’est trop tard ; ce sera porté au crédit de son successeur à la tête du Comité central : Khrouchtchev. Béria « le gros cochon », selon Joukov, est pris par les soldats, emmené dans la cour, jugé express, condamné par un oukase du Comité central signé Malenkov, et exécuté d’une balle dans la tête, son corps brûlé devant le bâtiment comme celui du Führer.

Le film est une satire politique efficace. Il use du rire pour dénoncer la tyrannie stalinienne comme Charlie Chaplin le fit avec Le dictateur pour la tyrannie hitlérienne. La bouffonnerie révèle plus que le plat récit des événements car elle met en scène les affects des personnages : tous terrorisés, tous sidérés devant le tyran vivant – comme devant sa disparition. Tous se débattent avec des ascenseurs en panne, des chasses d’eau qui mettent une heure à se remplir, des voitures réquisitionnées parfois jusqu’en France (les Citroën noires de la Milice). Tous cherchent un nouveau cadre, un nouveau chef, une nouvelle routine. Avec « le peuple » en prétexte. Il a bon dos, le peuple. Venu en masse encenser le cadavre de Staline, pleurer le tyran dont ils avaient l’habitude ou pleurer la fin enfin de celui qui les opprimait…
Drôle, machiavélique, shakespearien, assez proche de la réalité historique malgré quelques licences de dates – une bonne approche du Kremlin, de l’antique Ivan le Terrible au récent Vlad l’empafeur.
Le film est interdit de diffusion sur le territoire de la Russie de Poutine dès janvier 2018, signe de son pouvoir révélateur. La tyrannie reconstituée par Poutine et ses mafias a peur du rire, qui moque le faux sérieux des tyrans pour faire éclater leur carton-pâte – « le placage du mécanique sur du vivant » diagnostiquait Bergson. Fanatiques et inquisiteurs s’abstenir !
DVD La mort de Staline (The Death of Stalin), Armando Iannucci, 2017, avec Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Paddy Considine, Rupert Friend, Jason Isaacs, Gaumont 2018, 1h43, €9,99 Blu-ray €14,99
BD La mort de Staline (intégrale), Thierry Robin et Fabien Nury, Dargaud 2017, 144 pages, €25,50












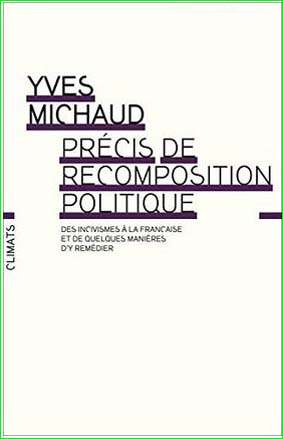

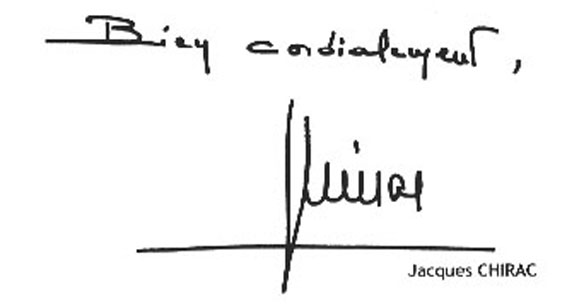





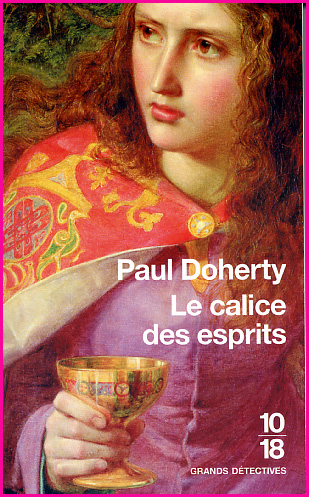
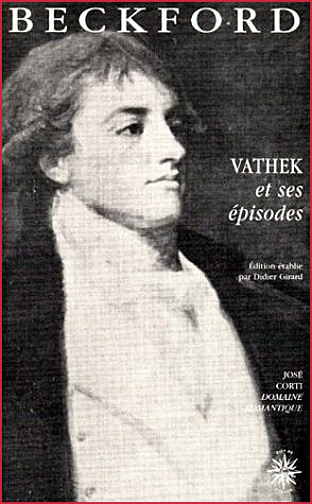
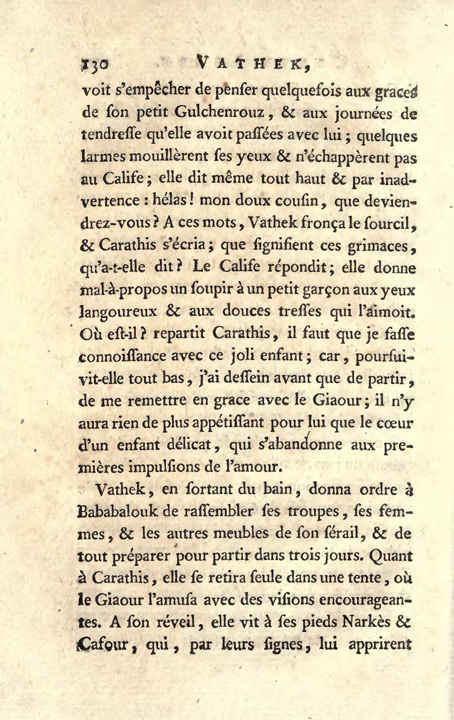










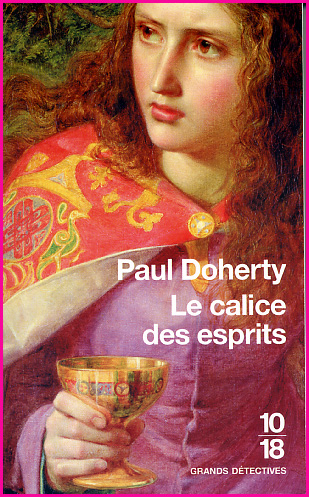







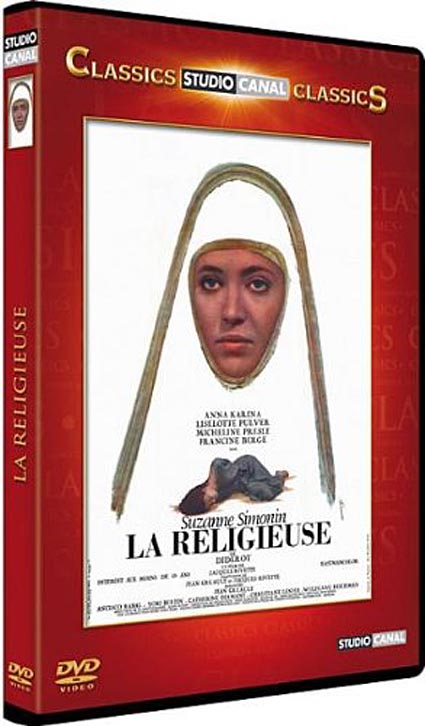
Commentaires récents