S’il ne fait pas « le bonheur », il y contribue. En avoir ou pas est la principale question que se pose chacun à tout moment, pour sa survie, son existence décente, son plaisir. L’argent ne peut pas tout, mais il est un moyen puissant. D’où vient l’argent ?
Il provient des échanges. Il ne naît pas de rien, mais du travail. Ce travail peut être effectué pour soi, sans échange, auquel cas l’argent n’est que négatif : il est ce que l’on n’a pas dépensé en bricolant soi-même, en faisant sa propre cuisine, son propre ménage. Il peut y avoir échange en nature, auquel cas l’argent ne sert pas. Mais dès qu’il y a échange complexe, l’argent est le moyen incomparable de rendre équivalent le travail payé et le travail accumulé. Comme l’eau, il est indispensable à la vie, celle de l’économie – qui est la bonne gestion de l’œkoumène, la maisonnée.
Chacun peut vivre pour soi, autonome dans la nature. Mais il s’agit de vie sauvage. Dès que la civilisation apparaît (ce qui révulse les écolos puristes !), le travail se fait plus collectif et l’échange naît. Certains gardent les troupeaux, traient les bêtes et font du lait, beurre et du fromage ; d’autres cultivent le sol et produisent des céréales, des légumes et des fruits ; d’autres encore bâtissent des maisons, des murs et construisent des meubles ; ou bien martèlent le fer, forgent des charrues, cisèlent des couteaux ou des épées et réparent les instruments… Chacun produit plus qu’il n’a besoin – d’où l’échange. Il permet de troquer une part de son travail contre la part du travail d’un autre, complémentaire à la sienne. Mais comme il est difficile de mesurer exactement combien de blé représente un couteau, ou combien de couteaux une maison (d’autant que le bâtisseur n’a pas besoin d’autant de couteaux), une mesure abstraite naît : l’argent. Il est né avec la civilisation, dès Sumer il y a 7000 ans, et a pris plusieurs formes, des lingots de métal aux coquillages rares en passant par les pièces.
La monnaie est un outil qui permet des échanges au plus juste. Cette justesse est estimée par l’offre et la demande, ce qui est rare étant plus précieux, donc plus cher. Le « marché » n’est donc ni un complot des puissants ni la loi de la jungle, mais le lieu (physique ou symbolique) des échanges.
Pour cela, il faut qu’existe la confiance. Elle ne naît pas de rien, mais des relations sociales. Au plus près des producteurs et des acheteurs sur les marchés des villages, sur les foires des bourgs, dans les magasins des villes. Au plus loin lorsque le pays est grand et administré par un gouvernement ; c’est alors l’Etat qui est le garant et le gardien de la confiance. Via la monnaie, dont il assure le pouvoir d’achat, via la fiscalité qui rend communs des services que le privé ne produit pas (armée, routes, services sociaux), via la politique économique pour réguler l’emploi et les règles de production.
D’où les impôts et taxes, qui sont de l’argent prélevé sur les particuliers et les entreprises pour financer cette mise en commun. Impôt qui est de l’argent public, venant du public, dont le remploi politique est surveillé par le Parlement – dont la principale justification est la « loi de finance » annuelle.
Le travail produit des biens et services qui font l’objet d’échanges via le marché, lequel ne peut fonctionner sans confiance assurée par un pouvoir, aujourd’hui l’Etat. L’argent est cet outil fluide et garanti qui permet d’évaluer un travail et de le payer par un moyen d’échange standard, lequel paiement permettra d’autres échanges, et ainsi de suite.
C’est donc le travail qui est premier et l’échange second. S’il y a besoin, il y a travail – mais il n’y a pas forcément échange : les autarciques produisent pour eux, sans rien demander à personne.
Le crédit est un autre moyen que le travail de produire de l’argent, mais là encore il n’est pas premier. En premier demeure le travail. Créer, produire et échanger permet de transformer le surplus de sa production en épargne (soit de stock, soit le plus souvent d’argent). Cette épargne peut être prêtée – à des particuliers, à des banques, à l’Etat – et ce prêt l’immobilise un certain temps. Ce qui justifie une rémunération – qui est le prix du temps plus une prime de risque en cas de non-remboursement ou de dépréciation. Lorsque vous payez par carte bancaire, vous émettez de l’argent nouveau en achetant tout de suite et en payant plus tard (crédit à court terme) ; quand vous achetez une voiture ou une maison, de même, vous payez à crédit mais vous disposez de suite du bien (crédit à moyen ou long terme).
Lorsque vous êtes une entreprise, de l’artisan micro-entrepreneur à la multinationale, acheter à crédit (des matières premières, des machines, un stock de produits à revendre, des flottes de transport, des murs de magasin…) vous permet de produire tout de suite, d’être payé tout de suite – et de rembourser plus tard, progressivement, avec le fruit de votre labeur.
Le crédit produit donc de l’argent : non seulement à celui qui le prête (via l’intérêt qu’on lui sert), mais aussi à celui qui emprunte (puisqu’il acquiert les moyens de produire de suite et de rembourser ensuite avec les bénéfices de son travail).
On le voit, l’argent ne naît pas de rien mais, dès qu’il naît, il circule. Pour le bénéfice de tous, même si certains affairistes peuvent profiter indûment des naïvetés et des délais inévitables dans tout processus d’échange.
Ce n’est pas la « spéculation » qui est mauvaise, mais la triche. Spéculer veut dire en effet que l’on prend un risque, un pari sur l’avenir. Que ce risque soit rémunéré, rien que de plus normal. Ce n’est que lorsque l’on ment sur le risque (comme dans les placements composés de subprimes), ou sur le rendement « assuré » (comme dans la pyramide de Ponzi Madoff), qu’il y a triche et profit indu.
C’est alors à la loi – votée par le Parlement – et à l’Etat – censé faire respecter la loi du fait qu’il a seul le monopole de la violence légitime – de contrôler et d’agir contre ces pratiques néfastes à l’économie et aux citoyens.
L’argent ne sert à rien en soi ; il sert à tout en société. Mais son usage reflète la société elle-même, et non on ne sait quel esprit diabolique.


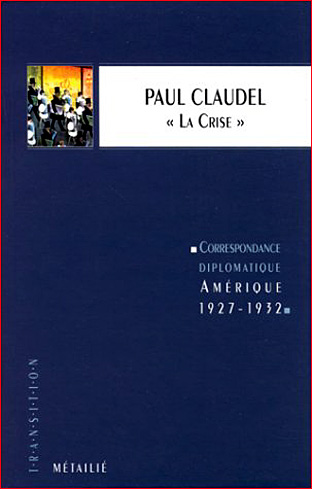





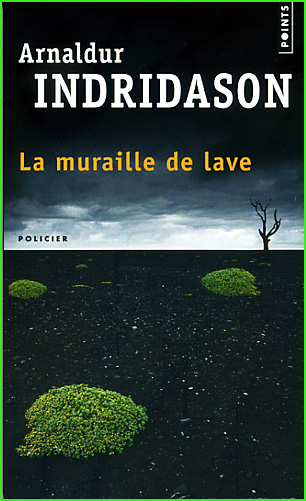







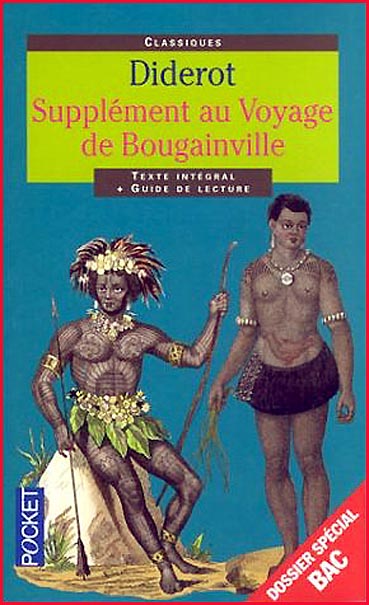

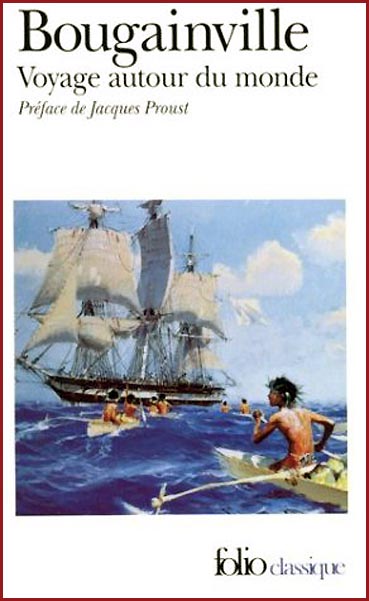
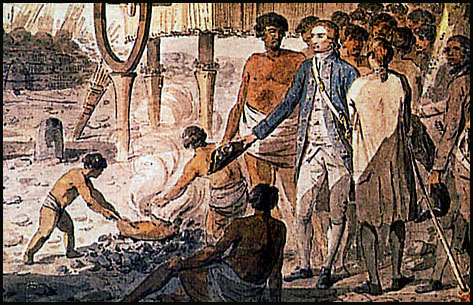



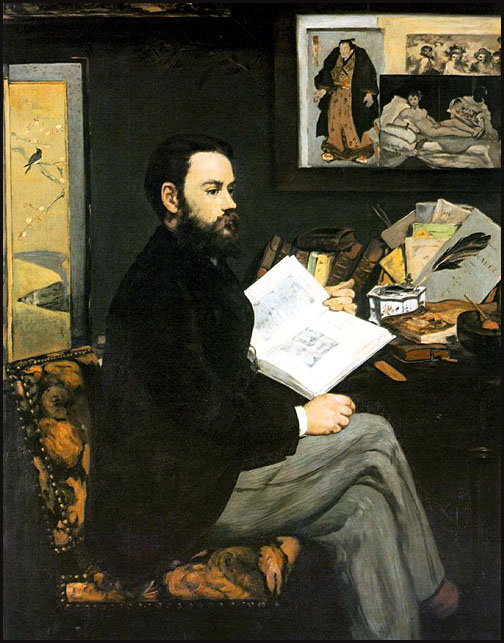

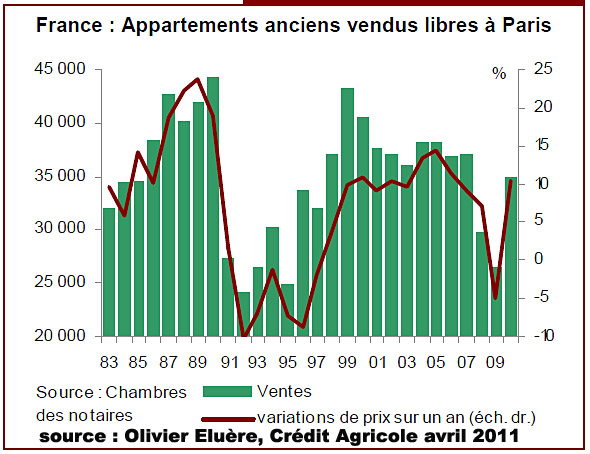
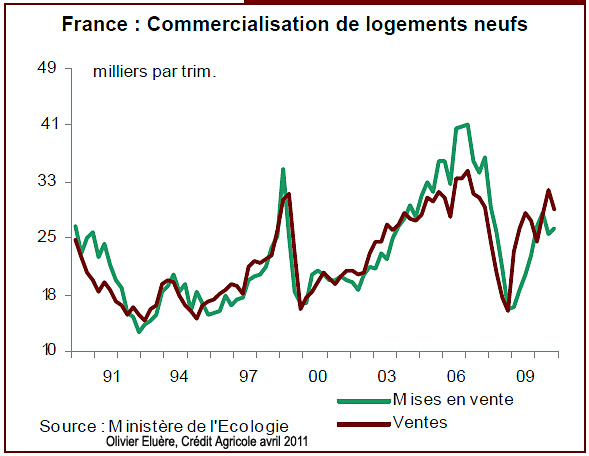
Commentaires récents