 Émile Zola écrivit ‘L’Argent’ en 1891. Fidèle à sa méthode, il s’est documenté, a beaucoup interrogé, est allé voir les lieux mêmes de l’intrigue. Il compose son roman en trois actes, comme un drame classique : l’exposé des motifs, le nœud de l’intrigue, la conclusion édifiante. Ce n’est pas une tragédie, Zola est trop positiviste ; c’est bel et bien un ‘drame bourgeois’ avec le mari, la femme, l’amant :
Émile Zola écrivit ‘L’Argent’ en 1891. Fidèle à sa méthode, il s’est documenté, a beaucoup interrogé, est allé voir les lieux mêmes de l’intrigue. Il compose son roman en trois actes, comme un drame classique : l’exposé des motifs, le nœud de l’intrigue, la conclusion édifiante. Ce n’est pas une tragédie, Zola est trop positiviste ; c’est bel et bien un ‘drame bourgeois’ avec le mari, la femme, l’amant :
- Le mari c’est le banquier juif Gundermann, froid et rationnel.
- La femme c’est la bourse, la passion laïque du jeu, incarnée d’ailleurs par la baronne qui se donne à qui en veut contre un tuyau.
- L’amant c’est Saccard, le ‘héros’ dramatique catholique mené par son enthousiasme, féru d’activisme, mais qui ne sait pas se contrôler.
Au fond, Zola se moque bien de l’économie ; contrairement à Balzac, il n’y connaît pas grand chose. S’il décortique les techniques boursières de son temps après s’être documenté en journaliste, c’est pour leur plaquer l’a priori général qu’il a de « l’histoire naturelle » de la société : tout est sexe et fumier. On ne fait de beaux enfants que dans le stupre ; de bonnes affaires que par magouilles ; de belle politique que par trahison. C’est pourquoi Émile n’est pas Honoré, aux perspectives plus vastes ; ni surtout Gustave, ce Flaubert qui pousse le réalisme jusqu’au surréel. Zola reste englué dans ses préjugés envieux de petit-bourgeois ébahi par ce qu’il comprend mal : l’empire, la banque, l’élan vital. Tout reste chez lui coincé au foutre : pas de politique sans coucheries intéressées ; pas d’affaires sans viol ni maîtresses achetées ; pas d’amour sans boue ni saleté. Freud ne fera que rationaliser cet état d’esprit catholique-bourgeois du 19ème siècle où la chair (diabolique) commande tout et le sexe (faible) parvient à tout détruire comme Ève au Paradis…
 La bourse ? Elle est pour Zola « ce mystère des opérations financières où peu de cervelles françaises pénètrent » chap. 1. Dès lors, tout est dit : puisqu’il n’y comprend rien, il traduit avec ses lunettes roses :
La bourse ? Elle est pour Zola « ce mystère des opérations financières où peu de cervelles françaises pénètrent » chap. 1. Dès lors, tout est dit : puisqu’il n’y comprend rien, il traduit avec ses lunettes roses :
1. L’argent comme fièvre du jeu : « A quoi bon donner trente ans de sa vie pour gagner un pauvre million, lorsque, en une heure, par une simple opération de Bourse, on peut le mettre dans sa poche ? » chap. 3 Alors qu’il y a très peu de vrais « spéculateurs » en bourse. Même Jérôme Kerviel le trader n’en était pas un, mû par l’ambition de prouver aux gransécolâtres de sa banque qu’il réussissait mieux qu’eux – pas par l’appât du gain.
2. L’argent comme passion sexuelle : « Alors, Mme Caroline eut la brusque conviction que l’argent était le fumier dans lequel poussait cette humanité de demain. (…) Elle se rappelait l’idée que, sans la spéculation, il n’y aurait pas de grandes entreprises vivantes et fécondes, pas plus qu’il n’y aurait d’enfants sans la luxure. Il faut cet excès de la passion, toute cette vie bassement dépensée et perdue, à la continuation même de la vie. (…) L’argent, empoisonneur et destructeur, devenait le ferment de toute végétation sociale, servait de terreau nécessaire aux grands travaux dont l’exécution rapprocherait les peuples et pacifierait la terre. » chap. 7 Mais pourquoi l’argent serait-il « sale » – sauf par préjugé biblique du travail obligatoire dès qu’on n’obéit plus à Dieu ? Il n’est qu’un instrument, la nécessaire liquidité pour investir et l’outil de mesure du crédit ?
3. L’argent comme capacité positiviste : « Mais, madame, personne ne vit plus de la terre. L’ancienne fortune domaniale est une forme caduque de la richesse, qui a cessé d’avoir sa raison d’être. Elle était la stagnation même de l’argent, dont nous avons décuplé la valeur en le jetant dans la circulation, et par le papier-monnaie, et par les titres de toutes sortes, commerciaux et financiers. C’est ainsi que le monde va être renouvelé, car rien n’est possible sans l’argent, l’argent liquide qui coule, qui pénètre partout, ni les applications de la science, ni la paix finale, universelle… » chap. 4. Par là, Zola traduit le désarroi des « fortunes » traditionnelles, issues des mœurs aristocrates singées par les bourgeois accapareurs de Biens Nationaux à la Révolution : ils n’ont rien compris à l’industrie ni au commerce, ces Français archaïques ; ils ne désirent que des « rentes » pour poser sur le théâtre social. Alors que l’argent est liquide comme le foutre et que seule sa liquidité permet d’engendrer de beaux enfants, ils regardent avec jalousie ces financiers qui utilisent le levier du crédit pour créer de vastes empires industriels ou commerçants. C’est pourquoi son ‘héros’ devra chuter – car une réussite terrestre aussi insolente appelle une punition « divine » ou « de nature » (pour Zola, c’est pareil).
4. L’argent comme immoralité suprême : « Il n’aime pas l’argent en avare, pour en avoir un gros tas, pour le cacher dans sa cave. Non ! s’il en veut faire jaillir de partout, s’il en puise à n’importe quelles sources, c’est pour la voir couler chez lui en torrent, c’est pour toutes les jouissances qu’il en tire, de luxe, de plaisir, de puissance… (…) Il nous vendrait, vous, moi, n’importe qui, si nous entrions dans quelque marché. Et cela en homme inconscient et supérieur, car il est vraiment le poète du million, tellement l’argent le rend fou et canaille, oh ! canaille dans le très grand ! (…) Ah ! l’argent, cet argent pourrisseur, empoisonneur, qui desséchait les âmes, en chassait la bonté, la tendresse, l’amour des autres ! Lui seul était le grand coupable, l’entremetteur de toutes les cruautés et de toutes les saletés humaines. » chap. 7.
Voilà, tout est dit : le credo de la gauche française est fixé pour un siècle et demi. Zola était radical, la gauche de son temps. Mesdames et Messieurs Aubry, Moscovici, Royal, Dufflot, Mélenchon et Besancenot ne parlent pas autrement aujourd’hui. Les immobilistes donneurs de leçons comme Messieurs Chirac et Bayrou non plus. Le dogme est que l’argent le rend fou et canaille – point à la ligne. Où l’on ramène l’économie à la morale, comme si c’était du même ordre. Est-ce de réciter le Credo qui produit le pain ? Ne serait-ce pas plutôt le travail ? Il y a un temps pour prier et pour faire la morale, et un temps pour travailler et produire. C’est même écrit dans la Bible…
Confondre les deux en dit long sur la capacité de penser. La moraline remplace la morale et les inquisiteurs les politiques. L’argent est un outil et un outil n’a pas de morale : seul l’être qui l’utilise peut en avoir une. Le bon sens populaire sait bien, lui, qu’un mauvais ouvrier a toujours de mauvais outils.
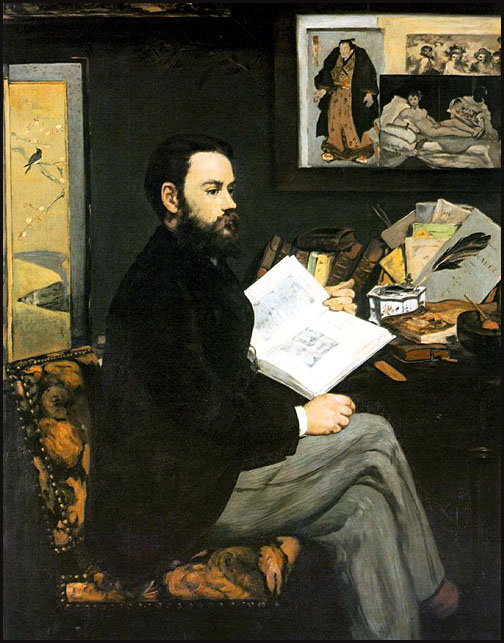 Que faire contre l’argent ? Zola a lu Marx et c’est pour cela que la gauche l’encense, malgré l’antisémitisme affiché de ‘L’Argent’. L’un des personnages est Sigismond Busch, louche apatride – juif russe émigré – dont le frère récupère sans merci les dettes signées par les gigolos pour les faire cracher. Mais Sigismond incarne chez Zola l’Idéaliste, le jeune homme, fiévreux de théorie, évidemment phtisique. Il ne rêve que collectivisme socialiste – et il mourra évidemment selon la morale de Zola, pour que le roman respecte « l’histoire naturelle » de son temps.
Que faire contre l’argent ? Zola a lu Marx et c’est pour cela que la gauche l’encense, malgré l’antisémitisme affiché de ‘L’Argent’. L’un des personnages est Sigismond Busch, louche apatride – juif russe émigré – dont le frère récupère sans merci les dettes signées par les gigolos pour les faire cracher. Mais Sigismond incarne chez Zola l’Idéaliste, le jeune homme, fiévreux de théorie, évidemment phtisique. Il ne rêve que collectivisme socialiste – et il mourra évidemment selon la morale de Zola, pour que le roman respecte « l’histoire naturelle » de son temps.
Zola, en exposant les bases du marxisme, a quand même cette incertitude salvatrice à laquelle JAMAIS le socialisme n’a pu répondre : « Certainement, l’état social actuel a dû sa prospérité séculaire au principe individualiste que l’émulation, l’intérêt personnel, rendent d’une fécondité sans cesse renouvelée. Le collectivisme arrivera-t-il jamais à cette fécondité, et par quel moyen activer la fonction productive du travailleur, quand l’idée de gain sera détruite ? Là est pour moi le doute, l’angoisse, le terrain faible où il faut que nous nous battions, si nous voulons que la victoire du socialisme s’y décide un jour… », chap. 1.
‘L’Argent’ ? Un roman porno autorisé fin 19ème : sans doute pas la meilleure explication de la bourse.
Émile Zola, L’Argent, Folio classique, €5.41
En savoir plus sur argoul
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

« La capitalisation actuelle d’Air-France égale au prix de 20% de sa flotte aérienne » : sérieux ? J’achète immédiatement ! Voilà une valeur d’actifs largement décotée, même tenant compte de l’obsolescence des appareils. (Mais je n’ai pas vérifié votre assertion).
Sur la spéculation, on est trop loin de Zola et cela mérite plus ample développement. j’y répondrai dans une note complète.
J’aimeJ’aime
Mais reconnaissez néanmoins que la spéculation n’apporte rien au bien commun, si elle peut apporter beaucoup à un individu ou un groupe d’individus (parfois énorme: un fond de pension. Mais on a des retraités dont les spéculations par délégation peuvent menacer des salariés…) .
Et que dans un sens ou l’autre elle permet d’arriver à des situations surréalistes comme la capitalisation actuelle d’Air-France égale au prix de 20% de sa flotte aérienne. Ou au temps de la bulle internet, des entreprises capitalisées 40 fois leur chiffre d’affaire alors qu’elles perdaient 50F quand elles avaient 20F de recette! (ancêtres… les tulipes de Hollande)
Dans la logique capitaliste, si je place 1000 dans une entreprise, je lui permets de se développer. Je touche ma part des bénéfices et quand je réalise, je fais une plus value (si je ne me suis pas planté) Mais j’ai contribué à donner du travail, au bien commun. Quand j’achète virtuellement quelque chose que je revendrai, le tout avec de l’argent que je ne possède pas (j’ai une ‘couverture’) et cela des fois 1000 fois dans la seconde en va et vient… cela profite à qui?
Quand Saccard finance de sports et un chemin de fer au Proche Orient, c’est une autre dimension que quand il spécule à la Bourse.
Je vois une exception: l’entreprise qui achète ou qui vend à terme pour se donner de la lisibilité. Le kérosène pour une compagnie aérienne, le cacao pour un groupe alimentaire, etc. Sinon aucune politique commerciale n’est possible.
J’aimeJ’aime
Votre conclusion est juste : spéculer nécessite la tête froide, il s’agit de calcul rationnel, pas de montages où le risque est refilé comme le mistigri. J’ai pratiqué ça un long moment (une génération) avant 2007… Les naïfs sont les émotionnels et les addicts (je ne trouve pas le mot en français). Gérer un fonds, un patrimoine ou un petit portefeuille est un métier, pas un jeu.
Les techniques boursières ont peu évolué de Zola aux modèles de la finance : ce qui a tout changé est moins la dérégulation Reagan que l’explosion brutale et sans qu’on en aie conscience, des techniques de la communication. Mondialisation + Internet + capitaux à gogo (en raison des politiques laxistes des banques centrales, surtout la Fed) = terrain de jeu exponentiel + billes sans compter = châteaux de cartes + krach. Je l’avais dit dès 2006, mais allez parler aux convaincus du contraire… Je me suis donc retiré.
Le trader cynique, au nom mafieux, qui amuse le net en ce moment, dit la vérité : les traders se foutent du monde, il peut bien crouler, ce qui leur importe est de profiter des écarts de cours. Ils sont maximum quand les gens ont peur : ça monte et ça baisse très vite (volatilité) et là on jouit… Le contraire de la gestion à la Warren Buffet (milliardaire américain parti comme simple analyste financier il y a 50 ans) où il s’agit d’analyser et de s’asseoir sur son investissement.
Je suis pour ma part, après longue expérience, partisan de l’interdiction pure et simple de la vente à découvert (qui ne couvre pas des actifs réels). Tout comme il était interdit à Billy the Kid de piquer ce qu’ils n’avait pas, dans l’Ouest, il devrait être interdit aux traders d’aujourd’hui de vendre ce qu’ils n’ont pas (Madof est le plus talentueux des traders… puisqu’il n’a jamais investi un seul cent, payant les intérêts des anciens clients avec les capitaux des nouveaux entrants). Il s’agit toujours de vendre ce qu’on ne possède pas.
Concernant l’époque 1848-1914, je comprends que mon dégoût à moi est du même ordre que votre goût à vous : le programme obligatoire de Science Po, époque des pères des profs de mon époque, assez proche pour y lire l’avenir, assez lointaine pour éviter les lunettes idéologiques. D’où ma saturation. Ce siècle n’a pas bouleversé les habitudes plus que le siècle qui a précédé (de la mort de Louis XV à 1848), ni celui qui a suivi (1914-2001) : la France était encore largement rurale en 1960, ni l’eau courante ni l’électricité n’arrivant dans toutes les campagnes, ni même le téléphone du Monopole public, le fameux 22 à Asnières…
J’aimeJ’aime
Il y a également des comparaisons « amusantes » entre la législation de l’époque et l’actuelle. Notez que ce krach romanesque est calqué sur un véritable krach, d’une banque également « catholique », vaincue par les « Juifs et les Protestants »
Le rachat des actions par la propre entreprise. A l’époque, rigoureusement interdit en théorie. Dans la pratique tout le monde le faisait pour faire grimper artificiellement les cours. Saccard, pour arriver et tenir le cours des 3.000F (initialement 500F) avait engagé des sommes folles qu’il ne possédait pas, à découvert. Son train de vie hallucinant était également nécessaire, une ‘réclame’ pour la banque qui ne pouvait qu’être riche pour traiter aussi somptueusement son directeur.
On signale incidemment l’exemple extrême d’une compagnie de chemins de fer qui avait racheté… toutes ses actions alors que des gogos les avaient acquises à découvert. Quand il leur a fallu les livrer et qu’ils ne pouvaient évidemment pas le faire, ils furent dépouillés.
Le couple Moser (baissier) et Pillerault (haussier) est aussi intéressant, même si caricatural.
L’importance du délit d’initié, de l’information confidentielle… Même si pour que le roman soit lisible, on n’a pas fait trop technique… le député Huret qui lit une dépêche sur le coin du bureau du ministre, court la rapporter à Saccard… chacun croit à la guerre et c’est la paix… il fait un coup énorme. Cette imbécile de baronne Sandorff qui ‘donne’ Saccard réduit aux expédients à Gundermann au moment où celui-ci se demande s’il ne faut pas se résoudre à lui laisser une place. Alors le monstre froid ne frappe qu’une fois. La bonne.
On note aussi que les ‘vraies affaires’ de l’Universelle à savoir ce que le frère de Madame caroline sont florissantes ou vont l’être.
Ma conclusion en dehors de ce que je pense personnellement c’est que de l’Argent on tire deux ‘morales’:
– le vrai capitalisme, de production, offre relativement peu de risque s’il n’est pas pollué par une spéculation artificielle. Si Saccard s’était appuyé sur les vraies affaires, raisons sociales de l’Universelle, l’action serait passée de 500 à 1500F, mais elle serait restée à ce niveau et aurait apporté des dividendes. Là elle est montée à 3.000 mais la Méchin les a rachetées toutes au prix du papier (elle les revendra avec une très bonne marge: ça permettait de créer de faux déficits)
– Si on veut spéculer il faut avoir la tête froide. Ne pas évaluer une entreprise au dessus de ses actifs et de ses perspectives, jamais.
Les couillons, les naïfs (la marquise, Sigismond, Mme caroline, son frère, Maugendre, etc.) sont des moutons promis à l’abattoir.
J’aimeJ’aime
‘ ‘ N’y voyez aucune critique, mais je suis curieux de savoir pourquoi ce romancier vous plaît aussi particulièrement, et pourquoi cette époque semble votre « vert paradis ». Elle me paraît à moi si caricaturale, si bornée, si coincée… Bien loin du début de siècle 1800 comme de l’après 1968. En revanche (peut-être est-ce cela ?) on y revient…’ ‘
_________________________
Pour le XIXe siècle, d’une part ce n’est pas mon « vert paradis », mais une période qui me fascine pour des raisons subjectives, en le faisant démarrer comme les nouveaux historiens vers 1848 pour le faire s’achever en 1914 et la première bataille de la Marne.
Incontestablement, l’influence d’un professeur y contribua, un vieil érudit d’une exigence incroyable qui assénait son cours magistral en seconde (à nous de prendre des notes) mais consacrait des heures de son temps (hors les cours!) à des causeries avec qui le souhaitait… et en était jugé digne. On ne venait pas ‘pour discuter’ mais pour écouter et poser des questions pertinentes. Et pour intervenir à bon escient… qui parlait pour ne rien dire était renvoyé dans les cordes immédiatement. M. Codaccioni nous a démontré qu’à cette époque et quelle que soit la condition sociale, les changements dans la vie quotidienne tout comme dans les mœurs politiques furent plus importants en quelques décennies que lors des siècles précédents: même la Révolution, sauf en Vendée, ne changea pas grand chose aux habitudes paysannes donc à celles de 80% de la population. Pour lui, 1848 en Europe fut infiniment plus marquant que 1789 en France. Digression piquante… Un jour il s’est oublié à nous dire que s’il votait ce serait pour les communistes, mais que monarchiste convaincu, il ne saurait voter! (ce fut le seul ‘écart’ en deux ans)
Pourquoi j’aime Zola? Je ne sais pas trop. C’est ainsi. Sans doute un peu par hasard… A l’école primaire, un texte très expurgé de l’Assommoir pour illustrer une leçon sur les méfaits de l’alcool (l’agonie de Coupeau) et vers 12 ans, j’ai pioché le livre dans la bibliothèque familiale en souvenir de cette leçon (j’étais dès mes sept ans un gros lecteur). Il fallait quand même que j’aie des explications, et ma mère me les a données sans fard (sans doute pas ravie que je sois tombé là dedans, mais elle a fait avec). Germinal, découvert à 13 ans, fut pour moi une sorte de roman d’aventures, et ce ne fut que plus tard que j’ai vu autre chose dedans. Et Balzac, c’est après, beaucoup plus tard; reconnaissez que la description en plus de dix pages du salon du père Goriot, c’est un sacré bizutage!
*********************************
‘ ‘ Dans ce siècle catholique-bourgeois, la hantise était le sexe, la semence « gaspillée » (d’où ce bondage médical des ados en collèges la nuit…). La métaphore évangélique de la semence à faire fructifier est très parlante comme clé de lecture : celui qui conserve, celui qui dissipe et celui qui plante. Le dernier seul est évangélique, accomplissant ce que Dieu voulût qu’il fit. Zola était clairement anticlérical (son roman ‘Rome’ est édifiant) mais pas anti-Evangiles. Maxime – le fils – est plus humain (donc plus proche de Jésus) que Sacard le père (plus ancien testament).’ ‘
___________________________
Je ne suis pas du tout sûr que cette répression masturbatoire était systématique, même au XIXe siècle (la visite-conférence du musée de l’érotisme à Paris m’a renforcé dans cette idée). On continuait de branler les petits garçons pour les faire dormir à la campagne et quand le pli est pris, « ça ne s’oublie pas ». Maxime lui même était un ‘petit vicieux inverti’ chassé du collège de Plassans pas tant parce qu’il se paluchait, mais plutôt parce qu’il séduisait ses copains en se donnant une tournure efféminée pour les exciter (la Curée). Aurait-il eu un Monsieur protecteur, ami bienveillant de la famille, curé, notable, que tout se serait bien passé. On aurait parlé de mentor et de disciple…
Tout s’est arrangé dès qu’il est monté à Paris, adolescent, et qu’il a engrossé une domestique envoyée à la campagne avec une pension, puis qu’il s’est tapé les copines de belle-maman, (avant de se l’envoyer aussi, mais là effectivement il y avait grave transgression: Renée en est morte de dégoût d’elle même). A noter que ce dégoût affiché vis à vis de la pédérastie et de l’homosexualité n’empêchait pas les adeptes de s’y adonner plus facilement que quelques décennies plus tard au vu et au su de chacun. Quand on était du peuple et assez mignon, on se trouvait un protecteur de la classe au dessus, quand on était en haut tout était permis. Il n’y avait que les ‘invertis’ de la classe ouvrière et qui y restaient qui souffraient quand personne ne les en avait sortis ( comme de nos jours, être homo en cité est terrifiant). a la campagne, les ‘bougres’ trouvaient chaussures à leur pieds (ou le contraire)
Effectivement, des « médecins » combattaient le ‘vice solitaire’ – mais le meilleur remède était encore le sexe dès qu’on était en âge (je parle, dans la bourgeoisie, des garçons; pour les filles les ‘Amitiés particulières’ rencontraient bien plus d’indulgence… lire Colette): les gars se tapaient la bonne ou allaient au bordel avec papa (Pot-Bouille: Madame Duveyrier s’informe à mots couverts auprès du médecin de famille de la santé de la cuisinière dès qu’elle voit que son fils Gustave, 15 ans, tourne autour. Il ne faut pas qu’il reste chaste mais surtout, qu’il ne chope pas la vérole! Et maman est une grande chrétienne…).
Dans les classes populaires, on forniquait très tôt – ce qui ne donnait pas tellement de plage temporelle pour le ‘vice honteux’ entre les premières pulsions pubertaire et la consommation partagée. Compte tenu du fait que l’âge de la puberté a gagné plus d’un an en moins d’un siècle, on entre plus tard en 2011 dans la vie sexuelle (en moyenne) qu’au XIXe siècle: de nos jours, 17 ans environ pour les garçons, un peu plus pour les filles.
Sous Napoléon III on mariait les filles à cet âge et les garçons étaient déniaisés tôt par la bonne ou la fille de ferme, voire la journalière simplette qu’on faisait tourner: ce n’est absolument pas une nouveauté, cette « tradition »!
____________________________________
Notez aussi que Zola, dans l’Argent, donne des idées marxistes une vision ridicule… preuve qu’il ne les reprend pas du tout à son compte. L’exposé candide que Sigismond, le frère de l’immonde Bush, fait à Saccard est à la fois magistral, éblouissant et d’une puérilité…
J’aimeJ’aime
Vous apportez beaucoup de compléments à ma note par votre lecture polyphonique et précise. Vous dites juste dans les détails, je ne vais pas jusque là, lisant ce roman de Zola (après les autres) dans l’optique qui est la mienne : le préjugé français contre l’argent, le fantasme complotiste du Grand Méchant marché.
L’histoire de Zola se voulant « naturelle », il ne pouvait qu’épouser les théories naturalistes de son temps. Dont celle de Spencer sur la lutte pour la vie (Darwin était plus subtil), celle de Marx après Guizot sur la lutte des classes, celle de Schopenhauer sur le vouloir-vivre, voire celle de Nietzsche sur la « volonté » de puissance, et celle des pré-psychologue d’époque (l’hystérie, etc.).
Dans ce siècle catholique-bourgeois, la hantise était le sexe, la semence « gaspillée » (d’où ce bondage médical des ados en collèges la nuit…). La métaphore évangélique de la semence à faire fructifier est très parlante comme clé de lecture : celui qui conserve, celui qui dissipe et celui qui plante. Le dernier seul est évangélique, accomplissant ce que Dieu voulût qu’il fit. Zola était clairement anticlérical (son roman ‘Rome’ est édifiant) mais pas anti-Evangiles. Maxime – le fils – est plus humain (donc plus proche de Jésus) que Sacard le père (plus ancien testament).
Zola ne devait pas être persuadé de la foi des Français du temps, il voit la religion comme instrument de pouvoir social sur les « âmes » et les corps. Interdire sous risque de brûler en enfer durant l’éternité était un fouet très puissant. Faire de l’argent la tentation du diable, analogue au sperme, était une tentation d’écrivain social. D’autant que « le » socialisme (qui engendrera des enfants forts divers) est un avatar du christianisme, tout comme aujourd’hui l’écologie. N’est valorisé que le travail à la sueur de ton front, l’accouchement dans la douleur, le salaire mérité seulement par la peine, etc. Quiconque se prend pour Dieu devient diable (spéculer est créer de l’argent ex-nihilo comme Dieu ou les sorciers magiciens), quiconque acquiert la puissance est proche de sa perte. Seul l’Évangile est modéré (libéral ?) en indiquant clairement la voie à suivre : faire fructifier en plantant le grain de froment (comme la semence en corps de femme) pour produire de beaux enfants blonds ou des blés. Sans violer la réalité par la magie.
Contrairement à vous (mais est-ce vraiment votre idée ?), je vois dans Zola la métaphore criante de l’argent comme semence, de la spéculation comme avidité sexuelle, du gain comme rapt ou viol. Cela rejoint Freud, qui compose ses « théories » à partir de la mosaïques des idées de ces années-là, pour qui TOUT est sexe. L’ambition sociale est la puissance sexuelle affichée, l’odeur de l’argent étant doux phéromone pour ces dames.
Mais ce que vous apportez comme détails reste très intéressant pour qui lit le livre. Ma note restait modeste, avec pour sujet le préjugé anti-argent de la psyché française, très lisible chez Zola dans ce roman et tout aussi lisible dans l’actualité politique d’aujourd’hui. Je n’avais aucune ambition d’opérer une synthèse littéraire; comme d’habitude, il s’agit d’un blog, donc de ma réaction personnelle aux lectures que je fais. Il est bon que chaque lecteur apporte sa vision et ses corrections éventuelles, sans souci des « spécialistes » qui n’ont pas le monopole des oeuvres.
N’y voyez aucune critique, mais je suis curieux de savoir pourquoi ce romancier vous plaît aussi particulièrement, et pourquoi cette époque semble votre « vert paradis ». Elle me paraît à moi si caricaturale, si bornée, si coincée… Bien loin du début de siècle 1800 comme de l’après 1968. En revanche (peut-être est-ce cela ?) on y revient…
J’aimeJ’aime
Je ne partage pas du tout votre analyse, ce qui ne signifie pas que je prétends avoir raison quand vous auriez tort.
Ne comparons pas Balzac et Zola d’abord. Le premier est un maître écrivain, un littérateur, quand le second est davantage un observateur.
Déjà le catholicisme de Saccard (on ne connaît bien Saccard que quand on a lu le Curée, où il est décrit en spéculateur immobilier) n’est qu’opportuniste. Il y a le conflit avec le frère Ministre Rougon qui, s’il était confit de dévotion dans les mains de l’Eglise, aurait poussé Saccard dans les bras du rationalisme athée, par réaction. Rougon s’oppose à Saccard, il refuse de lui ‘donner un coup de main’ (en clair: de l’aider à commettre des délits d’initiés non pas parce que c’est mal mais parce que ‘ces choses là, ça finit toujours par se retourner contre vous’) et Saccard lui voue pour cela une haine inexpiable qui vient également des origines: le lourdaud Rougon peu estimé de sa mère a choisi le bon camp dès le début de la saga (le coup d’état du 2 décembre) et a daigné tendre le bout d’un doigt (méprisant) à Sicardot devenu Saccard qui a failli s’attirer de gros ennuis et ne s’en est sorti que par une manœuvre ridicule (une main faussement blessée, bandée, qui ‘l’empêcha d’écrire ses éditoriaux quelques jours durant’ dans ce trou du cul du monde qu’était Plassans (Aix) le temps d’y voir un peu clair… ce qui ne trompa personne). C’est bien connu: on voue une haine inexpiable à ceux qui vous sauvent; ils vous renvoient à votre condition de personnage un peu ridicule qui s’est mis dans les ennuis de lui même.
Saccard n’est pas ‘enthousiaste’: c’est un joueur compulsif, un malade, que ce soit en amour ou dans sa manière de mener ses ‘affaires’ et tel une belle Othéro, il a des moments de rayonnement inouïs suivis au cours desquels sa mégalomanie éclate et ferait pouffer de rire n’importe qui si les individus n’étaient naturellement veules, et ne cherchaient avant tout à ramasser des miettes du gâteau qu’il dévore à pleine dents (mais qui est acheté au comptant, et à découvert. D’autres où rien ne lui réussit.
La vision de l’argent par Madame Caroline n’est ni celle de Zola ni celle que nous devons en tirer selon l’auteur. C’est celle d’une bonne vieille nunuche sage au point d’en être imbécile, de la femme dotée d’une solide instruction qui pressentit la catastrophe mais qui, par faiblesse envers un homme qu’elle admirait malgré toutes ses tares (et son peu d’intérêt pour le petit Victor, en dehors des questions financières, n’est pas la dernière de leurs manifestations) : c’est ce que devaient en penser les catholiques confits de dévotion – et très hypocrites: « y penser toujours, n’en parler jamais ». D’ailleurs c’est ainsi que j’interprète la métaphore de Zola, ce but caché et purement virtuel de la Banque Universelle: financer l’installation du Pape à Rome, pour qu’il retrouve une puissance temporelle égale à son pouvoir spirituel. (là encore, y penser mais n’en point parler. On attrape les mouches comme la vieille comtesse et sa fille avec ça, on emballe le frère de Madame caroline, mais le reste du conseil d’administration n’a rien à faire de ces billevesées)
Malgré les préjugés antisémites de Zola, considérables et que ceux ceux qui ne l’ont étudié que superficiellement ignorent (il y a des pages terrifiantes dans l’Argent sur ‘cette juiverie sale et malpropre aux doigts crochus’, Bush vaut bien les métèques cosmopolites de ‘je suis partout, plus tard), le héros positif de Zola, dans ce roman, c’est Gundermann, spéculateur impitoyable mais à la tête froide, capable dans la même minute de prêter un milliard de francs-or à une cour européenne et de rabattre de quelques francs le compte d’un remisier ‘qui d’ailleurs, le volait’
– Oh Monsieur, pour ce que ça ferait, comme différence…
– Comment ça mais c’est énorme, 23F! Chacun son dû, moi je ne connais que ça!
Gundermann frappe en jouant également à découvert. Mais sa stratégie est fondée sur tout, sauf l’émotion. Une entreprise bancaire ou autre voit sa valeur définie par ses actifs, ses perspectives de développement et ses bénéfices. Si, elle est sous-évaluée par rapport à ces éléments, on achète; si elle est sous-évaluée, on se suit pas le troupeau: on vend. (cela ramène à cette réflexion d’un des premiers Rothschild : « j’ai fait fortune en vendant toujours trop tôt ») Et la conclusion est implacable et logique.
C’est la raison associée à la puissance qui gagnent, devant l’enthousiasme et les murs bâtis sur du sable. Mais pas davantage que Saccard, Gundermann ne gagne sa vie en produisant des biens ou des services. lui aussi, il spécule. (brève digression pour signaler que c’est tout à l’honneur de Zola, personnage assez peu intéressant par ailleurs sur le plan moral, d’avoir vu clair et choisi ‘le bon camp’ lors de cette affaire Dreyfus pour laquelle il avait tout à perdre, malgré ces préjugés antisémites qui étaient ceux de son époque et de son milieu)
Vous évoquez ce crétin de Maugendre:
– A quoi bon donner trente ans de sa vie pour gagner un pauvre million, lorsque, en une heure, par une simple opération de Bourse, on peut le mettre dans sa poche ?
Mais ce pauvre type est arrivé à cette conclusion près quarante ans de dur labeur (un commerce de bâches) pendant lesquels il mettait pour point d’honneur de ne jamais mettre un pied en bourse, de n’acheter « aucune valeur industrielle ». Un jour, pour se faire un petit plaisir (se payer une terrasse sur son jardin, je crois) il a tenté une opération qui lui rapporta gros et le virus l’a contaminé. Comme chaque jour des centaines de joueurs compulsifs sont saisis par le démon du jeu au point de rompre toute vie sociale. J’ai fréquenté les casinos, j’en ai vus et j’ai bien failli en devenir un… je sais de quoi je parle. Et les bars PMU-Rapido, les hippodromes sont pleins de ces victimes d’addiction. Il commet toutes les sottises: engager tous ses biens à découvert, mettre tous ses œufs dans le même panier (les actions de l’Universelle).
Maugendre est un joueur idiot, pas un spéculateur. Qui plus est, un fraîchement converti, donc un ardent propagateur de la Foi, au point de laisser sa fille et son gendre dans la misère comme le font bien des victimes d’addiction: le Ricard plutôt que les petits pots pour bébé, la cocaïne plutôt que les frais d’inscription à l’université de l’ainé.
Face à lui un personnage de sa famille, le capitaine Chave ‘qui a des vices que sa retraite de vieux soldat ne peut financer’. Lui, fort conscient de ses limites, et naturellement raisonnable (qui n’a pas ces qualités ne survécut point aux campagnes napoléoniennes) va quotidiennement à la Bourse, ne joue qu’au comptant et ramène chaque soir sa pièce de 20F (ce qui était une somme à l’époque, quand même), qui lui permet de ‘payer des bonbons aux petites filles’ (à noter que ce qui nous horrifie 140 ans après fait rire tout le monde, y compris la très prude et très morale Madame Caroline).
Vous citez Maxime, fils de Saccard:
Il n’aime pas l’argent en avare, pour en avoir un gros tas, pour le cacher dans sa cave. Non ! s’il en veut faire jaillir de partout, s’il en puise à n’importe quelles sources, c’est pour la voir couler chez lui en torrent, c’est pour toutes les jouissances qu’il en tire, de luxe, de plaisir, de puissance… (…) Il nous vendrait, vous, moi, n’importe qui, si nous entrions dans quelque marché. Et cela en homme inconscient et supérieur, car il est vraiment le poète du million, tellement l’argent le rend fou et canaille, oh ! canaille dans le très grand !
Pardonnez-moi d’être persuadé que ce déchet de l’humanité, cette fin de race, n’est certainement pas le porte parole de Zola! Lui même adore l’argent, pour se payer des parfums de luxe, manger dans de la vaisselle en vermeil, se comporta lui aussi comme la dernière des canailles dans « la Curée ». La différence avec Saccard c’est qu’il en éprouva non des remords, mais une certaine gêne face aux conventions du moment.
************************
Je ne lis rien, dans l’Argent (qui n’est pas le meilleur livre de Zola s’il n’est pas le pire) qui soit une condamnation de l’argent ou de la spéculation.
J’y vois une condamnation de l’emportement, de l’irrationalité, de la non maîtrise de soi. Saccard est un compulsif et d’ailleurs la scène de la rencontre avec Madame Caroline, dans sa cellule, quand il est en attente de jugement, le rend sympathique malgré toutes ses tares.
Jouez, spéculez, mais comme Gundermann; pas comme Saccard et surtout pas comme cet imbécile de Maugendre! telle est la conclusion de l’Argent. Sinon, si vous n’en avez pas les capacités, travaillez contre un salaire ou tentez d’écrire un roman… En dehors de toute considération idéologique, n’est ce pas un conseil de bon sens qu’on donnerait à ses enfants, même en 2011?
****************************
Ensuite je ne vois pas de ‘porno’ dans ces centaines de pages; tout au plus – enfin! – l’évocation du fait qu’en plus de paraître socialement, de manger, de travailler, de se distraire, les humains baisent, qu’ils soient ouvriers, mineurs, bourgeois, boursiers, paysans. Que des fois on jouit, des fois non.
Un écrivain naturaliste ne suggére les choses, il les écrit crument comme Renoir peignait enfin une femme à poil au milieu d’hommes, dans un déjeuner sur l’herbe. Basta avec l’hypocrisie des peintres académiques qui peignaient les mêmes femmes nues, mais sous forme d’allégories sur lesquelles les collégiens de l’époque se branlaient frénétiquement tout comme les nôtres, sur des images captées sur le Net.
Idem, dans Pot-Bouille on nous signale incidemment que dans les appartements, il y a un ‘cabinet d’aisance’ (c’est là que le ridicule Duveyrier rate son suicide, ce qui consterne sa femme: non pas l’acte en soi, mais le ridicule des circonstances).
Une observation clinique intéressante… l’absence totale de sensualité chez les passionnés par autre chose que le sexe. Cette baronne Sandorf prête à tout pour gagner en Bourse (donc qui perd tout) belle à mourir et nymphomane mais incapable de jouir parce qu’elle ne peut se donner, ayant l’esprit ailleurs, Saccard qui s’impose un défi… parvenir à la réduire enfin, à lui faire franchir le pas!
Il y a des chapitres de Zola qui, mieux que des descriptions de cuistres, font comprendre certaines névroses ou psychoses: vous avez lu « la joie de vivre »… vous avez tout sur les troubles bipolaires, la psychose maniaco-dépressive! Là on a la nymphomanie…
**************************
Il y a de grosses faiblesses dans ce roman. D’abord, trop de conventions romanesques, justement, trop d’invraisemblances. la Méchin qui apparaît dès le début avec sa grosse sacoche en cuir, contenant les actions de sociétés en faillite achetées au prix du papier. On devine dès cet instant que celles de l’Universelle finiront là. Madame Caroline qui a fait un gros héritage, et qui ne peut rembourser les quelques milliers de francs que Maxime lui a prêtés ‘parce que vous êtes une gobeuse, vous parviendrez à vous les faire rendre’. Saccard qui travaille 14h par jour et se distrait somptueusement le reste du temps, qui trouve le temps de perdre deux heures pour aller régler lui même une dette de 800F, d’un de ses petits employés. Cet employé, beau-fils des Maugendre, qui fut traîné plus bas que terre par ses derniers qui refusèrent de le recevoir, qui n’aidèrent en rien le jeune coupe et qui, dès que son roman trouve éditeur, les yeux mouillés et le cœur confit de bonté les installera dans ‘un petit pied à terre avec un bout de jardin’. La comtesse et sa fille, fin de race s’il en fut, achevées par le dernier coup du sort, la ruine pour avoir cru en la banque ‘catholique’ jointe à la mort du fils ‘soldat du Pape’ (liste non exhaustive)
Ce n’est pas, et de loin, le meilleur ‘roman-reportage’ de Zola que pour ma part j’adore car il demeure le meilleur témoin d’une époque qui me fascine pour des raisons subjectives (Balzac était nettement antérieur) sans pour autant – je suis lucide – le mettre sur le même piédestal que les Maîtres absolus que sont (dans cet ordre pour ma part) Flaubert et Balzac.
Pardon d’avoir été long. Mais dès que je lis ‘Zola’, je percute.
J’aimeJ’aime